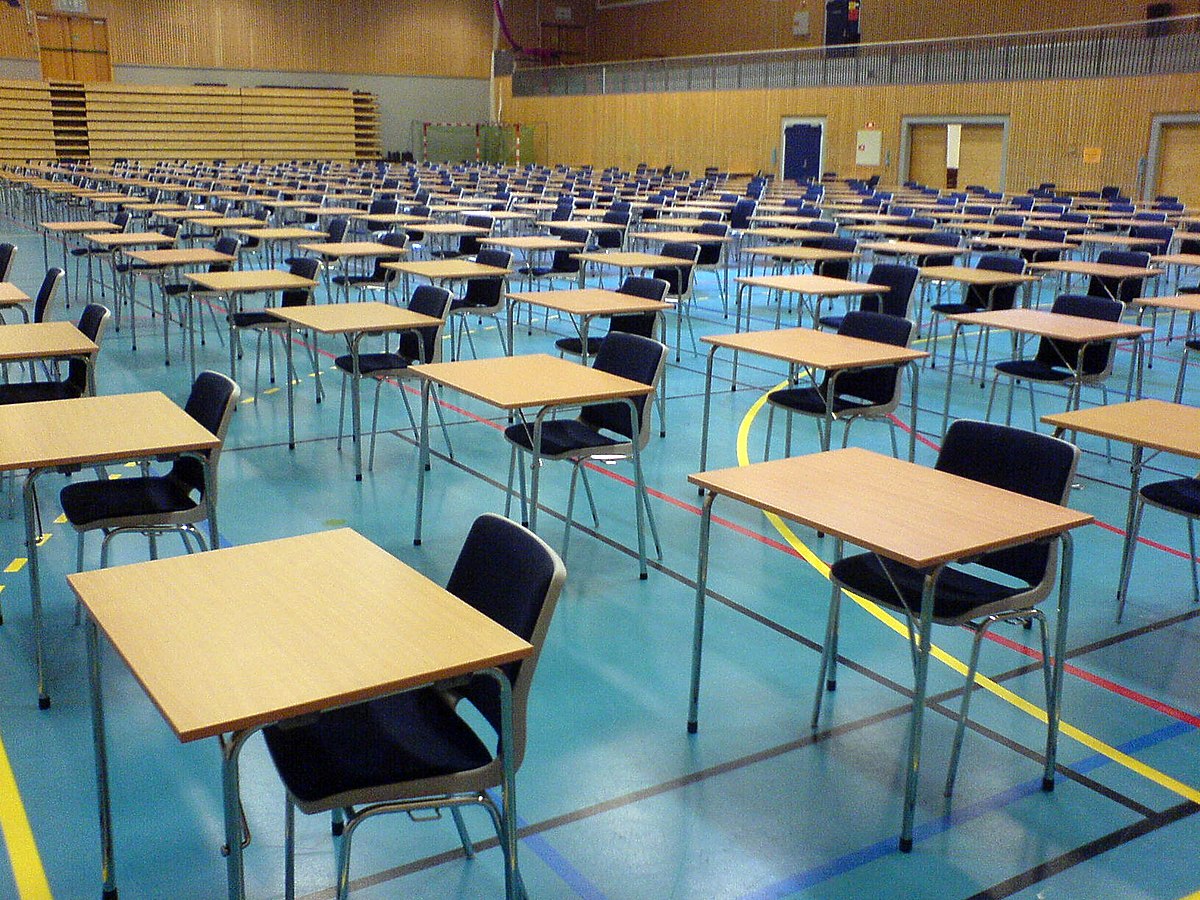Commentaire littéraire (baccalauréat) - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Les enjeux du commentaire littéraire
Le commentaire doit faire ressortir la compréhension des problématiques spécifiques au texte étudié. Définir les enjeux - ou axes de lecture - permet de déterminer le type de plan. Néanmoins suivre le texte ne suffit pas : il faut également mettre en œuvre sa propre culture générale afin d'étoffer l'étude, faire preuve de qualités argumentatives et réinvestir les objets d'étude du programme.
L'argumentation et la formation de l'esprit critique
L'« étude de l’argumentation et des effets sur les destinataires » est au cœur du programme de littérature, avec comme pendant la formation d'un jugement critique. La circulaire précisant le programme de 2006 ajoute que la maîtrise des principales formes de l’argumentation (et notamment de la délibération) est plus précisément l'enjeu des classes de première et de terminale, toutes séries confondues.
Le commentaire ne doit cependant pas se contenter d'être un catalogue de savoirs acquis en classe. L'élève doit aussi argumenter et témoigner d'une sensibilité au texte et, plus généralement, à la littérature et aux arts. Le Bulletin officiel du 2 novembre 2006 (no 40) explique l'importance de cette dimension critique :
« la formation d’une pensée critique autonome, au terme de l’enseignement commun obligatoire du français, les lycéens devront être en mesure de lire, comprendre et commenter par eux-mêmes un texte, en repérant les questions de langue, d’histoire, de contexte, d’argumentation et d’esthétique, qui peuvent être pertinentes à son sujet ; ils devront être capables, à partir de leurs lectures, de formuler un jugement personnel argumenté, notamment dans un commentaire ou dans une dissertation. »
Importance d'avoir une culture générale
Un commentaire littéraire ne peut être rédigé sans l'acquisition d'une culture générale et littéraire minimale ; il se doit d'être, dans la limite du texte, le prétexte à présenter ses connaissances afin d'enrichir l'étude par la compréhension du contexte de son écriture, de la connaissance de la biographie de l'auteur et par la mise en parallèle avec les événements historiques et sociaux.
En soi, le commentaire littéraire est, comme la dissertation, un exercice où prime aussi la transversalité des savoirs et la relation avec les autres disciplines, objectif de l'Éducation nationale pour décloisonner les matières. Le Bulletin officiel no 40 de 2006 précise ces attentes transdisciplinaires :
« Discipline carrefour, le français développe les compétences indispensables dans toutes les disciplines. Des relations plus précises seront établies (et indiquées comme telles aux élèves) avec les disciplines suivantes :
- les arts, notamment pour l’étude des genres et registres, de l’histoire culturelle et l’analyse de l’image ;
- les langues anciennes, pour l’étude des genres et registres, de l’histoire littéraire et culturelle, du lexique ;
- les langues vivantes, en particulier dans l’approche des mouvements culturels européens ;
- l’histoire, y compris l’histoire des sciences, pour la construction de problématiques d’histoire culturelle ;
- la philosophie, que les élèves aborderont en terminale, par la réflexion sur les registres, sur l’histoire culturelle et sur la langue, et par la formation au commentaire de texte et à la dissertation. »
Les objets d'étude
Le sujet doit toujours être rattaché à l'objet d'étude au programme. Le commentaire est une évaluation certificative, c'est-à-dire qui vise à évaluer la capacité de l'élève à avoir compris et à réutiliser les objets d'étude des programmes, à savoir : les outils de la langue, la clarté de l'expression, la connaissance de l'histoire littéraire, la grammaire et la terminologie de l'analyse littéraire.
Les intitulés officiels des objets d'étude sont :
- le théâtre, texte et représentation ;
- l'argumentatif : convaincre, persuader et délibérer ;
- le biographique ;
- les réécritures ;
- l'épistolaire ;
- la poésie.
Ces objets d'étude sont obligatoires. « Leur liste constitue un des apports essentiels des nouveaux programmes, qui indiquent ainsi les fondements de la culture nécessaire et partagée des lycéens et futurs citoyens ». Cependant, selon la série, les objets d'étude ne sont pas les mêmes.