École de la Salpêtrière (hypnose) - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Polémiques avec l'École de Nancy
La question de la suggestion
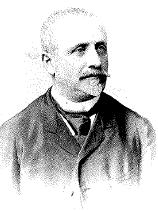
En 1883, le médecin Hippolyte Bernheim, dans une communication devant la Société médicale de Nancy, définit l'hypnose comme un simple sommeil, produit par la suggestion et susceptible d'applications thérapeutiques. Cette déclaration équivaut à une déclaration de guerre contre les idées de Charcot, pour qui l'hypnose est un état physiologique très différent du sommeil, réservé aux individus prédisposés à l'hystérie et sans possibilité d'utilisation thérapeutique. Pour Charcot, les propriétés somatiques de l'hypnotisme peuvent en outre se développer indépendamment de toute suggestion.
Le chef de file de l'École de Nancy, conteste le fait que l'hypnose soit un état pathologique propre aux hystériques. Il fait remarquer que l'on peut tout aussi bien, si on le désire, provoquer artificiellement les manifestations de la grande hystérie chez des sujets non hystériques, ou bien encore provoquer chez les hystériques des manifestations tout à fait différentes de celles décrites par Charcot. Pour lui, « ce qu'on appelle hypnotisme n'est autre chose que la mise en activité d'une propriété normale du cerveau, la suggestibilité, c'est-à-dire l'aptitude à être influencé par une idée acceptée et à en rechercher la réalisation ». Pour Bernheim et ses collègues, les patientes hystériques employées par Charcot lors de ses démonstrations sont des sujets faussés par un excès de manipulation, qui devinent inconsciemment ce qu'on attend d'elles et l'accomplissent. Elles ne font que répéter des leçons apprises à l'insu même de leurs maîtres. Dans la seconde édition de son livre, Bernheim attaque directement Charcot en déclarant : « Les observateurs de Nancy concluent de leurs expériences que tous ces phénomènes constatés à la Salpêtrière, les trois phases, l'hyper-excitabilité neuro-musculaire de la période de léthargie, la contracture spéciale provoquée pendant la période dite de somnambulisme, le transfert par les aimants, n'existent pas alors que l'on fait l'expérience dans des conditions telles que la suggestion ne soit pas en jeu... L'hypnotisme de la Salpêtrière est un hypnotisme de culture ».
Le mathématicien belge Joseph Delbœuf assiste à des expériences à la Salpêtrière en 1885 avec le philosophe Hippolyte Taine. Delbœuf n'est pas convaincu de l'existence d'une polarité magnétique corporelle. Les expériences, auxquelles il a assisté à la Salpêtrière, sont, à ses yeux, loin de présenter les garanties scientifiques requises. Il craint, comme Bernheim et Beaunis de Nancy qu'il ne s'agisse de phénomènes de suggestion ignorée de part et d'autre, dont l'expérimentateur est tout aussi dupe que le sujet.
En 1887, Edgar Bérillon crée la Revue de l'hypnotisme expérimental et thérapeutique qui devient en 1895 la Revue de l'hypnotisme et de la psychologie physiologique et continue à être publiée jusqu'en 1910. Cette revue est ouverte aux partisans des deux écoles rivales et publie des articles de Charcot, Dumontpallier, mais aussi de Bernheim ou Liébeault.
Du 6 au 10 août 1889 se tient à la Faculté de médecine de Paris le premier congrès de psychologie physiologique, dont à peu près la moitié des communications portent sur l'hypnose. Le congrès est présidé par Charcot auprès de qui on trouve trois vice-présidents : Hippolyte Taine, Valentin Magnan et Théodule Ribot. En même temps, du 8 au 12 août se déroule à l'Hôtel-Dieu le premier congrès de l'hypnotisme expérimental et thérapeutique. Ce congrès est présidé par Victor Dumontpallier et a pour présidents d'honneur Charcot, Charles-Édouard Brown-Séquard, Paul Brouardel, Charles Richet, Eugène Azam, Cesare Lombroso et Ernest Mesnet.
Parmi les participants à ces congrès on trouve également Sigmund Freud, Joseph Delbœuf, Hippolyte Bernheim, Ambroise-Auguste Liébeault, Pierre Janet, Paul Janet, William James, Auguste Forel, Wilhelm Wundt, Moritz Benedikt, Jules Dejerine, Émile Durkheim, Frederik Van Eeden, Albert van Renterghem, Julian Ochorowicz et Frederick Myers.
Les contributions des orateurs reflètent la polémique entre les deux écoles. Ainsi, pour Dumontpallier, « l'expérimentation démontre que l'expectante attention et la suggestion n'ont rien à faire dans certaines conditions déterminantes de l'hypnotisme ». Babinski déclare que si l'École de Paris ne conteste aucunement la réalité de la suggestion, elle soutient que la suggestion n'est pas l'unique source des phénomènes hypnotiques. Après avoir rappelé qu'il y a de nombreux moyens d'hypnotiser, Bernheim conclut quant à lui : « un seul élément, en réalité, intervient dans tous ces procédés divers : c'est la suggestion. Le sujet s'endort (ou est hypnotisé) lorsqu'il sait qu'il doit dormir... c'est sa propre foi, c'est son impressionnabilité psychique qui l'endort ».
Suggestions criminelles
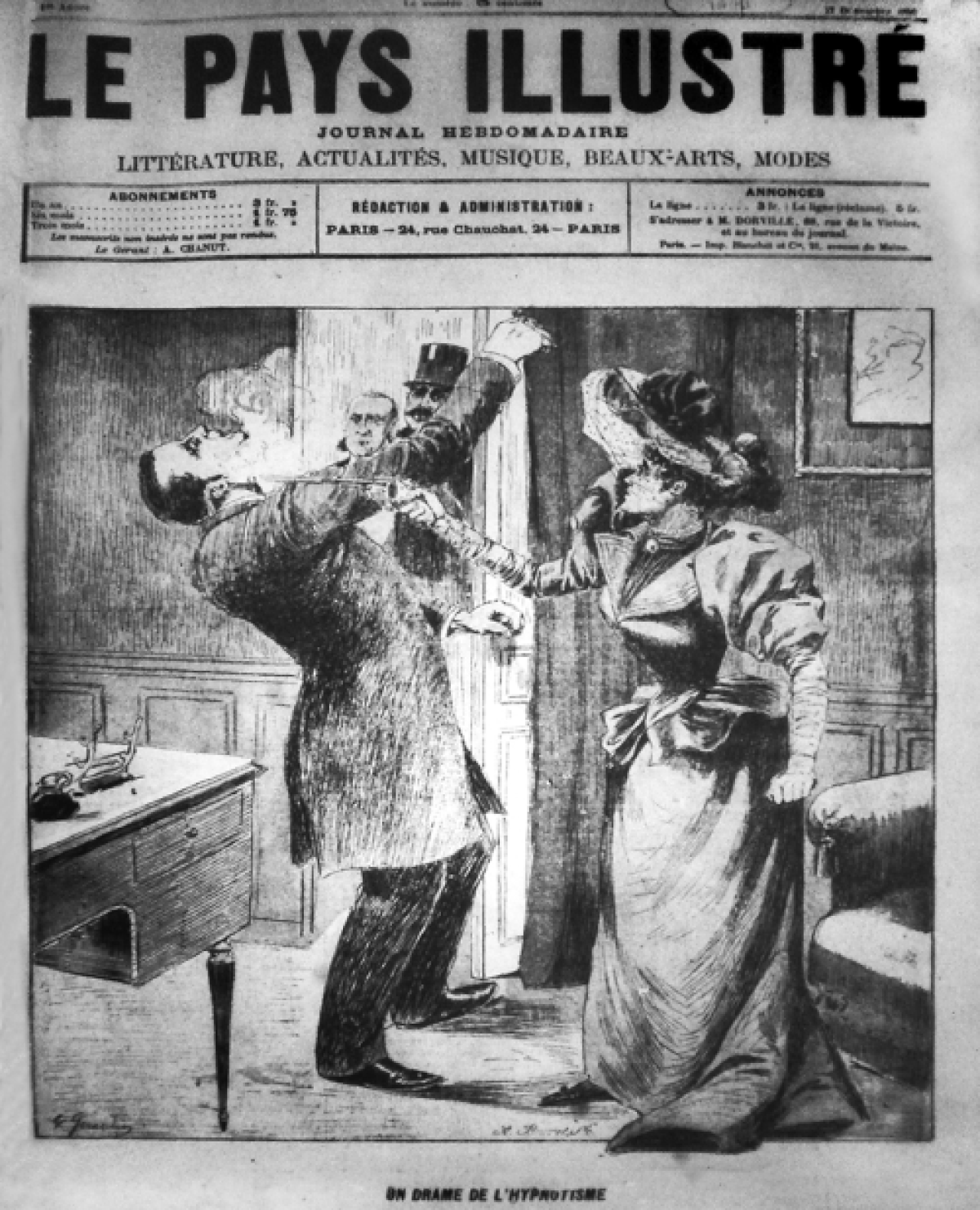
En 1884, un collaborateur de Bernheim, le juriste Jules Liégeois, suggère à des sujets hypnotisés de commettre des crimes, leur fournissant à cet effet des armes inoffensives. Il les amène ainsi à commettre des simulacres de meurtres. Henri Beaunis, un autre membre de l'École de Nancy, en conclut que la suggestion hypnotique fournit enfin à la psychologie l'outil d'expérimentation qui lui faisait défaut. Pour lui, l'hypnotisme constitue « une véritable méthode expérimentale; elle sera, pour le philosophe, ce que la vivisection est pour le physiologiste ».
La majorité des membres de l'École de la Salpêtrière n'acceptent pas les conclusions que Liégeois tire de ses expériences, à savoir qu'il est possible d'amener des personnes à commettre des crimes sous hypnose. Ainsi, Gilbert Ballet déclare que les dangers des suggestions criminelles sont « plus imaginaires que réels ». En 1888, à l'occasion de l'affaire Chambige et en 1890, lors du procès de Gabrielle Bompart, l'hypnotisme fait l'objet de controverses judiciaires, certains experts admettant la possibilité de crimes en état d'hypnose, et d'autres la niant. En 1893, une jeune femme, prétextant qu'elle a été hypnotisée par Gilles de la Tourette à distance et contre son gré, lui tire trois balles de revolver, dont une le blesse grièvement à la tête.
Pour Liégeois, « le somnambule peut être, sans le savoir, rendu auteur inconscient d'actes délictueux ou criminels, même de meurtres et d'empoisonnements ». Binet et Féré, « dissidents » de l'école de Charcot, apportent leur soutien à Liégeois. Ainsi, Féré écrit que « l'hypnotique peut devenir un instrument de crime d'une extrême précision, et d'autant plus terrible qu'immédiatement après l'accomplissement de l'acte, tout peut être oublié, l'impulsion, le sommeil et celui qui l'a provoqué ». De nombreux hypnotistes souscrivent à ces vues, parmi lesquels Ladame, Forel, Pitres, Dumontpallier, Bérillon, Jules Voisin et Krafft-Ebing. Dans le même ordre d'idées, la croyance que l'on peut hypnotiser un sujet contre son gré ou à son insu est partagé vers 1890 par de nombreux praticiens de l'hypnose.
L'amnésie post-hypnotique
Alors que Charcot faisait de l'amnésie post-hypnotique une composante nécessaire du grand hypnotisme, Bernheim montre que l'amnésie des suggestionnés peut être levée. Delbœuf montre quant à lui que l'amnésie, loin d'être spontanée, est elle-même le résultat de l'attente du suggestionneur. Il affirme que « le souvenir et le non-souvenir ne sont que des faits accidentels, sans valeur caractéristique ».

















































