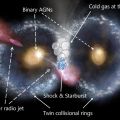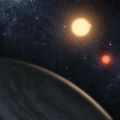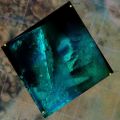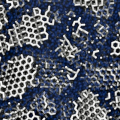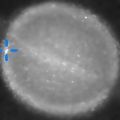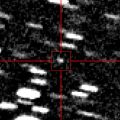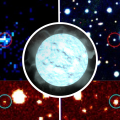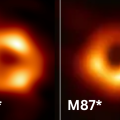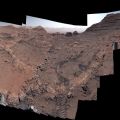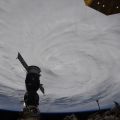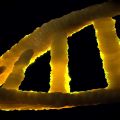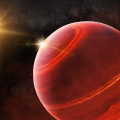Études de médecine en France - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Introduction
En France, les études de médecine sont les plus longues des études supérieures. Elles constituent une formation théorique et pratique, plus théorique au début, de plus en plus pratique à mesure de la progression. À la fin du cursus, le futur médecin est habilité à faire de plus en plus d’actes, et reçoit finalement le diplôme d'État de docteur en médecine, à l’issue de la soutenance d’un travail appelé thèse d'exercice. Il est également titulaire d’un diplôme d'études spécialisées (DES) portant la mention de sa spécialité, et dans certains cas, d’un diplôme d'études spécialisées complémentaire (DESC).
Familièrement, l’étudiant en médecine est appelé « carabin ».
Historique
XVIIIème siècle
- Sous l’Ancien Régime, la médecine était l’une des quatre facultés mais on n’y accédait généralement qu’après un passage par la faculté des arts (voir Faculté des Arts de Paris). L’enseignement était essentiellement théorique et reposait sur la lecture et le commentaire des autorités.
- Cependant, à partir de 1750 environ, mais très timidement, une partie pratique intervient, à travers la botanique mais aussi la clinique. Jusqu’à la Révolution, les chirurgiens n’étaient pas des médecins mais étaient considérés comme de simples exécutants (barbiers-chirurgiens).
- Le système universitaire est supprimé en 1793 et les facultés de médecine sont remplacées, l’année suivante, par quatre écoles de médecine, installées à Paris, Montpellier, Bordeaux et Strasbourg. Avec la création de l’Université impériale, les écoles de médecine reprennent la dénomination de facultés et leur nombre augmente.
XIXème siècle
Au XIXe siècle, en réaction à l’évolution technique très rapide de la médecine et à la médiocrité de l’enseignement théorique universitaire, sont instaurés l’externat et l’internat, formations pratiques hospitalières accessibles sur concours, l’internat étant accessible uniquement aux anciens externes. Les étudiants en médecine commencent alors à négliger les examens de la faculté pour se consacrer à la préparation de ces concours, synonymes d’élite et de qualité de la formation. L’étudiant pouvait arriver au terme de ses études de médecine sans même avoir vu un seul patient, s’il avait raté ou ne s’était pas présenté au concours de l’externat.
XXème siècle
- Suite aux évènements de mai 68, le concours de l’externat fut supprimé, et tous les étudiants en médecine suivirent la formation pratique de qualité qu’est l’externat, devenu obligatoire (le terme « externe » disparut alors des textes, remplacé par le terme « étudiant hospitalier »). Cela correspond à l’idéal hospitalo-universitaire (création des CHU en 1958) : la pratique (l’externat) et la théorie (les cours à l’université) sont réconciliées dans un seul et même cursus pour tous. Avec la loi Faure, Les facultés de médecine deviennent des UER (puis UFR à partir de 1984) intégrées dans une université.
- Cette réforme, corrélée à l’augmentation générale de la population étudiante, engendra un afflux massif d’étudiants dans les services des CHU. En réaction, il fut alors instauré en 1971 un concours de fin de première année de médecine, avec un système de numerus clausus.
- Jusque dans les années 1990, tout médecin pouvait devenir spécialiste, soit en passant la voie sélective et hospitalière de l’internat, soit par la voie non-sélective et universitaire des certificats d’études spécialisées (CES) de moindre qualité, laissant ainsi se développer une médecine spécialisée à deux vitesses entre « anciens internes des hôpitaux » et « anciens chefs de clinique des hôpitaux » d’une part, et titulaires de CES d’autre part. Une réforme supprima donc les CES médicaux et rendit l’internat obligatoire pour la « qualification ordinale » de spécialistes, à travers les Diplômes d’études spécialisées (DES), compléments du diplôme de docteur en médecine.
- Les internes furent contraints de faire un stage en « hôpital périphérique », c’est-à-dire non universitaire, faisant partie d’un Centre hospitalier régional ou CHR.
Evolutions récentes
- Jusqu’en 2004, les futurs généralistes ne passaient pas le concours de l’internat. Le deuxième cycle était suivi d’une période appelée « résidanat », et qui durait deux ans et demi (trois ans pour les nouvelles promotions de résidents à partir de 2001).
- À partir de 2004, une nouvelle réforme est intervenue. Tous les étudiants en médecine doivent désormais passer l'examen national classant (renommé « épreuves classantes nationales » par la suite) et faire un internat. L’ancien résidanat devient alors l’internat de médecine générale, dans le cadre du processus de revalorisation de cette profession désertée de façon inquiétante.
- À partir de la rentrée 2010, la première année sera commune avec celle de pharmacie (en plus de celle de odontologie et de sage-femme) et les études de médecine s'inscriront dans le processus de Bologne.