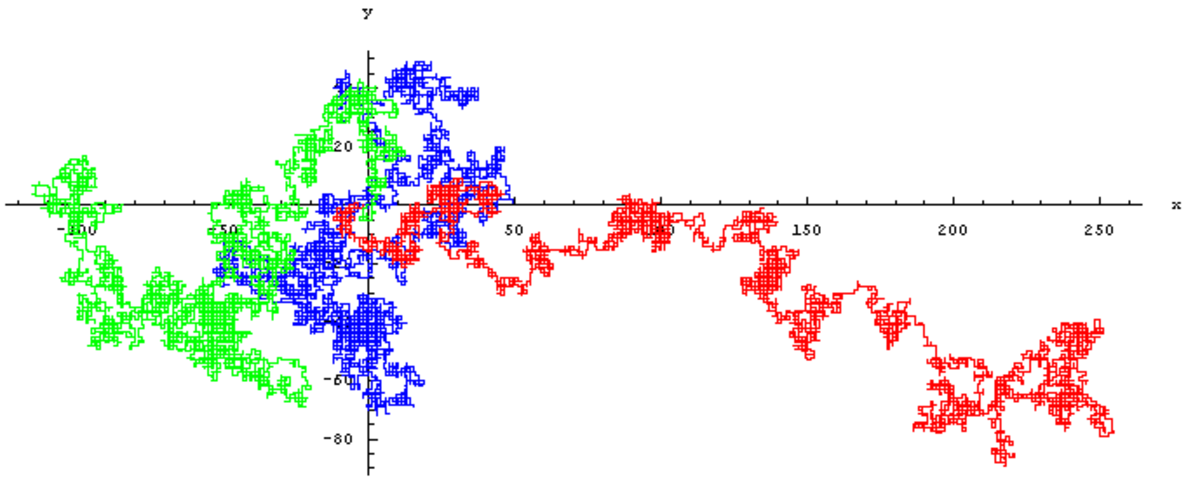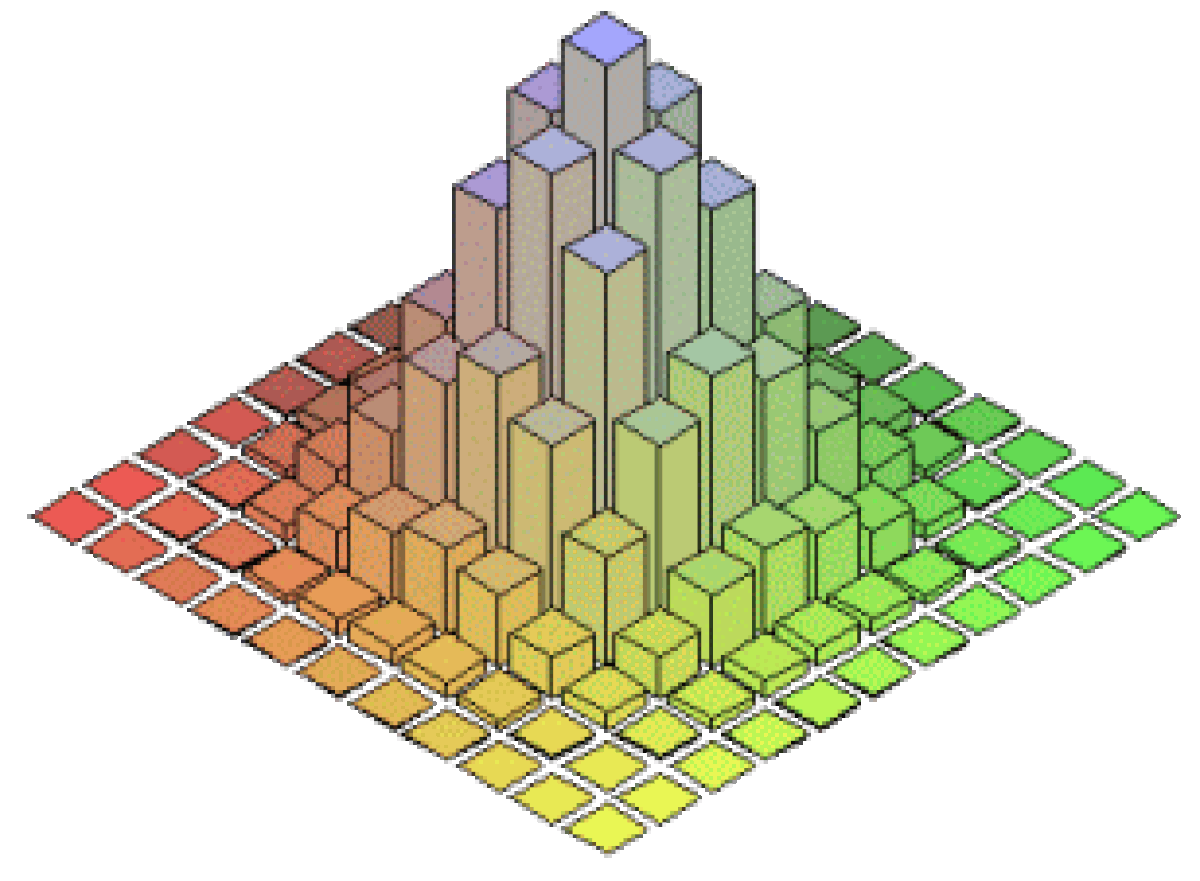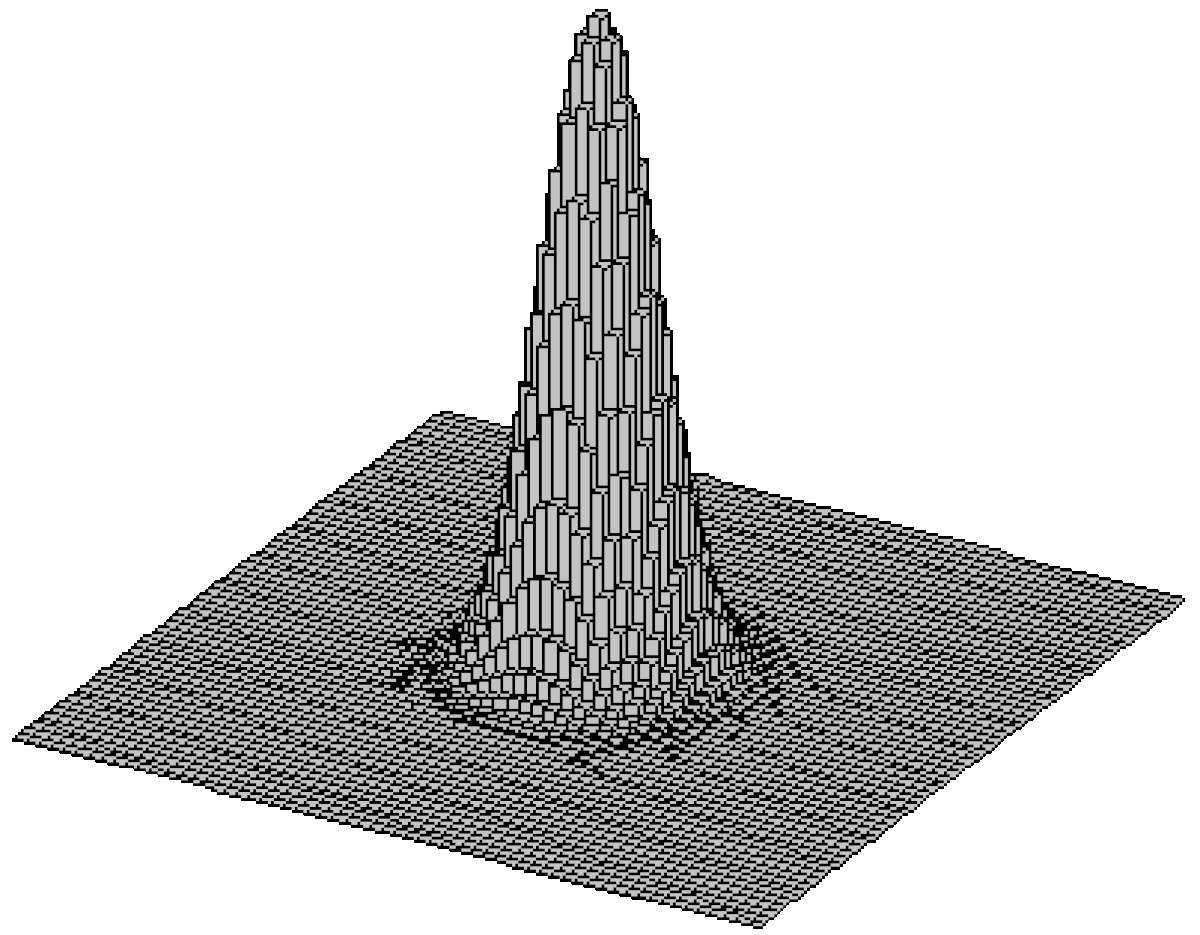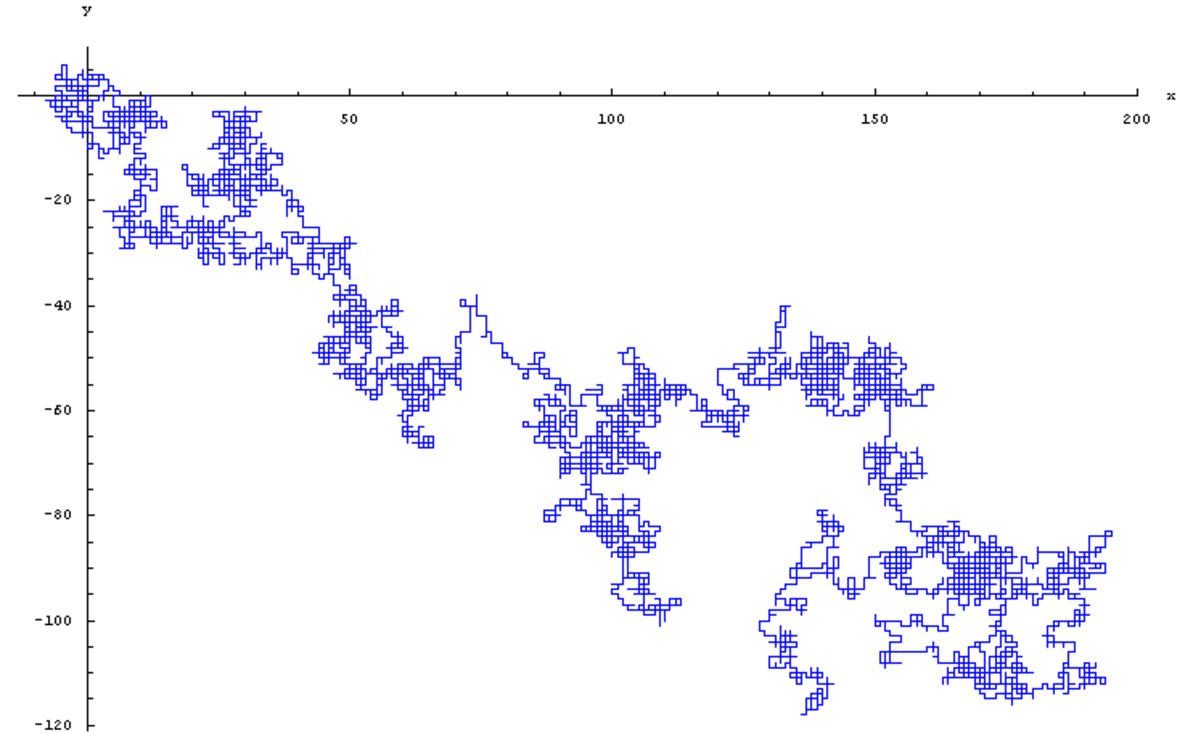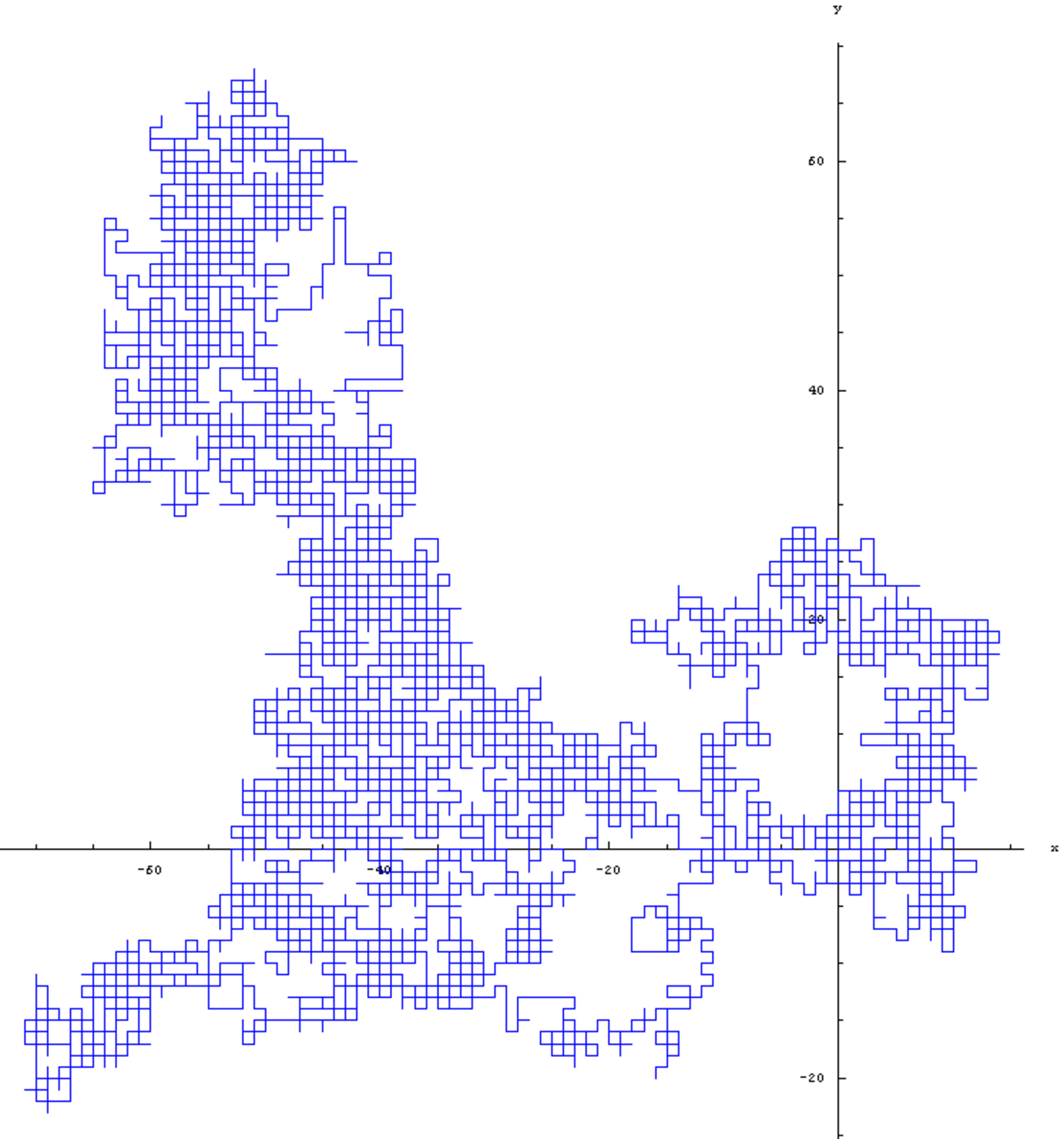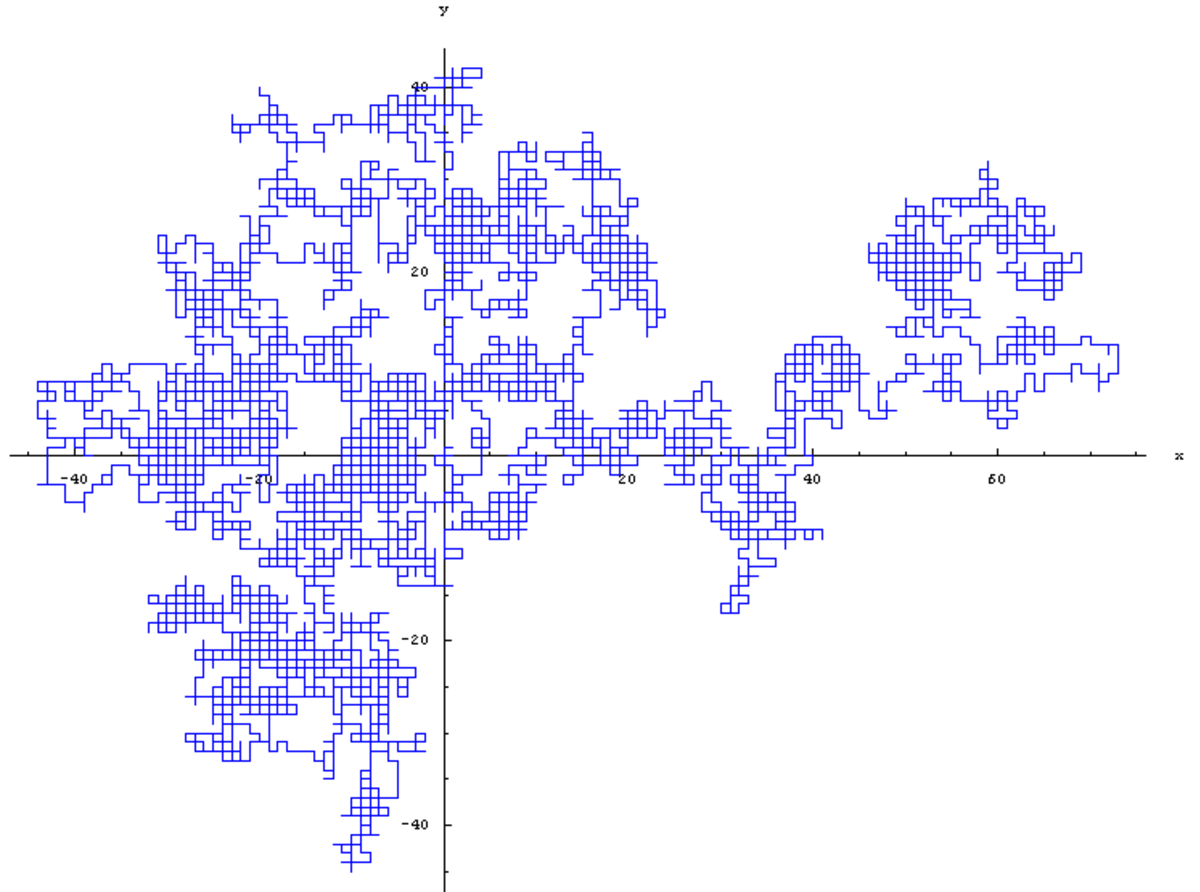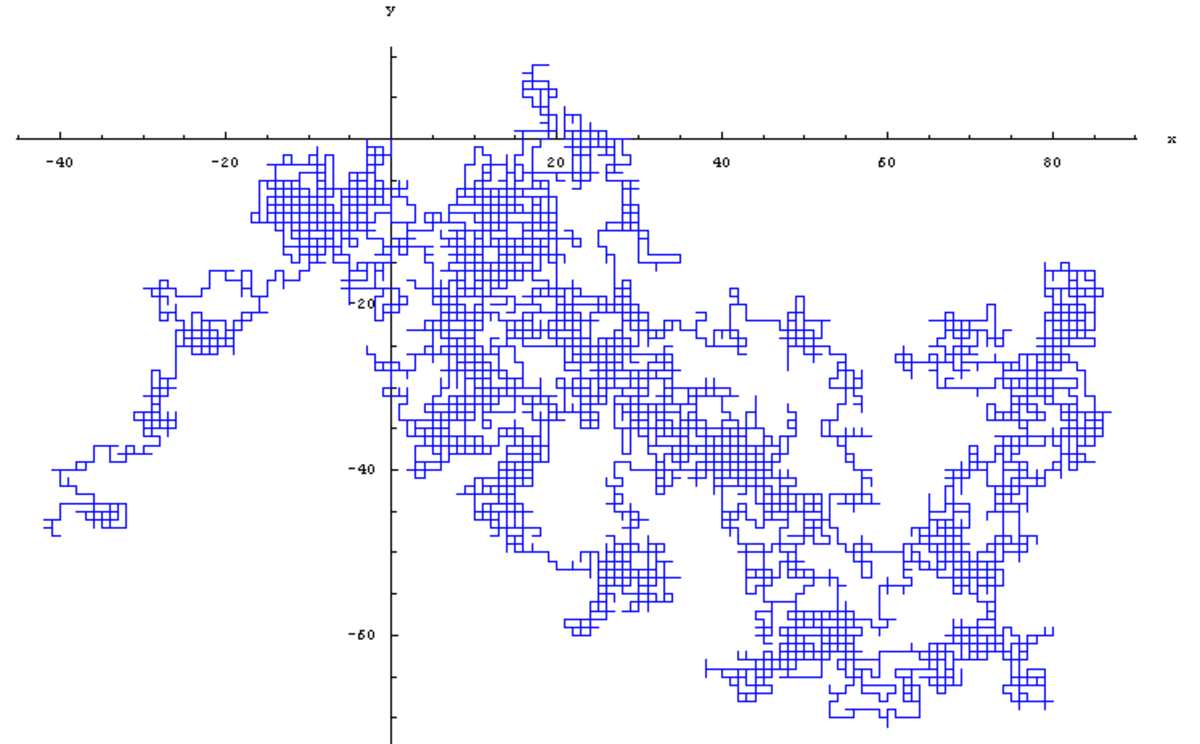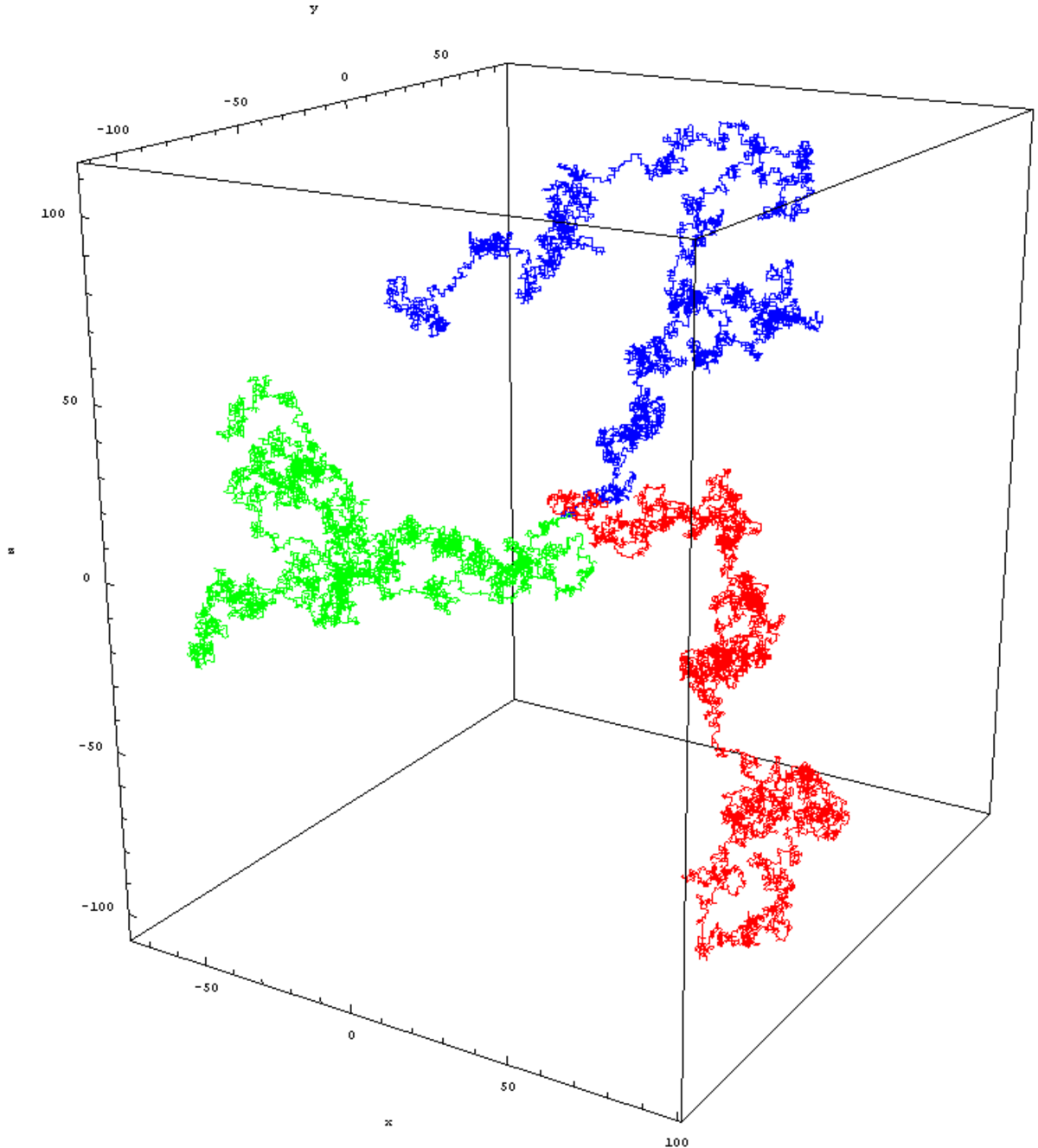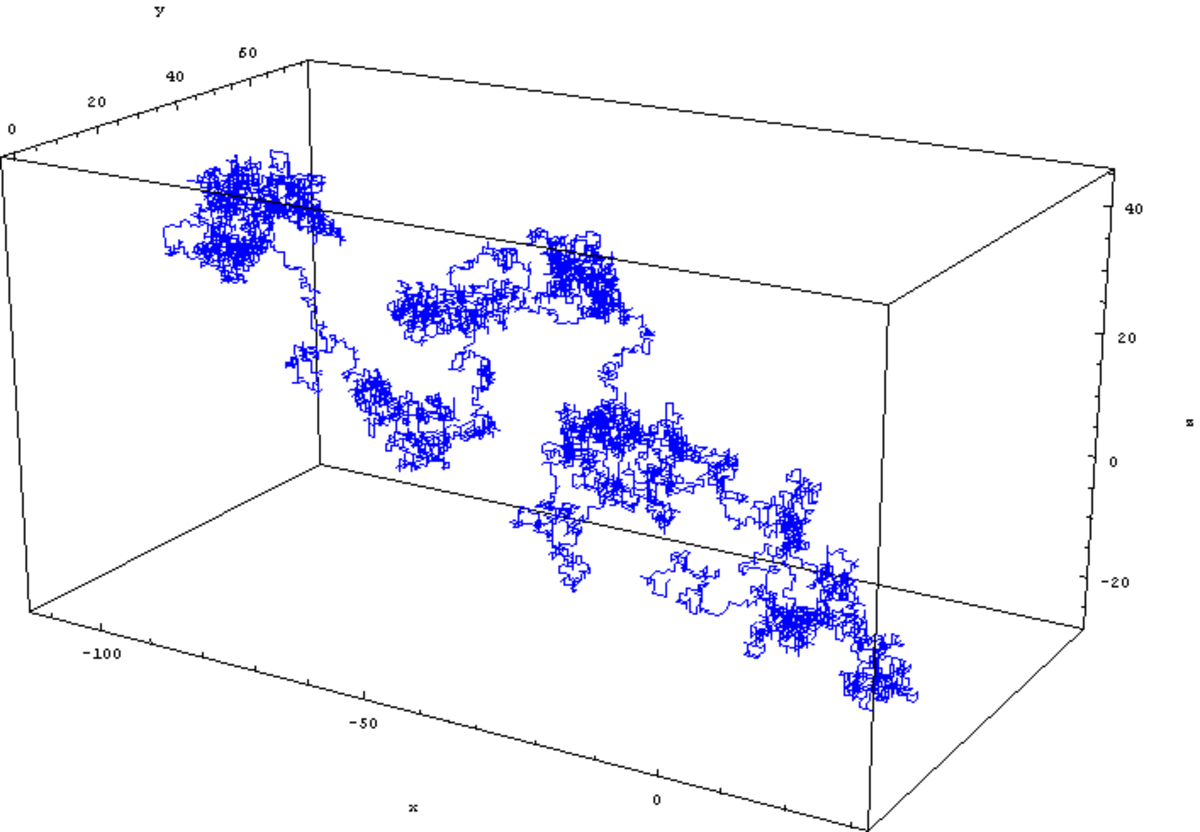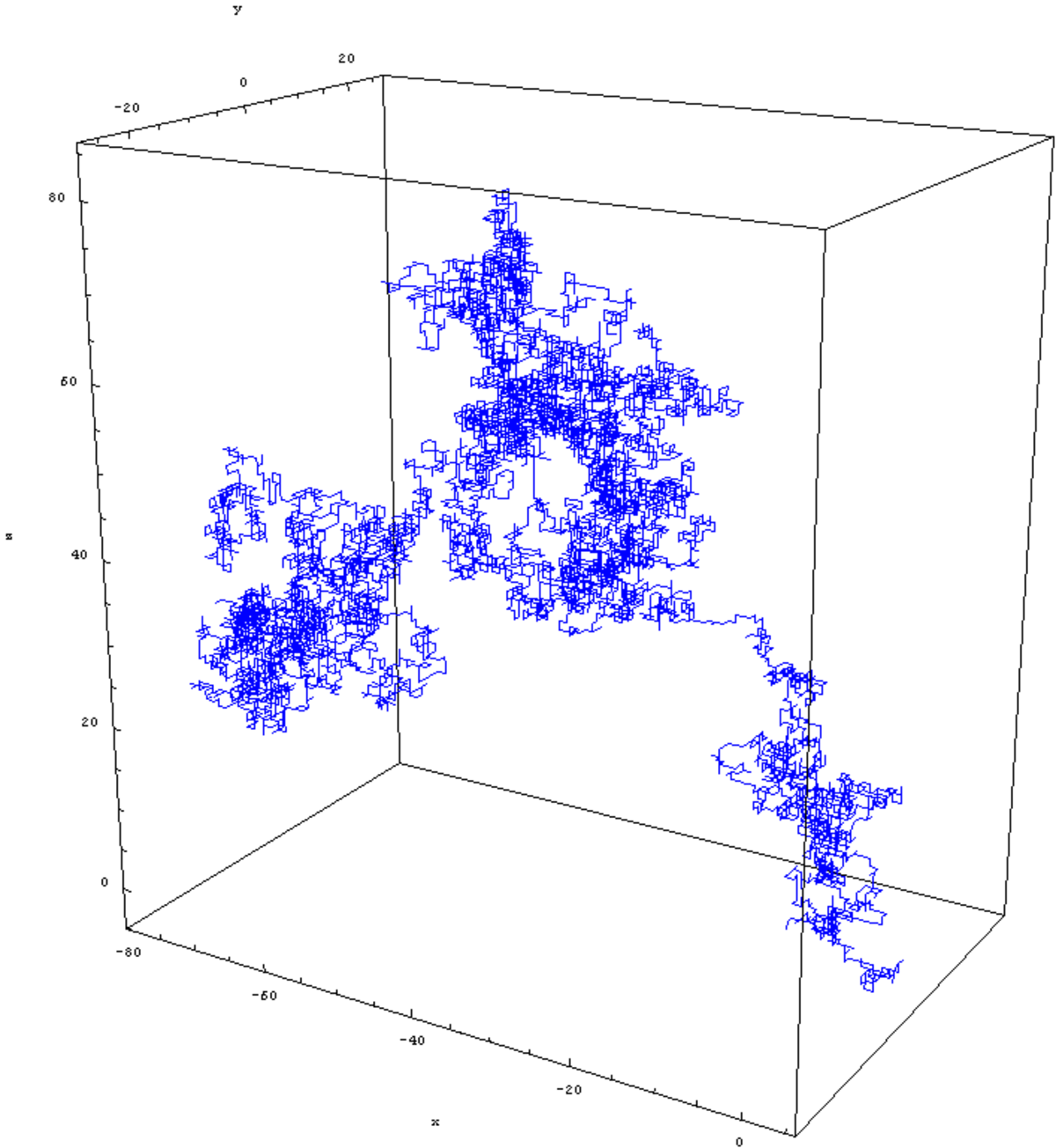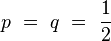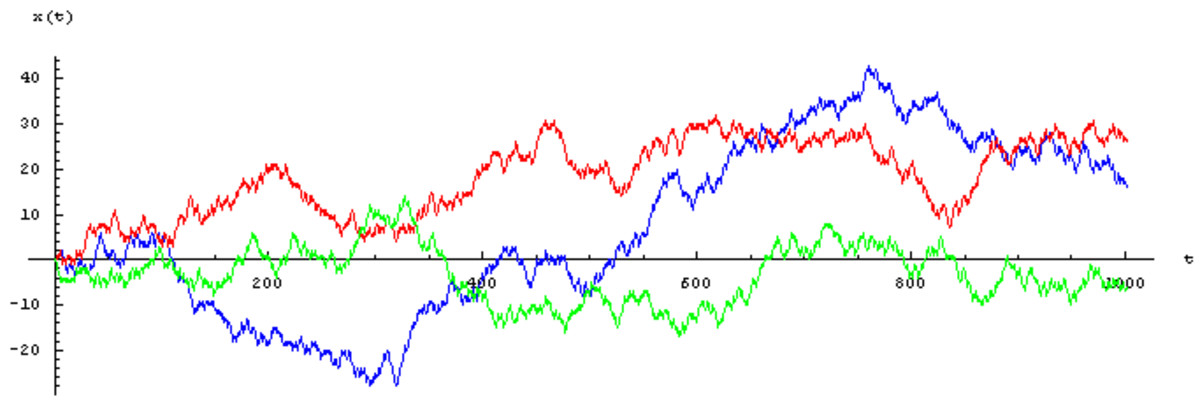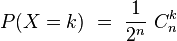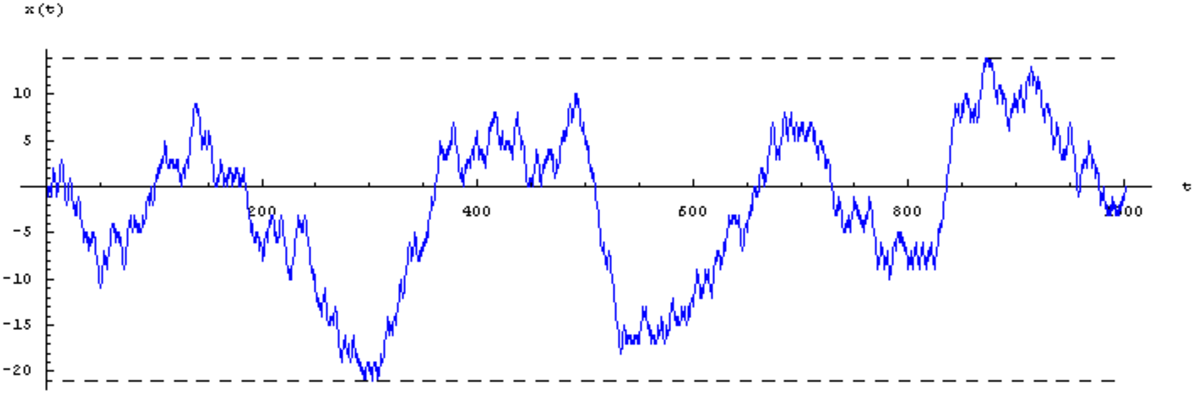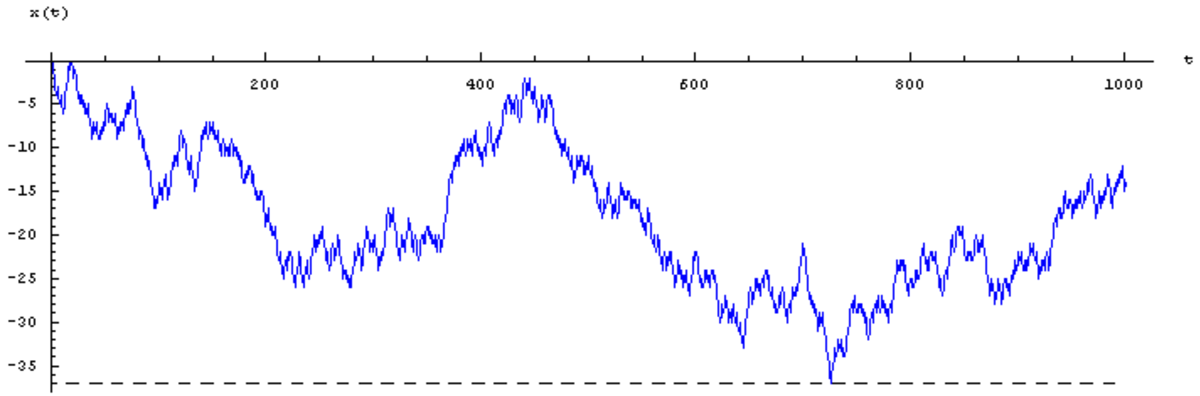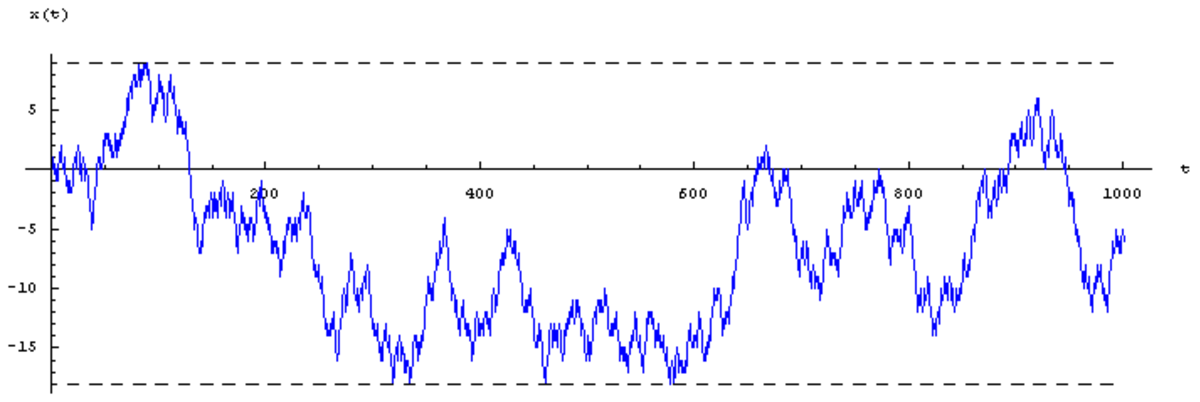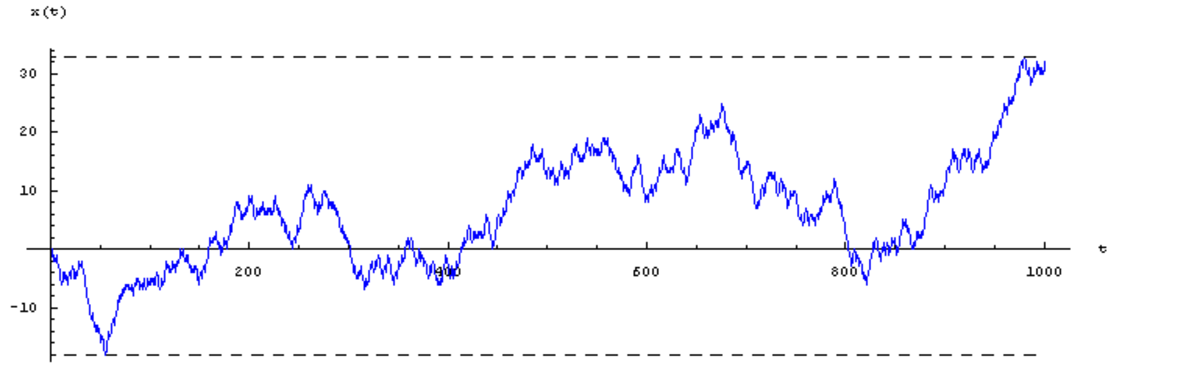Marche aléatoire - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Marche aléatoire isotrope sur un réseau à x dimensions
Deux dimensions
On considère une marche aléatoire sur le réseau plan

Pour des longues marches, la distribution de la position finale du marcheur se comporte asymptotiquement comme une distribution gaussienne. Cette convergence est illustrée ci-dessous : on trace les répartitions des probabilités de présence sur le réseau après 10 pas, puis après 60 pas :
Spécimens
La galerie ci-dessous contient quatre spécimens de marches aléatoires isotropes sur le réseau

Trois dimensions
On considère une marche aléatoire sur le réseau cubique

La figure ci-contre montre un échantillon de trois simulations numériques indépendantes de marches aléatoires pour une particule : on a tracé les trois trajectoires obtenues.
Spécimens
La galerie ci-dessous contient quatre spécimens de marches aléatoires isotropes sur le réseau


| 
|
Projections bidimensionnelles
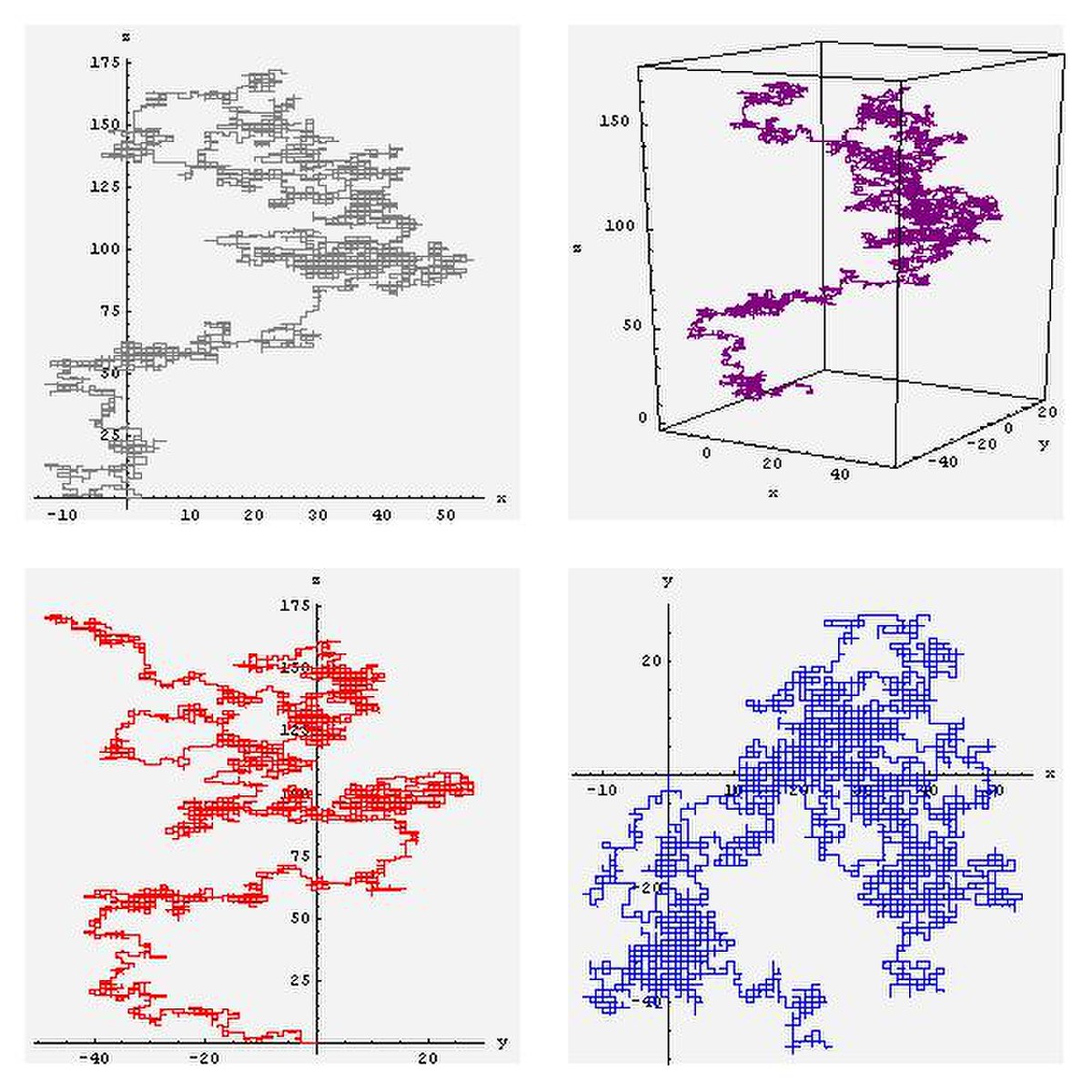
Marche aléatoire discrète à une dimension
Définition
Le modèle de marche aléatoire le plus simple est celui de la marche aléatoire discrète à une dimension sur le réseau périodique

- p représente la probabilité que la particule fasse un saut en avant à chaque instant.
- q = 1 - p représente la probabilité que la particule fasse un saut en arrière à chaque instant.
Le cas le plus simple, qui correspond par exemple au mouvement brownien, consiste à faire l'hypothèse d' isotropie spatiale. Les directions « avant / arrière » de l'espace physique étant a priori équivalentes, on pose l' équiprobabilité :
Il est remarquable que les lois mises en évidence dans ce cas s'étendent à des problèmes de marches aléatoires beaucoup plus complexes.
Marche aléatoire isotrope
Chacun des tirs au hasard pour choisir le mouvement constitue une épreuve de Bernoulli avec issues équiprobables : ici la probabilité de montée ou de descente est 1/2.
La figure ci-contre montre un échantillon de trois simulations numériques indépendantes de marches aléatoires pour une particule : on a tracé les positions successives x(t) de la particule aux instants t = 1, 2, ..., partant de la condition initiale x(0)=0.
Après n pas, le nombre X de fois où on a tiré "pile" suit la loi binomiale B(n,1 / 2), telle que la probabilité vaut :
où

On peut relever la position en prenant la valeur 0 pour la marche initiale, en ajoutant 1 pour chaque pas en avant (pile), en retranchant 1 pour chaque pas en arrière (face). Alors la position Y est donnée par : Y = X - (n-X) = 2X - n. Par rapport à la loi binomiale classique il suffit donc de décaler les résultats de n/2 et de multiplier par 2, ainsi :
- l'espérance est nulle ;
- la variance vaut n et l'écart type

- on a toujours l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev ;
- et la loi des grands nombres.
Concrètement, si on renouvelle l'expérience avec un grand nombre de participants, et si on les laisse évoluer pendant un nombre de pas assez important (de l'ordre de n = 100 par exemple) on s'attend à ce que le nuage des positions finales soit en gros centré sur la marche initiale. Ceci peut être rendu quantitatif : en se plaçant dans le régime asymptotique

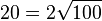
Spécimens
La galerie ci-dessous contient quatre spécimens de marches aléatoires isotropes sur le réseau