Bacillus thuringiensis - Définition
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
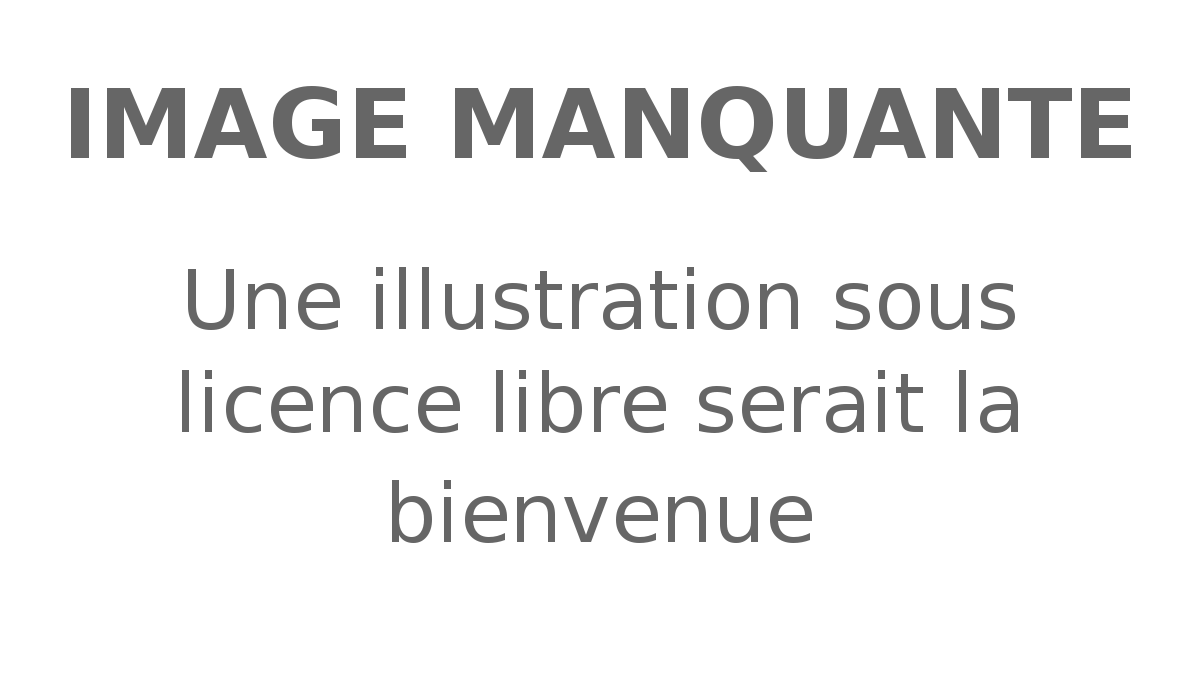
|
|||||||||
| Bacillus thuringiensis | |||||||||
| Classification classique | |||||||||
| Règne | Bacteria | ||||||||
| Embranchement | Firmicutes | ||||||||
| Classe | Bacilli | ||||||||
| Ordre | Bacillales | ||||||||
| Famille | Bacillaceae | ||||||||
| Genre | Bacillus | ||||||||
| Nom binominal | |||||||||
| Bacillus thuringiensis ?Berliner, 1915 |
|||||||||
| Parcourez la biologie sur Wikipédia :
|
|||||||||
Bacillus thuringiensis (abrégé en Bt) est un bacille Gram positif, aérobie et sporulé. On le retrouve dans pratiquement tous les sols, l'eau, l'air et le feuillage des végétaux. Il fait partie d'un groupe de six bacilles, rassemblés sous le terme " groupe Bacillus cereus " : B. anthracis (responsable de la maladie du charbon), B. cereus, B. mycoides, B. pseudomycoides, B. weihenstephanensis et B. thuringiensis.
À l'état végétatif, Bacillus thuringiensis a la forme d'un bâtonnet de 5µm de long sur 1µm de large, et est pourvu de flagelles. Il se distingue des autres bacilles du groupe cereus par sa capacité à synthétiser des cristaux formés de protéines.
Bacillus thuringiensis a été isolé en 1901 par le bactériologiste japonais S. Ishiwata à partir de vers à soie. La première description scientifique est dûe à l'allemand E. Berliner en 1911.
Dans sa forme sporulée, Bacillus thuringiensis produit un corps cristallin, formé de multiples protéines. On connaît actuellement plus de 14 gènes codant pour ces protéines. Ces dernières ont une propriété insecticide sur les lépidoptères, les coléoptères et/ou les diptères. Elles agissent en détruisant les cellules de l'intestin moyen de la larve d'insecte atteint par ces toxines, ce qui aboutit à la mort de l'insecte.
Cette propriété entomotoxique de Bacillus thuringiensis en fait tout l'intérêt commercial. Les premières applications de Bacillus thuringiensis dans l'environnement datent de 1933. Il a été utilisé dès les années 1950 dans les forêts, les champs et les vignobles. Jusqu'au milieu des années 1970, sa principale application était l'éradication des lépidoptères dans les forêts et les grandes cultures. En 1976, la découverte des sérotypes israelensis (Bti) et tenebrionis a permis l'ouverture de nouveaux marchés, grâce à une action larvicide sur les moustiques, les simulies et les coléoptères.
Les toxines de Bt (protéine cristalline) sont très sensibles aux rayons ultraviolets qui les dégradent, ce qui permet à ce produit d'avoir une faible rémanence sur les feuilles (moindre dans le sol). Ce produit, étant d'origine naturelle, est autorisé en agriculture bio.
L'industrie des biotechnologies a produit des plantes transgéniques modifiées par ajout d'un ou plusieurs des gènes codant pour les toxines de Bacillus thuringiensis. Elles en produisent dans leurs tissus aériens, mais également dans la sphère racinaire où le Bt peut s'accumuler plus longtemps dans le sol. Certains chercheurs craignent que ce Bt finisse pas poser problème : toxicité du sol contaminé, accumulation dans les sédiments de fleuves (on en a trouvé dans le fleuve Saint-Laurent)























































