Binaire X - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Masses et luminosités
Les masses ou fonctions de masses peuvent éventuellement être calculées de plusieurs manières différentes suivant les caractéristiques de la binaire X :
- pour les sources émettant un signal périodique, cf. binaire TTL quant à la manière d'obtenir une indication de la masse. C'est le cas par exemple des étoiles à neutrons dont l'axe magnétique n'est pas aligné avec l'axe de rotation, causant une modulation périodique dans l'observation du flux X ;
- pour les autres, la spectroscopie dans l'optique ou l'infrarouge peut permettre d'obtenir la vitesse radiale, et c'est le cas de Cygnus X-1 (Steegs and Casares 2002), voir binaire spectroscopique pour la méthode permettant d'obtenir une estimation de la masse ;
- quand la période orbitale est courte, la probabilité que l'on puisse observer des éclipses est augmentée, voir binaire à éclipses.
Les estimations de la masse sont néanmoins plus compliquées que pour les binaires normales (corrections relativistes, changements de période, etc). Ces déterminations de masse sont cependant importantes car elles fournissent une des seules méthodes pour peser un trou noir stellaire.
Dans le cadre d'une LMXB, la luminosité d'accrétion est
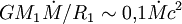

Certaines des binaires X peuvent atteindre la luminosité d'Eddington, valeur limite à laquelle la pression de radiation limite l'accrétion de matière pour une étoile d'une masse solaire.
Classification
En dehors du type de l'objet compact primaire (étoile à neutrons / trou noir), la principale classification observationnelle est basée sur la masse du compagnon stellaire, telle qu'on peut l'estimer soit par la fonction de masse mesurée, soit via le type spectral du compagnon, soit par similarité du rayonnement X avec un autre couple connu :
- si l'étoile « normale » est de masse comparable ou plus petite que celle du soleil, on parle de binaire X à faible masse (low-mass X-ray binary, LMXB). On les trouve préférentiellement dans le bulbe galactique et dans des amas globulaires ;
- si l'étoile a une masse supérieure à 5 masses solaires environ, on parle de binaire X à forte masse (high-mass X-ray binary, HMXB). Population plus jeune, on les trouve dans les bras spiraux. Les périodes orbitales sont plutôt longues (1-200 jours).
On rencontre également les types suivants :
- sursauteur X : dont l'origine pourrait provenir d'explosions thermonucléaires sur la surface de l’objet compact, montrant que l'on a affaire à une étoile à neutrons et non à un trou noir
- nova X ou sources transitoires X molles (SXT) : le nom provient du fait que la courbe de lumière est similaire à celle d'une nova dans le domaine optique, avec des longues phases calmes entrecoupées de phases actives ;
- microquasar : on observe des jets de matière éjectés à une vitesse proche de celle de la lumière.
Bibliographie
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « X-ray binary »
- Bowyer, S., Byram, E. T., Chubb, T. A., Friedman, M., 1965, Science, 147, 394
- Encyclopedia Astronautica: Aerobee 150
- Giacconi R., Gursky H., Paolini F. R., Evidence for X rays from sources outside the solar system, Physical Review Letters, 9, 1962, p. 432
- Hameury J-M., Binaires semi-détachées : taxonomie, Ecole de Goutelas #23, 2000, [1]
- Herrero et al., A spectroscopic analysis of HDE 226868 and the mass of Cygnus X-1, Astronomy and Astrophysics, 297, 1995, p.556
- Steeghs D. and Casares J., The Mass Donor of Scorpius X-1 Revealed, Astrophysical Journal, 568, 2002, p. 273
- Zeldovich Ya. B., Guseynov O. H., Collapsed Stars in Binaries, Astrophysical Journal, 144, 1966, p.840
Ouvrages généraux:
- Tauris T. M., van den Heuvel E., Formation and Evolution of Compact Stellar X-ray Sources dans Compact Stellar X-Ray Sources, Cambridge University Press, 2006, ISBN 0521826594, astro-ph/0303456 (2003)
- X-ray Binaries, édité par Lewin Walter H. G., van Paradijs Jan et van den Heuvel Edward P. J. , Cambridge University Press, Janvier 1997, ISBN 0521599342
- Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics: X-Ray Astronomy, X-Ray Binary Stars

















































