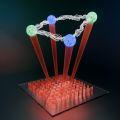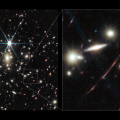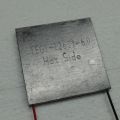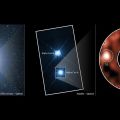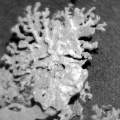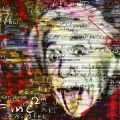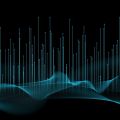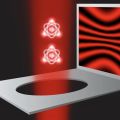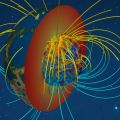Éducation populaire - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Contexte politique
Du point de vue du militant ouvrier on a pu résumer l'histoire de l'éducation populaire en cinq temps afin de mieux la situer dans le contexte actuel de ce début du XXIe siècle :
- l'éducation populaire comme dimension culturelle du mouvement ouvrier
- l'éducation populaire comme branche spécialisée du mouvement ouvrier
- l'institutionnalisation dans l'appareil d'État
- fonctionnalisation dans l'animation socioculturelle
- développement local, social, culturel.
Les deux premiers temps font partie de l'origine de l'éducation populaire, le temps mythique où elle était la dimension culturelle de la production de l'action collective. C'est la définition primitive de l'éducation populaire. C'est-à-dire la production collective de connaissances, de représentations culturelles, de signes qui sont propres à un groupe social en conflit.
À l'origine l'éducation populaire est une dimension du syndicalisme à une époque où le syndicalisme est en même temps mutualisme et coopération. Dans l'histoire du mouvement ouvrier, cela correspond à la deuxième moitié du XIXe siècle. Il fallait produire une analyse de ce qui se passe et produire bien sûr un contre projet par rapport à ce qui se passe. Cette dimension est encore présente dans une partie des mouvements se réclamant de l'éducation populaire, par exemple ATTAC.
Puis avec l'entre-deux-guerres, on assiste à une spécialisation (associations spécialisées dans la culture comme les ciné-clubs, ou dans les loisirs, les vacances).
Dans cette optique réductrice, l'action des laïcs "bourgeois" (Jean Macé) ou des chrétiens, protestants et catholiques, est marginalisée, de même la crise du monde ouvrier qui est passée sous silence. Par ailleurs au début du XXIe siècle l'éducation populaire se réduit à des structures administratives pourvoyeuses de subventions et de détachements administratifs, à des réseaux militants mal coordonnés ou antagonistes et à quelques colloques. À côté subsiste une masse d'associations nées de l'E.P ou auparavant rattachées à elle qui aujourd'hui fonctionnent en autonomie dans les domaines du loisir, de l'éducation, de la culture dans une ambiance quasi commerciale mais dont l'action militante est nulle.
Institutionnalisation
Ce mouvement découle après la guerre sur une institutionnalisation des mouvements qui est un moment beaucoup plus ambivalent qu'il n'y paraît. Traumatisés par l'impuissance des valeurs républicaines et de l'instruction transmise à l'école à enrayer le fascisme, les refondateurs de l'éducation nationale décident de créer une direction de l'éducation politique, des jeunes et des adultes, et d'en confier la pédagogie non pas à des enseignants mais à des acteurs culturels.
Cette institutionnalisation va conduire à ce que l'on pourra appeler la fonctionnalisation, qui va évidemment culminer dans le projet d'une animation socioculturelle. Quand on parle « d'animation socioculturelle », il est devenu à ce moment-là presque clair qu'il y a des sujets qui animent des objets. On a presque fini la boucle : on est parti d'une démarche historique de sujets qui parlent, se parlent entre eux, et on en arrive à des agents qui animent des objets sociaux à qui ils proposent différentes procédures de consommation culturelle.
On doit aussi s'interroger si l'affirmation d'une complémentarité avec l'Éducation Nationale, celle-ci étant posée comme référence pédagogique, n'a pas été stérilisante.
Le ministère de la culture
On peut parler de « la dérive culturaliste » de l'éducation populaire. On désigne des objets artistiques à diffuser - ce que le ministère de la Culture réserve à l'éducation populaire, rebaptisée par ses soins « culture de proximité ». C'est l'idée de la démocratisation culturelle, incarnée par Malraux. Si les théories de Malraux marchaient, dira Pierre Bourdieu, les gardiens de musée seraient des gens follement cultivés. Le projet d'un ministère de la culture, rêvé par les premiers instructeurs d'éducation populaire a vu le jour en 1959 au détriment de l'éducation populaire, d'abord intégrée au ministère Malraux puis rejetés en 1962 vers celui de la jeunesse et des sports.
L'arrivée de la gauche au pouvoir et la création d'un ministère du temps libre, la présence de Jack Lang au ministère de la Culture vont vite décevoir et laisser l'éducation populaire dans la seule animation socioculturelle. La politique culturelle de l’État se concentre au service exclusif des créateurs. Il s'agit au mieux de promouvoir la qualité artistique des œuvres, au pire de servir les intérêts des corporations d'artistes. La diffusion de la culture au plus grand nombre n'est plus une priorité. En se réconciliant avec l'économie, la culture perd son rôle subversif pour redevenir un privilège d'initiés.
Mutations de l'économie de la culture
Pendant ce temps les politiques et l'animation socioculturelle se transforment en travail social de réparation, et comme les crédits se déplacent par ailleurs de la culture vers le social, parfois par l'intermédiaire de la ville, pourquoi ne pas reconvertir l'éducation populaire tout simplement dans l'insertion socioprofessionnelle puisque à la fois manifestement il y a des gens à secourir et des fonds pour les secourir.
Cependant sans projet politique cela a contraint des associations se réclamant de l'éducation populaire à s'arrêter car l'insertion comme activité n'est pas une fin en soi. D'acteurs ces structures sont devenues agents, les mots « marché de l'éducatif », « marché du social », « marché de la culture » entrent dans le vocabulaire commun. Ainsi la libéralisation et la mondialisation conduit aujourd'hui des organismes comme l'OCDE ou l'OMC sous la pression des multinationales, à vouloir plus de privatisation, notamment dans le domaine des services publics, car il y a un gisement financier et donc des profits potentiels. La marchandisation du monde se met en place.
L'enjeu de l'éducation populaire est donc là en ce début de siècle :repenser un projet politique indépendant afin de réaffirmer son rôle, sa place dans la société, non pas en tant qu'agent d'une politique publique mais en tant qu'acteur de la société.