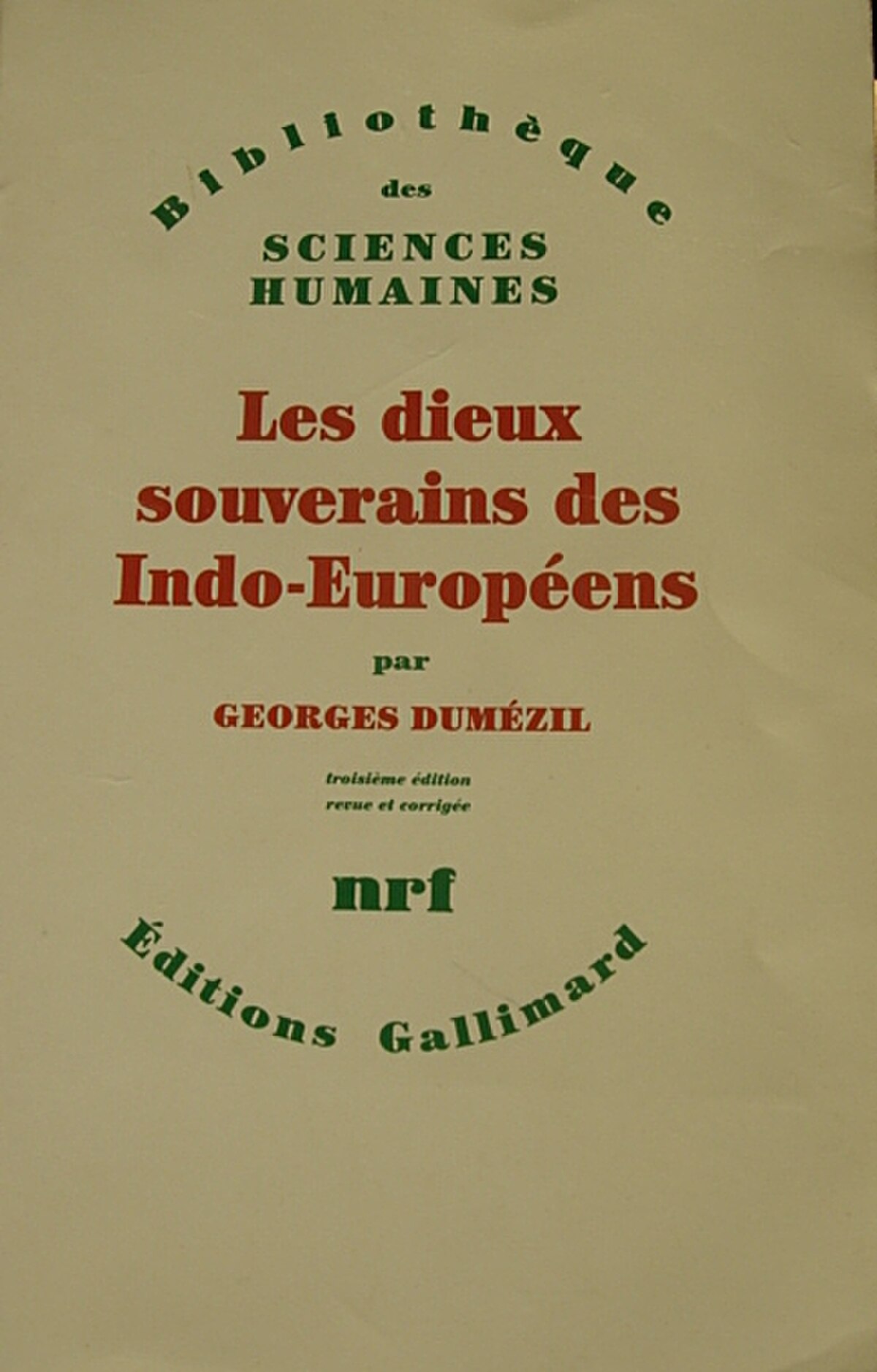Georges Dumézil - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Legs aux sciences humaines
La trifonctionnalité dumézilienne, si elle a eu un impact très important sur les études indo-européennes, demeure encore l'objet de controverses : certains la considèrent comme un mythe de plus ajouté aux autres mythes, un « métamythe » en quelque sorte.
Ses méthodes de travail ont néanmoins considérablement influencé l'ensemble d'une discipline, l'étude des religions antiques : il a changé la manière de les étudier, en créant l'étude comparée des mythologies, également en montrant que les divinités n'existaient pas pour elles-mêmes, et qu'il fallait faire porter les études sur les paires ou les groupes de dieux (tels qu'ils étaient célébrés dans les récits mythiques). Toutes ses analyses portent sur la structure des mythes et des récits, ne rapprochent jamais des faits isolés.
Il est donc le créateur d'une nouvelle discipline, et a dû tâtonner, élaborer une méthodologie : ainsi a-t-il été jusqu'à renier l'intégralité de son œuvre antérieure à 1938 (que certains de ses adversaires continuent pourtant à critiquer).
La méthode Dumézil a fait des émules, en particulier l'historien Georges Duby, qui a mis en évidence la continuité des trois fonctions au Moyen Âge dans Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme (1978) et Le Chevalier, la Femme et le Prêtre (1981). Le philosophe Michel Foucault, qui a bénéficié du patronage de Dumézil, s'est inspiré de ses recherches dans ses premiers travaux. C'est l'anthropologue Claude Lévi-Strauss qui a prononcé son discours de réception à l'Académie française.
Un certain nombre d'universitaires défendent Dumézil ou reprennent ses thèmes de prédilection, parmi lesquels l'indianiste suédois Stig Wikander (1908-1983), le spécialiste du monde celtique Christian-J. Guyonvarc'h, l'indianiste français Louis Renou, le linguiste et mythologue néerlandais Jan De Vries (1890-1964), le linguiste français Émile Benveniste et, plus récemment, l'historien Bernard Sergent, auteur d’ouvrages fondamentaux (Les Indo-Européens, Homosexualité et Initiation chez les peuples indo-européens, etc.), qui approfondissent des aspects particuliers de l’œuvre de Dumézil. Il n'y a cependant pas d'« école dumézilienne », puisque Dumézil n'a jamais été le directeur de thèse d'un doctorant.
Les indianistes Jean Naudou, Nick J. Allen, d'Oxford, et Daniel Dubuisson admettent l'utilité des thèses trifonctionnelles dans leur domaine, tout comme Émilia Masson dans le sien, les Hittites.
Michel Poitevin a souligné l'intérêt philosophique de l'œuvre de Dumézil, qui incite à réfléchir sur les structures symboliques de l'esprit humain.
Travaux de mythologie comparée : la théorie de la trifonctionnalité
Dès sa thèse, il trouve son domaine de recherches : la mythologie comparée. Au départ, poussé dans cette direction par Antoine Meillet, qui veut le voir reprendre l'étude de la religion indo-européenne là où elle a été abandonnée depuis plusieurs décennies, il est abandonné par ses pairs philologues qui lui reprochent, pour les uns, d'inclure trop de mythologie dans des études littéraires et, pour les autres, de plier les faits à sa théorie.
Sa découverte de la culture ossète (dernière branche survivante des Alains, descendants eux-mêmes des Scythes) lui fait reprendre cette voie de recherche. En effet, ceux-ci se projettent dans le peuple mythique des Nartes. Ce monde mythique des Nartes est très proche des mondes mythiques indo-européens (les monstres et les dragons y sont similaires). De plus, ce peuple des Nartes se divise explicitement en trois familles :
- ceux qui sont forts par l'intelligence (zund), les Alægatæ ;
- ceux qui sont forts par le courage et la vaillance au combat, les Æxsærtægkatæ ;
- ceux qui sont riches de leur bétail : les Boratæ.
Il publie en 1930 un article, La Préhistoire indo-iranienne des castes, où il rapproche la division en trois catégories de la société en Inde de celle retrouvée en Iran ancien. On peut d'ailleurs remarquer que l'Iran actuel est le seul pays musulman doté d'un clergé.
En 1938, le rapprochement raisonné entre brahmanes indiens et flamines romains lui permet d'analyser la fonction du souverain dans les sociétés indo-européennes. Il joint les rapprochements déjà faits entre sociétés indiennes et iraniennes anciennes à l'observation des flamines, collège de prêtres romains. Les flamines majeurs assuraient le culte des trois dieux Jupiter, Mars et Quirinus, dont les caractères correspondent aux trois fonctions de commandement et de sacré, de force guerrière et de fécondité. La fonction de souveraineté se décompose, elle, en deux versants selon ses termes :
- l'un est formel, d'origine sacerdotale, s'exprime également dans une dimension juridique et est enraciné dans ce monde ;
- l'autre aspect de la souveraineté est fondé sur la puissance et enraciné dans l'autre monde.
En poussant ses raisonnements, il découvre la clef d'or qui le conduit à exposer, dans son livre le plus aisé d'accès, Jupiter Mars Quirinus (1941), la théorie des trois fonctions (souveraineté et religion, guerre, production), tripartition qui se retrouve dans le vocabulaire, l'organisation sociale et le corpus légendaire de tous les peuples indo-européens : on a la société médiévale, par exemple, divisée en oratores (ceux qui prient, le clergé), bellatores (ceux qui combattent, la noblesse) et laboratores (ceux qui travaillent, le tiers état), ou la société indienne, divisée en brahmanes (prêtres, enseignants et professeurs), kshatriyas (roi, princes, administrateurs et soldats), plus la caste productive, se subdivisant en vaisyas (artisans, commerçants, hommes d'affaires, agriculteurs et bergers) et shoûdras (serviteurs). Dans cette société, les prolongements sont plus importants encore : dans le grand poème épique indien Mahabharata, chaque héros agit selon le schéma trifonctionnel, en fonction du caractère et de la place du dieu dont il est le représentant.
Dumézil montre ensuite que l'histoire officielle des origines de Rome est une mise en scène de cette même idéologie structurante. Par conséquent, il serait vain de chercher à démêler légende et histoire à propos de Romulus et de ses successeurs.