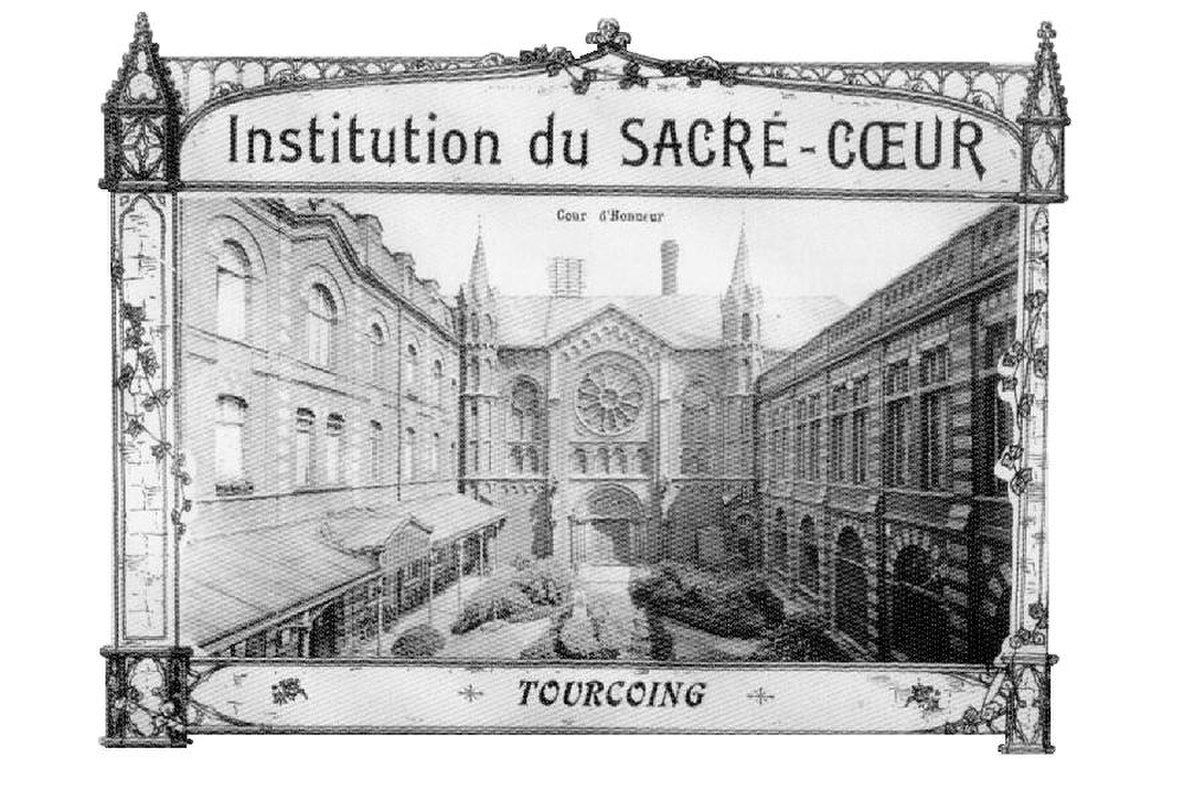Henri Leblanc - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Le collège de Tourcoing impliqué dans l'unification italienne et la fin des États pontificaux
Durant le Second Empire (1852-1870), l'aide apporté par la France à l'unification italienne divise les catholiques français qui voient avec appréhension la claire volonté du Piémont-Sardaigne d'annexer les États pontificaux et de faire de Rome la capitale du nouveau Royaume d'Italie.

Pour Leblanc, l'attitude de la France est empreinte d'hypocrisie parce que d'une part, il y a soutien militaire aux forces piémontaises qui ne cachent pas leur objectif de conquérir Rome en symbole d'apothéose de l'unification italienne, et d'autre part, Napoléon III fait stationner des troupes autour de la Ville Éternelle pour dissuader les Italiens de tenter une action contre le Pape.
Ce qui n'empêche pas les Italiens de s'attaquer aux régions périphériques des États Pontificaux, comme la Romagne et les Marches : des volontaires de tous les pays s'engagent dans les armées du Pape Pie IX, qui n'entend pas se laisser déposséder du Patrimoine de Saint-Pierre sans combattre.
C'est ainsi qu'un jeune professeur du Collège, Henry Wyart, âgé d'une vingtaine d'années, et qui hésitait sur sa vocation religieuse, partit pour Rome avec la bénédiction deLeblanc et intégra le bataillon des Zouaves Pontificaux, sous les ordres du général de Lamoricière. Son exemple fut suivi par plusieurs dizaines d'anciens élèves et de professeurs du Collège. Leur conduite valeureuse fit grand honneur à l'établissement, notamment à la bataille de Castelfidardo où les troupes pontificales internationales se battirent avec courage contre l'écrasante supériorité numérique italienne.
Cette épopée, toute relative qu'elle soit, souleva l'enthousiasme parmi les élèves du Collège qui écrivirent une lettre de soutien et de fidélité au Pape. L'abbé céda à l'enthousiasme et partit pour Rome avec deux autres professeurs ecclésiastiques porter sa supplique au Souverain Pontife. Henry Wyart obtint une audience privée avec Pie IX et celui-ci, heureusement surpris, remercia l'abbé et écrivit immédiatement une réponse courte et chaleureuse, qu'il concluait par ces mots :
"Timete Dominum et Nihil Aliud", "Craignez le Seigneur et rien d'autre".
Cette formule devint la devise du Collège de Tourcoing, tandis que, de retour chez lui, l'abbé Leblanc consacrait l'établissement au Sacré-Cœur de Jésus.
L'aventure d'Italie prit fin lorsque Rome tomba entre les mains des Italiens : le Pape licencia alors ses chers zouaves qui retournèrent chez eux amers de la défaite mais couverts de gloire, dans une France vaincue et humiliée par la guerre de 1870.
Quant à Henry Wyart, il resta à Rome auprès du pape Pie IX qui l'ordonna prêtre en 1871, avant de l'envoyer comme frère trappiste à l'Abbaye du Mont des Cats.
Le supérieur de l'Institution Libre du Sacré-Cœur
Le Collège Communal de Tourcoing était officiellement dissous. Cependant, l'abbé Leblanc avait déjà fait les démarches nécessaires pour créer une Institution Libre, selon la loi Falloux de 1850.
La survie de l'établissement, voué à la fermeture, fut possible grâce à son patrimoine : en effet, la Ville de Tourcoing avait pu récupérer le mobilier et le matériel scolaire du Collège mais pas les bâtiments ni le terrain. Ces derniers n'appartenaient pas à la commune mais à la Société Anonyme de Saint-Charles.
Il faut remonter 29 ans en arrière pour comprendre cette originalité. Quand, en 1853, le Collège s'installa au 111, rue de Lille, le directeur de l'époque, l'abbé Albert Lecomte, soucieux d'épargner des dépenses supplémentaires à l'établissement, fit l'acquisition du terrain et des bâtiments sur ses propres deniers et devint ainsi le propriétaire du terrain. Cet homme intègre et désintéressé, qui avait déjà tant fait pour le Collège, ne réclama jamais aucun remboursement et, à son départ en 1856, céda la propriété des terrains et bâtiments à une association diocésaine qu'il avait créé, la Société de Saint-Charles. Cette société louait son patrimoine au Collège Communal de Tourcoing en échange d'un loyer annuel très réduit.
Quand Leblanc se trouva privé des moyens financiers et matériels jusque-là fournis par la Ville et l'Université, la Société de Saint-Charles, gérée par un grand nombre de ses anciens élèves, vint lui assurer que "jamais [leur] chère vieille école ne serait sans logis". La nouvelle Institution Libre avait un toit.
Quant à l'autorisation officielle pour la réouverture de l'école sous le nouveau vocable Institution Libre du Sacré-Cœur, les autorités publiques ne firent pas de difficulté et souhaitèrent même un vif succès au directeur, écrivant que Mr Leblanc a toutes les qualités pour faire prospérer ce genre d'établissement". Dernière preuve cependant d'une rancune tenace, on lui supprime sans explication ses droits à la pension de retraite après vingt-cinq ans passé à la tête du Collège Communal.
L'abbé Leblanc crée également à cette occasion l'Association des Anciens Élèves (1882) pour le soutenir dans son action : celle-ci contribue pour une large part à l'achat du matériel et du mobilier nécessaires à l'école, car l'ancien mobilier est repris par la municipalité en juillet 1882.
Finalement, la rentrée des classes a bien lieu le 5 octobre 1882. Les trois années qui suivent sont calmes et relativement prospères ; Leblanc s'attelle à la rédaction de son livre, Le Collège Communal de Tourcoing sous les vingt-cinq dernières années du régime universitaire, ouvrage dont l'une des motivations principales fut la "volonté de faire la lumière sur toute cette affaire de la rupture entre le Collège et la Ville".
Cependant, l'établissement étant une Institution Libre complètement en dehors de la hiérarchie universitaire et les frais de scolarité devant être assumés par les seuls parents d'élèves, on peut regretter que le Sacré-Cœur soit devenu une école réservée à la haute bourgeoisie et aux classes aisées, qui formaient la quasi-intégralité des élèves, mis à part quelques très peu nombreux boursiers.
C'est en 1885, alors que son livre passe sous presse, qu'un désastre vient frapper l'Institution. Après deux tentatives infructueuses déjouées par la vigilance des surveillants, un incendie d'origine criminelle dévaste l'école, à l'exception de la Grande Chapelle. Réveillés en pleine nuit, les internes et les professeurs évacuent à temps les dortoirs et on ne déplore heureusement aucune victime. Les dégâts matériels sont, par contre, immenses : il faudra quinze ans de travaux et le soutien sans faille des Anciens Élèves pour que l'Institution soit entièrement reconstruite.
Cet incendie est en fait la troisième tentative de départ de feu criminel commise en quelques mois sur l'établissement : les précédentes avaient été déjouées par la vigilance des surveillants ; la nuit du sinistre, un individu inconnu fut même aperçu par certains élèves, fuyant par les toits (là où a commencé le feu). Le coupable de cet acte qui aurait pu tuer 20 professeurs et près de 200 internes n'a jamais identifié.
Les seize dernières années de supériorat d'Henri-Leblanc sont paisibles et verront le nombre d'élèves s'accroître sans cesse et la réputation de l'établissement grandir à une échelle régionale.