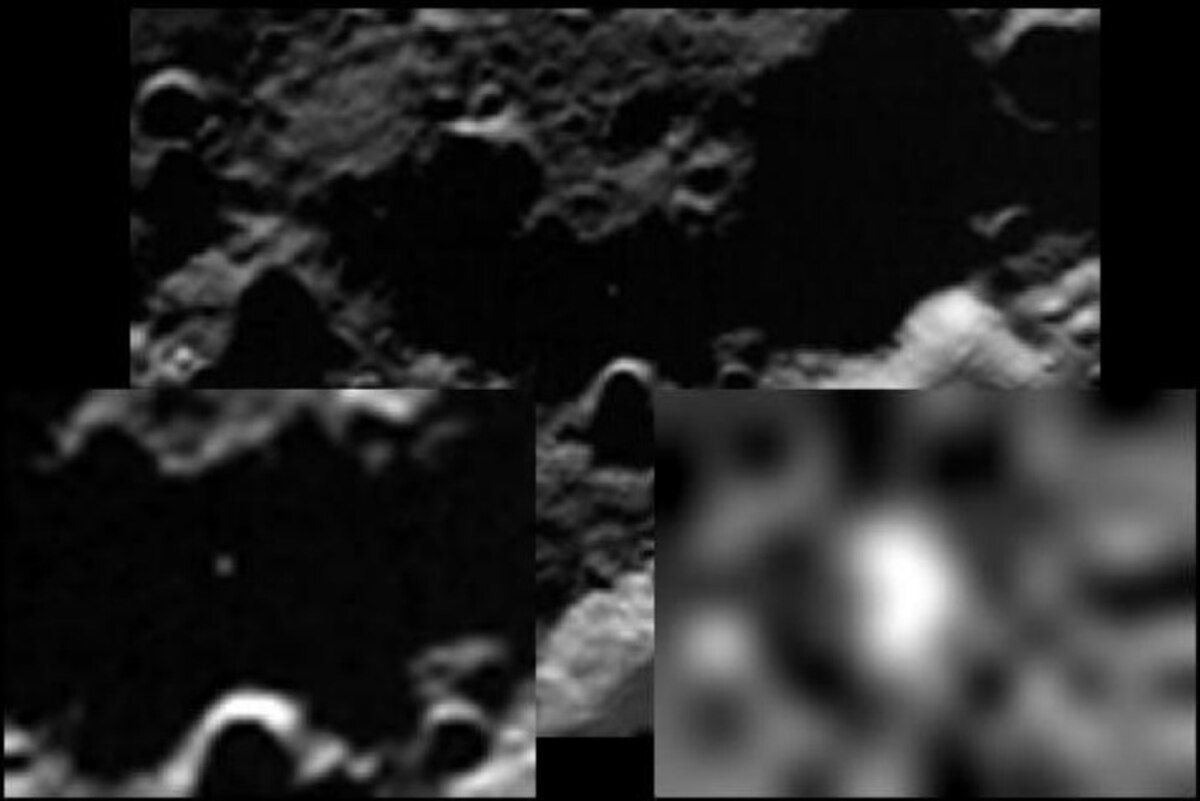Lunar Crater Observation and Sensing Satellite - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Objectifs de la mission
La sonde LCROSS doit permettre de confirmer ou d'infirmer la présence d'eau grâce à ses instruments en analysant les matériaux soulevés par la collision d'un étage de sa fusée porteuse avec le sol lunaire dans la zone polaire où des traces d'hydrogène ont été détectés.
Les objectifs de la mission de LCROSS sont :
- Confirmer la présence ou l'absence d'eau sous forme de glace dans les régions de la Lune situées en permanence à l'ombre.
- Identifier l'origine des traces d'hydrogène détectées au niveau des pôles lunaires.
- Déterminer la quantité d'eau présente dans le sol lunaire.
- Déterminer la composition du régolithe dans un des cratères situés dans la zone en permanence à l'ombre.
Résultats
Après analyse des données recueillies par différentes sondes lunaires et par les observatoires terrestres et évaluation par les spécialistes de la Lune, la NASA a sélectionné le 11 septembre 2009 le cratère Cabeus A près du Pôle Sud lunaire comme cible pour la sonde LCROSS.
L'impact n'a pas créé le panache visible attendu. La caméra infrarouge embarquée a, par contre, bien repéré le cratère créé par l'écrasement de l'étage Centaur sur le sol lunaire. Le responsable du projet, Dan Andrews, estime que les simulations effectuées avant l'écrasement de LCROSS exagéraient l'importance du panache créé par LCROSS (certaines d'entre elles n'avaient pas été faites par la NASA). Il est possible également que les conditions d'éclairage n'aient pas été favorables à la mise en évidence du panache ce qui pourrait être en partie résolu en retraitant les photos effectuées. La profondeur du cratère Cabeus était peut-être également trop importante : cela devrait être confirmé par l'instrument d'altimétrie laser embarqué par Chandrayaan-1 ou Kaguya. Le co-investigateur du télescope spatial Hubble Alex Storrs a déclaré : « les premières analyses du spectre fourni par l'instrument STIS ne font apparaître aucune trace évidente d'hydroxyle mais les dépouillements ne sont pas achevés.».
Le 13 novembre, la NASA annonce que la présence d'eau a été détectée dans les éjectas (confirmée entre autres par la présence d'hydroxyle, molécule formée à partir de l'eau), en quantité et distribution restant à déterminer par des analyses plus poussées.
Déroulement de la mission
Après son lancement la sonde LCROSS (le berger) reste solidaire du dernier étage de la fusée Centaur car ce dernier joue un rôle essentiel dans la mission. L'ensemble est injecté sur une orbite qui lui fait survoler la Lune au bout de 4 jours. Lors de ce survol par effet de fronde gravitationnelle, cette trajectoire est transformée en une orbite polaire très allongée autour de la terre de 36 jours de périodicité. Après trois orbites, l'ensemble doit percuter la Lune près du pôle sud, au niveau du cratère Cabeus, le 9 octobre 2009 à 11 h 30 UTC, 13 h 30 heure française métropolitaine, à ± 30 mn.
La sonde et l'étage Centaur se séparent environ 9 heures et 40 minutes avant l'impact à une distance de 87 000 km de la surface de la Lune. Après la séparation, la sonde se retourne de 180° pour que ses instruments soient face au sol lunaire et réduit sa vitesse pour s'écarter du corps de la fusée afin de ne s'écraser que 4 minutes après l'étage Centaur.
Le lieu visé est un cratère situé en permanence à l'ombre dans la région du pôle sud lunaire. Son emplacement exact sera déterminé 30 jours avant l'impact. Pour remplir sa mission la sonde doit s'écraser à moins de 10 km du point visé mais les concepteurs pensent atteindre une précision d'un kilomètre.
Au moment de l'impact les deux engins ont une vitesse de 2,5 km/s et leur trajectoire fait un angle compris entre 60 et 70° avec le sol lunaire. L'étage Centaur pèse environ 2,3 tonnes tandis que la sonde devrait peser entre 621 et 866 kg. En s'écrasant l'étage Centaur devrait soulever une masse de 350 m³ de matériau lunaire en créant un cratère de 28 mètres de diamètre et de 6,5 mètres de profondeur. La sonde LCROSS traverse les débris soulevés, les analyse avec ses instruments et retourne les informations à la station de contrôle à Terre avant de s'écraser elle-même. Ce deuxième impact devrait soulever 150 m³ de matériau en créant un cratère de 18 mètres de diamètre et de 3,5 mètres de profondeur.
La majorité du matériau lunaire projeté devrait être soulevé à une hauteur inférieure à 10 km. Les satellites orbitant autour de la Lune, tels que LRO, ainsi que des plusieurs des grands observatoires basés à Terre et en orbite terrestre (Hubble) observeront l'impact et le panache. Les données fournies par ses nombreuses sources seront utilisées.
Lorsque les débris soulevés du cratère seront exposés au soleil, la glace d'eau, les hydrocarbures et les autres composés organiques devraient se vaporiser et se décomposer en éléments simples. Ces éléments seront mesurés d'abord par les spectromètres fonctionnant dans l'infrarouge et le visible. Le spectromètre dans le proche infrarouge et dans l'infrarouge moyen devraient déterminer le volume total d'eau et sa distribution dans le panache. La caméra fonctionnant dans le visible déterminera le lieu d'impact et le comportement du panache tandis que le photomètre mesurera le flash lumineux créé par l'impact.