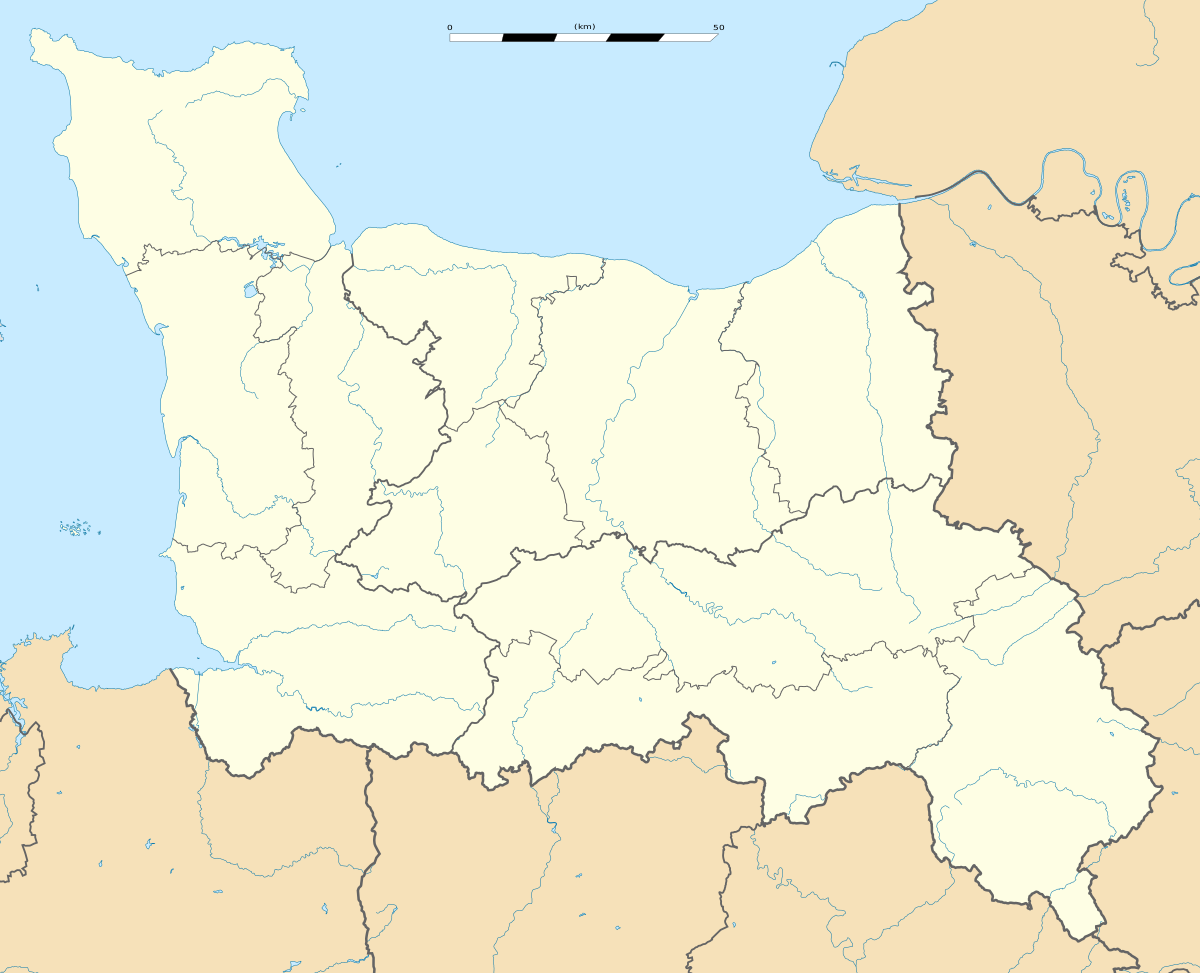Abbaye Notre-Dame du V?u - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Introduction
| Abbaye Notre-Dame du Vœu | ||
|---|---|---|

| ||
| | ||
| Latitude Longitude | ||
| Pays |
| |
| Région | Basse-Normandie | |
| Département | Manche | |
| Ville | Cherbourg-Octeville | |
| Culte | Catholique romain | |
| Type | Abbaye | |
| Rattaché à | Chanoines réguliers de saint Augustin | |
| Début de la construction | 1145 | |
| Protection | Classé MH | |
| Localisation | ||
| modifier | ||
L'abbaye Notre-Dame du Vœu est un édifice religieux catholique implanté à Cherbourg-Octeville, rue de l'Abbaye.
Fondée en 1145 par Mathilde l'Emperesse qui la place sous l'autorité de chanoines réguliers de saint Augustin, l'abbaye, éloignée de la place forte de Cherbourg est pillée et brûlée de nombreuses fois, puis abandonnée par les religieux avant la Révolution française. Après un premier classement partiel en 1913, elle est en restauration depuis 40 ans et fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis 2002.
La légende de Chantereyne
Une légende, rapportée par Arthur du Moustier (ou Arthus Dumonstier) au XVIIe siècle, dans Neustria pia (1663), et complétée plus tard par Dom Beaumier dans son Recueil des évêchés, archevêchés et abbayes (1726), explique la fondation et le nom de l'Abbaye.
Ils racontent que, prise dans une terrible tempête en mer, entre la Normandie et l'Angleterre, Mathilde l'Emperesse, petite-fille de Guillaume le Conquérant, aurait demandé à la Vierge de la sauver, promettant d'ériger une église là où elle débarquerait. Voyant la terre, le pilote aurait dit à la Reine « Chante Reine, voici la terre », laissant ce mot à la croûte du Homet.
Mais cette version n'est présente dans aucune chronique de l'époque. Selon Robert Lerouvillois, il est plus probable que le vœu évoqué soit celui que Guillaume le Conquérant, tombé gravement malade à Cherbourg, fit de guérir, et en accomplissement duquel, il avait fondé la collégiale du château de Cherbourg en 1063. Sa petite-fille aurait voulu ainsi le renouveler. Quant au nom de Chantereyne, il se réfèrerait au ruisseau éponyme, qui avec celui de la Bucaille traversaient cette zone marécageuse, et dont l'étymologie renverrait à cantu ranarum, « lieu où chante les grenouilles ».
Prospérité et destructions
Le XIIIe siècle est celui de la prospérité grâce aux dons lors des croisades. En 1266, 47 religieux, dont 27 résident à l’abbaye les autres dans les prieurés, y sont rattachés. Elle reçoit les visites royales de Louis IX de France (1256) et Philippe le Bel (1286).
Mais, sans protection, l'abbaye est régulièrement pillée et brûlée lors des incessantes batailles franco-anglaises (1294, 1295, 1327, 1330, 1340, 1346, 1377), contraignant les religieux à la quitter. Elle est reconstruite vers 1450, disposant le droit de haute-justice sur 77 paroisses et les îles anglo-normandes.
Elle sera de nouveau endommagée durant les guerres de religion. Elle subit le régime de la commende à partir de 1583. Réformée à la fin du XVIIe siècle sous l'impulsion de l'évêque de Coutances, Loménie de Brienne, et de l'abbé commendataire de Cherbourg, Alexandre Le Jay, par l'installation de chanoines réguliers de la congrégation de Bourg-Achard, elle subira le déclin commun aux institutions monastiques masculines et sera fermée en 1774.

Avec la construction du port militaire, ses terrains d'une quarantaine d'hectares qui s'étendaient de la mer jusqu’à l’actuelle rue Pierre de Coubertin, sont annexés en 1778. Elle devient la résidence du duc d'Harcourt, gouverneur de Normandie, et accueille le Roi en 1786. Elle est transformée ensuite en hôpital de la Marine entre 1793 et 1866, en bagne sous le Premier Empire et en caserne Martin-des-Pallières à partir de 1850 pour l'infanterie de marine.
En 1928, est installée une cité ouvrière, la cité Chantereyne, épargnée par les bombardements mais incendiée par les Allemands en juin 1944.