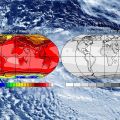Normandie (paquebot) - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
La propulsion
L'appareil propulsif de Normandie incluait les dernières innovations techniques de l'époque. Comme sur toutes les grandes unités du moment, il s'agissait d'un navire dont la propulsion était assurée par la vapeur. Celle-ci était produite par 29 chaudières de type Penhoët à « tubes d'eau ». Cependant, à la différence de ses concurrents, Normandie utilisait une transmission électrique : la vapeur produite se détendait dans des turbines couplées à des alternateurs. Le courant ainsi produit alimentait des moteurs électriques qui pouvaient être alimentés par n'importe lequel des alternateurs. Ainsi, la marche arrière s'obtenait par simple inversion de l'arrivée de courant aux bornes des moteurs. Bien que ce mode de transmission ait déjà existé à l'époque, il n'avait jamais été monté sur une unité aussi importante. Cette solution avait été choisie assurait une grande souplesse des machines.
• Les chaudières
- Il y avait sur Normandie 29 chaudières principales de type Penhoët, à tubes d’eau (la fumée et les gaz chauds circulent autour de tubes contenant l’eau à vaporiser). Le rendement de chauffe était de 88,5 %. Les chaudières fonctionnaient au mazout et leurs masses à vide atteignaient 100,5 t. Elles possédaient 4 brûleurs à pulvérisation mécanique et une surface de chauffe de 1 000 m², fournissant de la vapeur surchauffée à 360 °C sous une pression de 28 kg/cm². La vapeur était récupérée par 4 collecteurs et passait ensuite dans les turbines.
• Les turbines
- Normandie comportait 4 turbines principales. Chacune disposait de 19 étages (un étage représentant un aubage fixe et un aubage mobile) de type à action (la vapeur se détend dans l’aubage fixe et l’aubage mobile utilise l’énergie de cette détente) multicellulaires. Leur puissance atteignait 34 200 kW (soit 46 530 ch), avec une vitesse de rotation maximale de 2 430 tours/min. Sous ces turbines se trouvaient les condenseurs, permettant de refaire passer la vapeur d’eau à l’état liquide. Ces turbines étaient couplées à des alternateurs (on parle donc de turbo-alternateurs), la transmission turbines-alternateurs étant synchrone.
• Les alternateurs
- Les 4 alternateurs, dont la fonction était de convertir de l’énergie mécanique en énergie électrique, étaient chacun constitués d’un rotor (ou inducteur) avec 4 pôles magnétiques (2 pôles nord et 2 pôles sud) et d’un stator (ou induit) sur lequel se trouvent 3 bobinages, décalés l’un par rapport à l’autre de 120°. Le courant courant alternatif triphasé ainsi produit atteignait une tension de 6 000 V à une fréquence de 81 Hz. Étant couplés avec les turbines, les alternateurs tournaient à 2 430 tours/min et leurs puissance atteint 33 200 kW (soit 45 411 ch). Ils produisaient le courant alternatif distribué ensuiteaux moteurs par l'intermédiare des pupitres de contrôles.
• Les moteurs
- Les moteurs, eux aussi au nombre de 4, avaient le rôle inverse des alternateurs (ils convertissaient l’énergie électrique en énergie mécanique). Leurs dimensions étaient de 6,50 m de hauteur, 8,00 m de longueur et 6,00 m de large. Ces moteurs développaient une puissance de 40 000 ch (soit 29 420 kW), avec capacité temporaire de 50 000 ch en cas d'urgence. Chaque moteur était constitué d’un stator et d'un rotor de 40 pôles magnétiques. Leurs pôles étant 10 fois plus nombreux que ceux des alternateurs, les moteurs tournaient 10 fois moins vite, donc à 243 tours/min maximum. Ces moteurs étaient asynchrones lors des manœuvres de démarrage, d’arrêt et d’inversion de marche, et synchrones en marche normale. En effet, un moteur asynchrone démarre seul sous l’effet du champ tournant produit par le stator, mais sa vitesse ne peut atteindre celle du champ tournant (ici de 243 tours/min) alors que le moteur synchrone, dont le rotor est excité (ou parcouru par un courant continu), avait besoin d’être entrainé pour démarrer (compte tenu des moyens de commande des machines électriques à cette époque), mais sa vitesse est toujours proportionnelle à la fréquence du champ tournant. On comprend donc le choix des ingénieurs de faire démarrer ces moteurs en asynchrone et tourner en synchrone pour la marche normale. Le changement de sens de rotation de ces moteurs se faisait par simple inversion des polarités du courant à l’arrivée aux moteurs, ce qui permettait à Normandie de « battre » en arrière avec 160 000 ch. Ces moteurs, parmi les plus grands jamais construits dans le monde, ont été produits, tout comme les turbo-alternateurs, par l’entreprise Alsthom de Belfort.