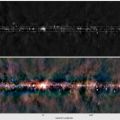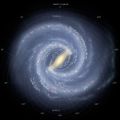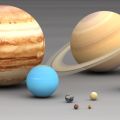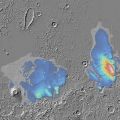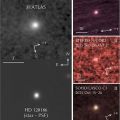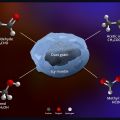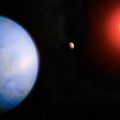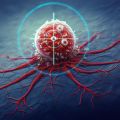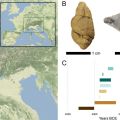Stockage d'énergie - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Stockage de l'électricité
L'électricité est une énergie secondaire, c'est-à-dire qu'elle résulte de la transformation d'énergie primaire. Une fois produite elle est instantanément consommée ou perdue.
Elle n'est pas directement stockable (sauf dans un condensateur) :
Le problème de stocker ce type d'énergie est résolu par :
- des systèmes-tampon (stockage hydraulique via pompage et relevage d'eau dans des barrages hydroélectrique puis turbinage)
- des systèmes inertiels, permettant - localement - une alimentations régularisée et sans interruptions (uninterruptible power supply) par exemple pour les data centers. L'électricité est alors convertie en énergie cinétique en faisant tourner à grande vitesse un disque très lourd dans un système où l'on cherche à réduire les frottements. Le disque fait tourner une dynamo quand l'électricité manque, et un surplus d'électricité est utilisé pour faire tourner le disque plus vite.
- l'alimentation de systèmes autonomes (non reliés à un réseau de production) au plus près de la demande ou non.
C'est ce qu'on obtient par exemple en utilisant le principe de la pile ou de la batterie, basé sur une réaction chimique : une pile stocke des produits chimiques qui vont réagir et produire de l'électricité à la demande. Ces technologies présentent des inconvénients majeurs qui limitent leur utilisation : poids, coût, faible productivité et souvent dangerosité des composants ou risque de pollution (acides, plomb, mercure, chrome, zinc, arsenic, cadmium, nickel...). - des condensateurs
- le Stockage magnétique à supraconducteur ou SMES (utilisant certains atouts de la supraconductivité)
== Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Quelques chiffres en fonction du mode de stockage : Est-ce facile de stocker l'énergie ? par Jean-Marc Jancovici
Bibliographie
Notes et références
- 5 27 /03 /2009 01:50 TRES IMPORTANT - "Cinq fois plus d’énergie et moins d’effet de serre (avec ou sans nucléaire)" - Par François Lempérière, Polytechnicien ; Stockage d'énergie en mer : les « Lacs Emeraudes » - Cinq fois plus d'énergie et moins d'effet de serre, consulté 2010 08 16
- Carbon Zéro
Stockage de chaleur
Le stockage de chaleur peut être réalisé à travers deux phénomènes différents associés aux matériaux qui assure le stockage. On parle alors de stockage par chaleur sensible et de stockage par chaleur latente.
Le stockage par chaleur sensible
Dans le stockage par chaleur sensible, l'énergie est stockée sous la forme d'une élévation de température du matériau de stockage. La quantité d'énergie stockée est alors directement proportionnelle au volume, à l'élévation de température et à la capacité calorifique du matériau de stockage. Ce type de stockage n'est limité que par la différence de température disponible, les déperditions thermiques du stockage (liée à son isolation thermique) et l'éventuel changement d'état que peut être amené à subir le matériau de stockage (fusion ou vaporisation).
Quelques exemples de stockage de chaleur sensible :
- Dans les systèmes de chauffage domestiques, on utilise parfois la grande inertie thermique de certains matériaux (briques, huile) pour restituer lentement la chaleur accumulée au cours de périodes où la chaleur a été produite ou captée. Mais le plus souvent, le stockage est assuré par un ballon d'eau chaude isolé.
- Dans les fours à feu de bois, en brique et terre réfractaire, la capacité de la voûte du four à emmagasiner la chaleur est utilisée pour la cuisson d'objets (poterie, émaux, etc.) ou de plats (pain, pizza, etc.).
Le stockage par chaleur latente
Dans le stockage par chaleur latente, l'énergie est stockée sous la forme d'un changement d'état du matériau de stockage (fusion ou vaporisation). L'énergie stockée dépend alors de la chaleur latente et de la quantité du matériau de stockage qui change d'état. Contrairement au stockage sensible, ce type de stockage peut être efficace pour des différences de températures très faibles. Dans le cas du changement de phase solide/liquide, et pour une quantité d'énergie stockée et un matériau de stockage donnés, le stockage latent nécessite moins de volume que le stockage par chaleur sensible du fait que la chaleur latente est généralement beaucoup plus élevée que la capacité calorifique.
Ces deux types de stockage peuvent être utilisés pour stocker du froid.
Quelques exemples de stockage de chaleur latente :
- Des matériaux à changement de phase (MCP) sont actuellement étudiés pour améliorer l'inertie thermique des parois des bâtiments.
- Les pompes à chaleur, notamment les réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs, utilisent des fluides changeant de phase comme caloporteurs. Ceux-ci ne stockent pas à proprement parler de chaleur, l'emmagasinant uniquement le temps du transport.