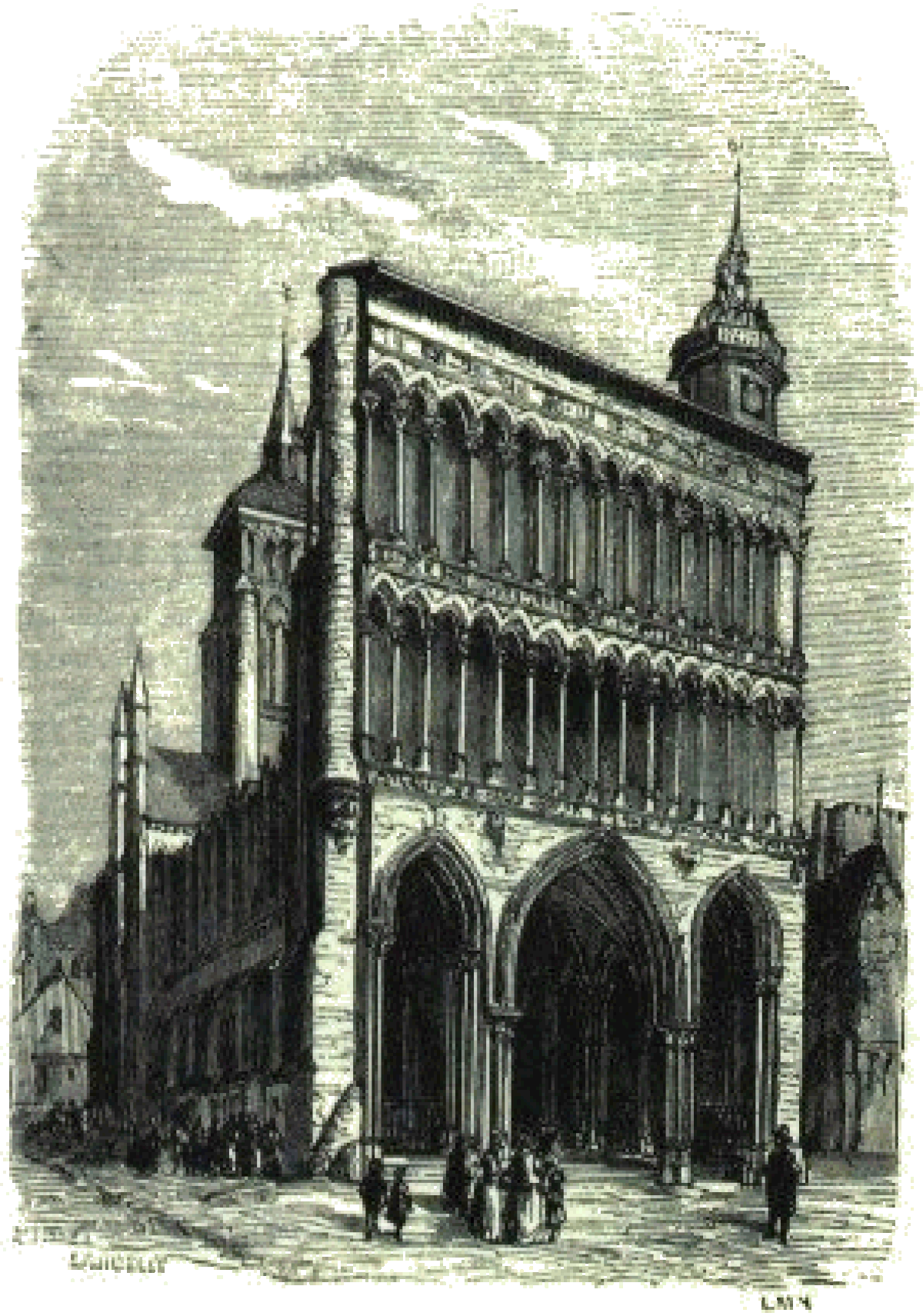Église Notre-Dame de Dijon - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Appréciations architecturales
Vauban a dit de Notre-Dame qu' « il ne manquait à ce Temple auguste qu'une boîte pour l'enfermer ».
Selon Eugène Viollet-le-Duc, Notre-Dame de Dijon est « un chef-d'œuvre de raison. »
T. de Jolimont écrit de Notre-Dame, dans son ouvrage Description historique et critique [...] des monumens les plus remarquables de la ville de Dijon, de 1830, p. 31 :
« L'intérieur de l'église de Notre-Dame offre plus particulièrement lieu d'observer et d'étudier tout le talent dont l'artiste a fait preuve, tout l'artifice de la structure, l'heureuse exécution des colonnades qui règnent dans toute l'étendue des travées, cette harmonie entre toutes les parties, et cette construction ingénieuse et hardie des voûtes qui paraissent comme suspendues et sans appuis, dont furent, dit-on, si émerveillés le célèbre Vauban et l'architecte Soufflot qui en fit exécuter une copie modèle en bois. »

La chouette
Dans la rue de la Chouette, voie piétonne qui longe le côté nord de l'église et le chevet, une pierre d'une chapelle de Notre-Dame porte une marque singulière qui a suscité la curiosité de certains historiens de la ville. À l'angle d'un contrefort d'une chapelle de l'église est sculpté un oiseau que les Dijonnais appellent la chouette. Sa signification est toujours inconnue, bien que plusieurs hypothèses aient été émises à son sujet. Pour certains, la chouette pourrait être une signature laissée là par un architecte ou par un tailleur de pierre. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas la signature de l'architecte de l'église, car cet oiseau est sculpté sur une chapelle élevée à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle, soit plusieurs siècles après la construction de Notre-Dame.
La chouette est très usée à cause de la vénération superstitieuse qu'elle suscite. En effet, Dijonnais et touristes ont coutume de la caresser, de la main gauche, pour demander que leur souhait soit exaucé. Il n'en subsiste donc aujourd'hui que la forme générale, la plupart des détails de la sculpture ayant depuis longtemps disparu.
Dans la nuit du 5 au 6 janvier 2001, un vandale a porté à la chouette plusieurs coups de marteau. Cette dégradation suscita l'émotion des Dijonnais. Plutôt que de laisser la chouette en l'état ou de remplacer le bloc de pierre sur lequel elle était sculptée, il fut décidé d'en réparer les cassures. Un moulage de la chouette avait été réalisé en 1988 par un statuaire mouleur du Louvre. Il servit de modèle à la réparation, qui consista à incruster des fragments de pierre, ensuite patinés. Ce travail s'accomplit fin janvier et début février 2001.
Depuis cet incident, un système de vidéosurveillance a été mis en place afin de prévenir toute récidive. La chouette restaurée a été inaugurée officiellement le 12 mai 2001.
Ces péripéties n'ont fait qu'accroître la popularité de cette sculpture à Dijon. L'office de tourisme l'a choisie en 2001 comme symbole du Parcours de la Chouette, circuit touristique piéton qui fait le tour du centre historique avec un marquage au sol constitué de nombreuses flèches, et, devant les principaux monuments, de vingt-deux plaques carrées, portant une chouette gravée.
Références et notes
- Selon le site officiel de la paroisse Notre-Dame de Dijon.
- notice de la base Mérimée
- Par exemple, T. de Jolimont, dans Description historique et critique et vues pittoresques dessinées d'après nature et lithographiées, des monumens les plus remarquables de la ville de Dijon, Paris, Imprimerie de A. Barbier, 1830, p. 29, écrit que "La partie la plus remarquable est le portail principal, unique dans son genre ».
- Sculpture médiévale en Bourgogne Collection lapidaire du Musée archéologique de Dijon, Dijon, Editions universitaires de Dijon, 2000, p. 214.
- Jacques Berlioz, Saints et damnés. La Bourgogne du Moyen Age dans les récits d'Etienne de Bourbon, inquisiteur (1190-1261), Dijon, Les Editions du Bien public, 1989, p. 7-9.
- Pierre Quarré, "Musée des Beaux-Arts de Dijon. Acquisitions (1965-1968)", La Revue du Louvre et des Musées de France, 1968, p. 463. Cette gargouille est conservée au musée archéologique de Dijon.
- Gabriel Peignot, L'illustre Jaquemart de Dijon, [1re édition : 1832], Marseille, Laffitte reprints, 1976.
- Denise Borlée, "Eglise paroissiale Notre-Dame", Sculpture médiévale en Bourgogne Collection lapidaire du Musée archéologique de Dijon, Dijon, Editions universitaires de Dijon, 2000, p. 217.
- Boudot, Notice sur l'horloge de l'église Notre-Dame de Dijon [...], Dijon, Veuve Brugnot, Paris, 1835, 56 p.
- Etienne Picard, « Le Jaquemart de l'église Notre-Dame de Dijon », La Revue de Bourgogne, 15 mars 1921, p. 77-82.
- Boudot, Notice sur l'horloge de l'église Notre-Dame de Dijon [...], Dijon, Veuve Brugnot, Paris, 1835, p. 35-37.
- Gabriel Peignot, L'illustre Jaquemart de Dijon, [1re édition : 1832], Marseille, Laffitte reprints, 1976, p. 43-57.
- Jules Thomas, Épigraphie de l'église Notre-Dame de Dijon, Dijon Paris, E. Nourry, 1904, p. 74, 81.
- Jules Thomas, La délivrance de Dijon en 1513 d'après les documents contemporains, Dijon, 1898, p. 168.
- Bibliothèque municipale de Dijon, Dom Calmelet, Histoire de la maison magistrale conventuelle et hospitalière du Saint Esprit fondée à Dijon l’an MCCIV, p. 52.
- Jules Thomas, La délivrance de Dijon en 1513 d'après les documents contemporains, Dijon, 1898, p. 165-166, 169.
- Pierre Quarré, « La statue de Notre-Dame de Bon-Espoir et son ancienne polychromie », Mémoires de la Commission des Antiquités du département de la Côte-d'Or, t. 23, 1947-1953, p. 190-197.
- Jules Thomas, La confrérie de Notre-Dame de Bon-Espoir, Dijon, 1899, p. 27-32.
- Jules Thomas, La délivrance de Dijon en 1513 d'après les documents contemporains, Dijon, 1898, 351 p.
- Henri Chabeuf, Dijon. Monuments et Souvenirs, Dijon, L. Damidot, 1894, p. 236. Eugène Fyot, L'église Notre-Dame de Dijon Monographie descriptive, Dijon, Félix Rey, 1910, p. 111.
- Le Bien public, 6 janvier 2001, p. 1, 3.
- Le Bien public, 10 janvier 2001, p. 5.
- Le Bien public, 30 janvier 2001, p. 5.
- Les éditions du Bien public de janvier 2001 relatent ces événements.
- Gaudrillet, Histoire de Notre-Dame de Bon-Espoir [...], Dijon, Arnauld Jean-Baptiste Augé, 1733, p. 27-28.
- Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, Paris, B. Bance, t. IV, p. 131.