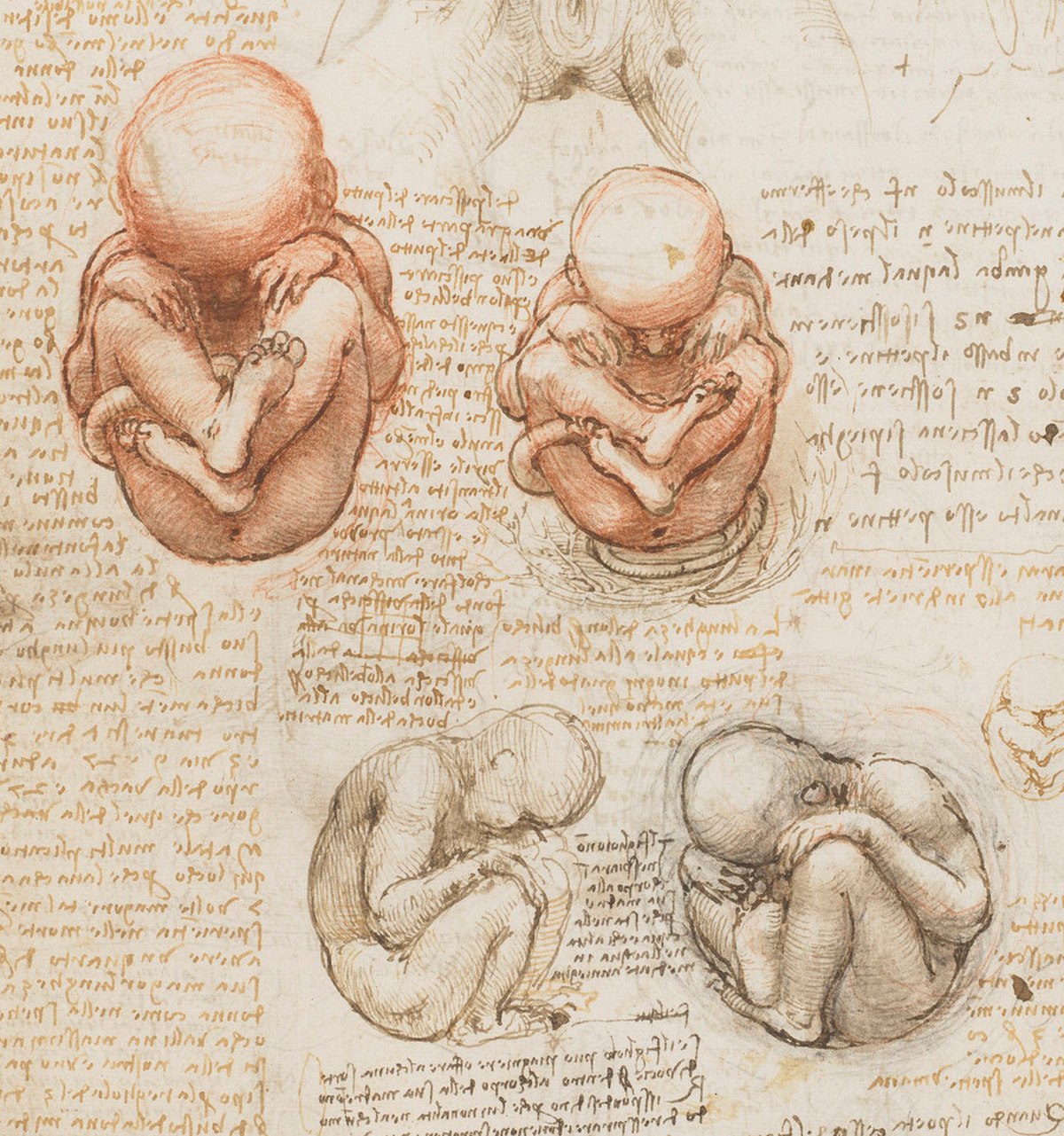Dystopie - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Quelques textes précurseurs de la dystopie
La dystopie tire son origine de deux genres littéraires qui apparaissent ou se développent du XVIIIe siècle : les fictions critiquant la littérature utopique, dont Les Voyages de Gulliver sont l'exemple le plus célèbre, et le roman d'anticipation que popularise Louis-Sébastien Mercier.
Les récits de voyage satiriques
La mise en parallèle de deux univers, l'univers réel et un univers fictif, permet souvent à un auteur d'exercer ses talents de satiriste. La satire peut s'exercer de deux manières différentes :
- L'univers imaginaire est une satire de l'univers réel. Les travers du monde fictif sont une exagération de ceux du monde réel et ont pour but de les dénoncer. Ce procédé, largement utilisé dans Le Meilleur des mondes (critique de la société de consommation) mais aussi dans 1984 (caricature de l'ancien régime soviétique) se retrouve dans de nombreux récits de voyages fantaisistes des XVIIe et XVIIIe siècles tels que l’Histoire comique des Estats et empires de la Lune et l'Histoire comique des Estats et Empires du Soleil de Cyrano de Bergerac, ou Les voyages de Gulliver de Jonathan Swift.
- La critique du monde réel se fait par la voix des habitants du monde fictif. Huxley joue également sur ce tableau, car si le monde qu'il nous décrit peut nous sembler repoussant, il évoque aussi régulièrement au cours de son roman le dégoût que notre monde inspire à ses personnages. L'Utopie de Thomas More faisait déjà usage de ce procédé et on peut voir dans ce texte davantage une critique indirecte de l'Angleterre, par contraste avec le monde de justice de l'Utopie, qu'un véritable programme politique. More fait également référence à l’effroi et à l'étonnement que suscitent chez les Utopiens les mœurs européennes. Les Lettres persanes de Montesquieu utilisent la voix d'étrangers (de Persans, en l’occurrence) pour dénoncer les défauts de la France du XVIIIe siècle.
Fictions critiquant l'utopie au siècle des Lumières
- 1714. Bernard de Mandeville, Private vices, public benefits, 1714.
- 1726. Jonathan Swift, Gulliver's travels, 1726.
- 1731. Antoine François Prévost, Le Solitaire anglais : Histoire de M. Cleveland, 1731.
- 1765. Charles-François Tiphaigne de la Roche, Histoire des Galligènes : Mémoires de Duncan, Vve Durand, Amsterdam et Paris, 1765.
- 1795. Donatien Alphonse François de Sade, Aline et Valcour : Le roman philosophique, Veuve Girouard, Paris, 1795 Roman épistolaire écrit à la Bastille entre 1785 et 1788..
Les débuts du roman d'anticipation
- 1771. Louis-Sébastien Mercier, L'An deux mille quatre cent quarante : Rêve s'il en fût jamais, [s. n.], Londres, 1771.
- 1846. Émile Souvestre, Le Monde tel qu'il sera, W. Coquebert, Paris, 1846.
- 1871. Edward Bulwer-Lytton, The coming race, W. Blackwood and sons, Edingburgh and London, 1871.
- 1888. Edward Bellamy, Looking backward : 2000-1887, Ticknor and Company, Boston, 1888.
Problématiques soulevées par la dystopie
Les œuvres contre-utopiques portent la marque des préoccupations et des inquiétudes de leur époque. La naissance du régime soviétique (première mise en œuvre à grande échelle d'une société utopique, bien que Marx récuse ce terme) et, plus tard, la menace du totalitarisme offraient des thèmes idéaux à la naissance et au développement de la contre-utopie. Les perspectives nouvelles de prospérité et de bonheur pour tous offertes dès la première moitié du XXe siècle par la société de consommation naissante (permise par le taylorisme) aux États-Unis offrent quant à elles la matière première du Meilleur des Mondes de Huxley.
Dystopie et communisme
L'histoire de l'utopie et de son prolongement en contre-utopie est étroitement liée à celle du communisme au sens le plus large du terme. Plusieurs siècles avant la parution du Manifeste du Parti communiste de Karl Marx et Friedrich Engels, les utopies de la Renaissance proposent des modèles de sociétés collectivistes.
Thomas More, qui compatit au sort misérable des paysans sans terre de l'Angleterre du XVIe siècle, et voit dans la propriété privée la principale cause des malheurs de son époque, invente une société, l’Utopie, dont la principale caractéristique est d'ignorer totalement toute possession individuelle. La Cité du Soleil de Campanella fonctionne également sur un mode collectiviste.
Au XIXe siècle, l'utopie prend une tournure plus pratique. Les utopistes ne sont plus simplement des théoriciens mais des militants. On parle alors de socialisme utopique pour qualifier les œuvres d'auteurs tels que Saint-Simon, Robert Owen ou Charles Fourier. Des créations de micro-sociétés utopiques sont tentées (la secte des Shakers aux États-Unis, les phalanstères fouriéristes), avec un succès limité à ces micro-sociétés.
Les dystopies voient le jour au XXe siècle, alors même que des régimes se réclamant du socialisme, du communisme et du marxisme s'établissent pour la première fois en Europe et ailleurs. Nous Autres de Ievgueni Zamiatine est écrit en Russie en 1920, c'est-à-dire au lendemain de la Révolution soviétique. Alors même que le régime soviétique n'en est qu'à ses balbutiements, Zamiatine dénonce les risques de la société qui se dessine en Russie : au nom de l'égalité et de la rationalité, l'État décrit dans Nous Autres organise et contrôle méticuleusement les moindres aspects de l'existence de ses citoyens ; la vie privée est abolie. Nous Autres n'est pas une critique visant spécifiquement le marxisme, Zamiatine critique la volonté de vouloir planifier et rationaliser tous les aspects de l'existence et de refuser à l'homme le droit à toute fantaisie.
Le roman 1984 s'attaque lui aussi à un régime communiste, le régime stalinien. Il serait cependant exagéré d'en faire une critique de la doctrine marxiste. Le monde de 1984 ne ressemble en effet en rien à une société égalitariste. Ce que dénonce Orwell dans son roman, c'est le totalitarisme principalement incarné à l'époque (1948) par le régime de Joseph Staline en Union soviétique. Écrivain engagé à gauche, Orwell souhaitait par ce roman combattre la fascination qu'exerçait sur un certain nombre d'intellectuels britanniques de l'époque le régime soviétique. Le monde de 1984 n'est pas l'URSS (il est bien pire) mais de nombreux détails font allusion à l'Union Soviétique : l'Océania est dirigé par un parti (nommé simplement « le Parti »), la doctrine officielle s'appelle « angsoc » (« socialisme anglais »), le visage de Big Brother rappelle celui de Staline et la falsification des documents fait allusion aux falsifications des photographies sous l'URSS de Staline.
Dystopie et conditionnement
Les utopies de la Renaissance puis de l'âge classique ne sont pas des sociétés paradisiaques offrant à l'homme un cadre de vie répondant à tous ses besoins et ses désirs. Thomas More, le premier, voit dans l'égoïsme et la cupidité les causes de l'injustice de toutes les sociétés existantes et son utopie est un projet d'amélioration morale de l'homme. Les sociétés idéales ne le sont que parce qu'elles ont su faire de l'homme un être meilleur, plus civilisé et capable de servir sa communauté avant ses propres intérêts. Or, dès la naissance des utopies, leurs auteurs n'ont pu parvenir à ces résultats qu'en imposant un certain nombre de lois contraignantes : l'égoïsme et l'avidité sont empêchés, dans l'utopie de More, par l'interdiction absolue de toute propriété privée.
Les contre-utopies dénoncent dans les utopies l'incapacité de celles-ci à changer véritablement l'homme pour en faire un être heureux et digne de bonheur. Les œuvres de Huxley, Orwell, Zamiatine ou Silverberg soulignent le caractère superficiel des changements que les États contemporains ont pu imposer à la nature humaine. Ceux-ci n'ont pas su changer l’homme en profondeur et n'ont pu agir que sur son comportement.
Ainsi :
- Dans 1984, l'État entend modifier l'esprit humain par l'usage du « novlangue » et de la « doublepensée ». Le novlangue est une langue volontairement appauvrie dont le but est d'empêcher ses locuteurs de formuler des pensées complexes et d'exercer leur esprit critique. La doublepensée est une sorte de gymnastique mentale consistant à accepter comme également vraies des propositions contradictoires. Son but est également de détruire chez l'individu tout sens logique. Ces procédés ne réussissent pourtant pas à faire accepter aux habitants de l'Océania leurs conditions de vie. Orwell insiste sur le fait que, même dépourvus de tous moyens intellectuels de contester l'ordre en place, les personnages de son roman n'en continuent pas moins de ressentir instinctivement que leur vie est inacceptable. Les méthodes du Parti n'ont pas pu venir à bout des besoins et des goûts de l'homme et n'ont su que les refouler comme en témoigne l'exemple du personnage de Parsons, fervent supporter du régime qui insulte pourtant Big Brother contre son propre gré durant son sommeil.
- Dans Le Meilleur des mondes, les individus sont conditionnés dès leur plus jeune âge par l'écoute durant leur sommeil de slogans et d'aphorismes censés s'imprimer pour la vie dans leur esprit et visant à leur dicter le comportement à adopter dans toutes les situations. Les personnages du roman de Huxley sont ainsi dispensés d'avoir jamais à penser et échappent aux tourments qui pourraient en résulter. Ils sont également façonnés de manière à toujours se comporter conformément aux attentes de leur société. Cependant, tout comme leurs homologues de 1984, ils n'échappent pas à l'angoisse, angoisse renforcée par leur incapacité à mettre des mots sur ce qu'ils peuvent éprouver. D'où le recours régulier à une drogue (nommée « soma ») sans laquelle leur vie ne saurait être supportable. Ici encore, l'utopie n'a pas réussi à faire un homme nouveau.
Les contre-utopies dénoncent donc la prétention utopique à changer l'homme par conditionnement.
« [Les prêtres] apportent tous leurs soins à instiller dans les âmes encore tendres et dociles des enfants les saines doctrines qui sont la sauvegarde de l'État. Si elles y ont profondément pénétré, elles accompagnent l'homme sa vie entière et contribueront grandement au salut public, lequel n'est menacé que par les vices issus de principes erronés »
— Thomas More, L'utopie, p. 222
Prétention qui n'aboutit qu'à l'aliénation, le refoulement et la névrose.