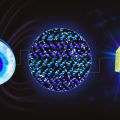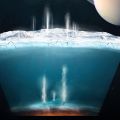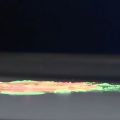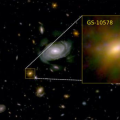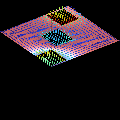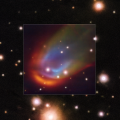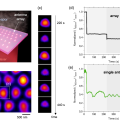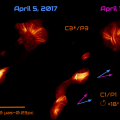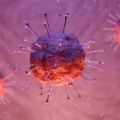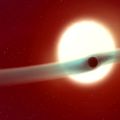Jean-Paul de Gua de Malves - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Jean-Paul de Gua de Malves, prieur de Saint George-de-Vigou, né vers 1712 à Carcassonne et mort le 2 juin 1786 à Paris, est un savant français, premier concepteur de l’Encyclopédie.
Né dans une famille ruinée par les spéculations du système de Law, Jean-Paul de Gua de Malves vit, dans sa jeunesse, la fin de l’ancienne fortune de sa famille et la vente de toutes les terres de Languedoc de son père, Jean de Gua, baron de Malves. Gentilhomme et prêtre, de Gua aurait pu, en suivant la route commune, parvenir aux dignités ecclésiastiques, mais aimant les sciences plus que la fortune, il partit pour l’Italie où il eut des amis illustres qui ne firent rien pour lui.
Revenu à Paris, il fut présenté au comte de Clermont, qui voulait alors y fonder une société des arts, comme un homme qui, joignant l’étude des sciences à celle des arts, honorerait cette société naissante qui n’eut qu’une existence éphémère. En 1741, il se fit connaître par l’ouvrage intitulé Usages de l’Analyse de Descartes, traité de la théorie des courbes algébriques, entrepris par le seul motif de prouver que non seulement on pouvait, dans cette théorie, se passer du calcul différentiel, mais y employer même avec plus d’avantage les méthodes de Descartes où se trouvent des théories simples et générales, présentées d’une manière nouvelle, presque toujours étendues ou perfectionnées et rendues plus intéressantes par des rapprochements singuliers et inattendus. Le 18 mars 1741, il fut reçu comme adjoint géomètre à l’Académie des sciences. Il présenta dans le même temps à cette Académie des recherches sur la géométrie des solides renfermant plusieurs propositions nouvelles et remarquables par l’élégance de leur énoncé ou la difficulté de les démontrer. Ces recherches, alors restées manuscrites, forment la plus grande partie des mémoires que de Gua publia vers la fin de sa vie. Le volume de 1741 contient deux de ses mémoires sur la manière de reconnaître la nature des racines des équations. Le premier examine la règle d’après laquelle Descartes détermine le nombre des racines positives ou négatives des équations, où elles sont toutes réelles, règle contestée qui n’avait encore été démontrée par personne et dont de Gua donna une démonstration générale et rigoureuse qui justifia Descartes. Son second mémoire avait pour objet de donner une règle qui apprenne à reconnaître, dans une équation, le nombre des racines réelles ou imaginaires, et parmi les premières, celui des racines positives ou négatives. Dans la règle de Descartes, applicable aux seules équations où toutes les racines sont réelles, il suffisait de connaître le signe des coefficients de tous les termes de l’équation, mais dans celle de de Gua, on a besoin de résoudre une équation d’un degré immédiatement inférieur, ou du moins de faire sur cette équation, et sur des équations analogues de degrés toujours moins élevés, une suite d’opérations longues et compliquées. On trouve, à la tête du même mémoire, une histoire de la théorie des équations, où l’auteur a réuni une critique éclairée à une grande érudition.
En 1745, de Gua demanda et obtint, le 3 juin, le titre d’adjoint géomètre vétéran à l’Académie, où dans une discussion élevée avec un de ses confrères, il montra une vivacité que ce corps, malgré son estime de pour ses talents et son caractère, ne put s’empêcher de désapprouver. S’étant présenté, quelque temps après, pour une place d’associé alors vacante, un autre lui fut préféré. Il en résulta pour de Gua un relâchement des liens qui l’unissaient à un corps auquel il était attaché avec la force que son caractère donnait à toutes ses affections. Cette espèce de séparation, qui cependant n’était pas absolue, fut à la fois une perte pour les sciences et un malheur pour de Gua qui, dominé par son imagination, un peu porté vers les opinions extraordinaires, avait besoin des conseils de ses confrères pour empêcher son talent de s’égarer et l’obliger à suivre les voies où il pouvait l’employer utilement pour sa notoriété et pour le progrès des sciences. Il occupa pendant quelques années la chaire de philosophie au Collège de France.
À peu près vers le même temps, les libraires qui avaient le privilège de la traduction de la Cyclopaedia or Universal Dictionary of Arts and Sciences de Chambers, s’adressèrent à lui pour présider à la correction de ce qui était défectueux dans l’ouvrage original, et aux additions que de nouvelles découvertes rendaient nécessaires. Il s’éleva entre ce savant, qui n’envisageait dans cet ouvrage qu’une entreprise utile au perfectionnement des connaissances humaines ou de l’instruction publique, et les libraires, qui n’y voyaient qu’une affaire de commerce, de fréquentes discussions dont il résulta que de Gua, que le malheur n’avait rendu que plus facile à blesser et plus inflexible, se dégoûta bientôt de ce travail de l’Encyclopédie. Mais pour avoir abandonné ce travail, que Diderot devait reprendre et mener à bien, de Gua avait pourtant eu le temps d’en changer la forme : après son intervention, le projet de l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers n’était plus une simple traduction augmentée, c’était un ouvrage nouveau, entrepris sur un plan plus vaste. Au lieu d’un dictionnaire élémentaire des parties des sciences les plus répandues, les plus usuelles, ouvrage utile en lui-même, de Gua avait entrepris de réunir, dans un dépôt commun, tout ce qui formait alors l’ensemble des connaissances de son époque et il avait, de plus, su intéresser au succès de ce travail, et engager à y concourir plusieurs hommes célèbres dans les sciences et dans les lettres, MM. de Fouchy, le Roy, Daubenton, Louis, Condillac, Mably et surtout D’Alembert et Diderot, qui devait lui succéder à la tête de ce projet. Si de Gua n’a pas eu de part de la réalisation de l’Encyclopédie, le mérite d’en avoir eu la première idée lui revient incontestablement.
Bientôt après, de Gua s’occupa d’un projet d’un recueil destiné à publier périodiquement tous les ouvrages que les savants auraient voulu y insérer, et que le rédacteur en aurait jugés dignes. Ce projet utile au progrès des sciences fut exécuté, quoique sur un plan moins étendu, en France et en Italie. Les avantages du projet de de Gua étaient de répandre plus promptement, et sur un plus grand espace, toutes les découvertes, tous les essais, toutes les vues, toutes les observations, de procurer à tous les savants l’avantage réservé aux membres des académies, de pouvoir insérer leurs ouvrages dans un recueil connu de toutes les nations, d’offrir aux jeunes gens un moyen facile et prompt de se faire connaître, et souvent d’apprendre à se connaître eux-mêmes, et d’établir plus d’indépendance et d’égalité dans le monde scientifique, en diminuant le besoin de ceux entrant dans la carrière, d’y paraître sous les auspices d’un nom déjà célèbre. Cependant, de Gua, croyant que toutes les connaissances humaines qui s’acquièrent par le raisonnement, le calcul et l’observation, perdent à être trop séparées, que c’est même de leur réunion qu’on doit attendre leurs progrès les plus étendus et les plus utiles, avait placé, dans son recueil, la philosophie abstraite et l’économie politique au rang des sciences admises. Leibnitz avait suivi, lorsqu’il traça, pour le premier roi de Prusse, le plan de l’Académie de Berlin, ce même principe, qui parut pourtant, même quarante ans après, dangereux en France et de Gua, qui tenait à ses idées, et qui avait le malheur commun à tous les hommes de courage, d’avoir besoin d’être convaincu pour céder, aima mieux abandonner son projet, que d’en retrancher des parties qui n’en étaient pas à ses yeux les moins importantes.
Dans le même temps, pour suppléer à la modicité de sa fortune, de Gua avait été obligé de faire quelques traductions. Une de ces traductions, celle des dialogues d’Hylas et de Philonoüs du philosophe anglais George Berkeley, dont l’objet de l’ouvrage est de prouver que les raisonnements des philosophes sur l’existence et la nature des substances matérielles sont vagues et souvent vides de sens et que le langage scientifique qu’ils y emploient les conduit à des résultats inintelligibles ou contradictoires. Pour bien faire cette traduction, il ne suffisait pas des qualités qu’on exige d’un traducteur ordinaire, il fallait être très exercé dans toutes les subtilités de la métaphysique la plus abstraite ; il fallait connaître toutes les finesses de la langue philosophique des deux idiomes, pour rendre facile la lecture d’un ouvrage où l’on est tenté de prendre pour des chimères les vérités mêmes qu’il renferme et où les raisonnements les plus justes paraissent des sophismes. De Gua fit graver à la tête du livre une vignette très ingénieuse montrant un philosophe riant d’un enfant qui, voyant son image dans un miroir, la prend pour un objet réel et cherche à la saisir ; on lit au bas : Quid rides ! mutato nomine de te fabula narratur où le traducteur rend ainsi, par une seule image, un système métaphysique tout entier.
Philosophe occupé de projets et de travaux utiles et géomètre ayant donné des preuves de talent original dans un très petit nombre d’ouvrages, de Gua s’est attiré, peut-être en partie, des malheurs qu’il n’avait pas mérités, lorsque il s’imagina qu’en appliquant à des objets utiles au gouvernement, ses talents et les connaissances très variées et très étendues qu’il avait acquises, il pourrait, appuyé par une protection très puissante que ses amis lui avaient procurée, s’avancer dans le chemin de la fortune, jusqu’alors fermé pour lui. Ayant été, dans ses premières années, témoin de l’opulence de sa famille puis de l’événement qui la lui avait ravie, de Gua devait être naturellement porté à regarder la médiocrité comme un malheur, et à chercher les moyens de se rapprocher d’un état dont les avantages avaient ébloui son enfance. C’est par là sans doute qu’on peut expliquer comment un homme désintéressé, qui savait supporter les privations, et à qui un esprit profond et subtil, capable des plus grands efforts et de la patience la plus infatigable, offrait tant d’occupations attachantes et glorieuses, put cependant consommer en vain partie de sa vie à faire des projets pour s’enrichir, et n’en fut que plus malheureux. Il suffit de lire les mémoires qui renferment ses projets, pour voir combien l’art de réussir lui était étranger ; l’eut-il connu dans la théorie, qu’il n’est pas vraisemblable qu’il eût jamais ni pu, ni voulu le pratiquer, ne sachant ni tromper, ni paraître dupe, ni attendre, ni souffrir.
Le premier projet de de Gua avait pour but de perfectionner le travail de ramassage de l’or mêlé au sable de plusieurs rivières de Languedoc et du pays de Foix ; de chercher, soit dans leur lit, soit dans les campagnes voisines, les dépôts les plus riches qu’elles peuvent avoir formés, ou la mine dont elles ont détaché l’or qu’elles entraînent depuis tant de siècles. Content de voir son projet adopté à moitié, oubliant qu’il ne devait cette demi-réussite ni à la conviction ni à l’amitié du ministre, mais à la nécessité de paraître bien intentionné pour lui, il se chargea imprudemment d’un premier essai, n’eut point de succès, fit une chute de cheval, qui, après l’avoir rendu impotent plusieurs années, ne lui permit jamais de marcher qu’avec peine, et il n’obtint enfin, pour récompense de son zèle et pour dédommagement de son malheur, que des reproches.
Un projet qu’il fit ensuite sur les emprunts en général, et en particulier sur les emprunts par loteries, n’eut pas un succès plus heureux. Ce goût de de Gua pour les loteries est d’autant plus singulier que celles-ci lui avaient fait beaucoup de mal dans sa jeunesse lorsqu’il y avait gagné une somme assez considérable, dans une circonstance où il avait tenté cette ressource, uniquement parce que c’était la seule qui lui restât pour éviter le malheur de retourner dans sa province, et d’abandonner la capitale. Il imagina bientôt qu’il serait possible de jouer ce jeu avec avantage, d’après l’observation de causes d’inégalité réelles, mais trop faibles pour que l’on puisse en déterminer l’influence ou en profiter, et finit par y perdre beaucoup. De Gua ignorait, de surcroit, combien il trouverait d’hommes intéressés à écarter un géomètre connu pour avoir de la probité et du courage. D’ailleurs, de Gua, incapable de dire ce qu’il ne pensait pas, commençait tous ses mémoires sur les loteries, par avouer qu’elles sont un jeu de hasard auquel on fait jouer à la fois une nation entière, et un impôt déguisé. De Gua a abusé plusieurs fois, et toujours à son désavantage, de l’opinion qu’il est possible, d’après l’observation des faits passés, d’y saisir une loi, et de prévoir les événements futurs avec quelque probabilité. Il lui arriva, en effet, de donner des conjectures sur quelques phénomènes météorologiques presque pour des prédictions ; lorsqu’elles manquèrent, l’opinion exerça contre lui une sévérité très rigoureuse.
Un coûteux procès absorbait encore la plus grande partie du revenu très modique de de Gua qui, frappé de l’idée qu’il avait essuyé une injustice dans le partage des biens d’un de ses frères, voulut, livré à de vaines espérances, en poursuivre la réparation. Ce sentiment l’emporta sur le véritable intérêt de de Gua, qui se dissimulait qu’il en coûte pour défendre ou recouvrer une propriété d’une valeur médiocre, plus qu’il n’en coûterait pour l’acheter et que, pour suivre un procès sans se ruiner, il faut être en état de se passer de l’objet qu’on réclame.
Au milieu de ses malheurs, de Gua vit s’élever quelques jours sereins : en 1783, quoique vétéran depuis trente-sept ans, l’Académie le choisit comme un des trois sujets qu’elle présente pour les places de pensionnaires. Cette marque d’estime qu’il reçut d’une compagnie qui lui était toujours chère, fut pour lui un des événements les plus heureux de sa vie. Il reprit en un instant, malgré son âge et ses infirmités, son assiduité aux assemblées, son ardeur pour la géométrie, son zèle pour les fonctions académiques. Cette sensibilité, si touchante dans un vieillard que ses talents et sa pauvreté rendaient respectable, eut sa récompense.
Lorsque le 23 avril 1785, le roi créa deux nouvelles classes dans l’Académie, de Gua fut pensionnaire dans celle d’histoire naturelle, science qu’il avait longtemps cultivée. Mais du Gua ne jouit pas longtemps de cet avantage, ressentant au milieu de l’Académie, où il s’était fait porter malgré sa faiblesse, les premières atteintes de la maladie qui devait l’emporter. Il était également de la Société royale de Londres.