Pandémie de la grippe de 1918 - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Bilan et conséquences
Du fait, sans doute, de la priorité militaire de l'époque, et malgré la virulence de cette pandémie mondiale, aucune étude scientifique approfondie ne fut entreprise. Seuls, çà et là, des médecins isolés écrivirent de petits traités exposant les symptômes constatés, des statistiques de contamination ou de taux de mortalité. Les rares prélèvements conservés (par exemple dans de la paraffine solide) s'avèrent aujourd'hui dégradés et inutilisables.
On a par ailleurs constaté que la pandémie de 1918-1919 fut essentiellement caractérisée par trois faits :
- Un taux de mortalité induit (ce n'est pas la grippe qui tue directement) effrayant, avec une moyenne d'environs 3 % du milliard de grippés de l'ensemble de la planète.
- Une morbidité extrêmement élevée, c'est-à-dire un très grand nombre de cas, estimée à 50 à 70 % de la population mondiale atteinte. Ceci s'expliquant par le fait qu'il s'agissait d'un virus grippal de type nouveau vis-à-vis duquel la population ne possédait aucune immunité.
- Une courbe de mortalité tout à fait anormale, avec un pic sur les 20-40 ans, notamment aux alentours de 30 ans.
Ainsi, sur une population mondiale estimée à l'époque à environ 1,9 milliard d'individus, l'ensemble des estimations évaluent à plus d'un milliard le nombre de personnes atteintes par ce virus, sans distinction de continent, d'ethnie ou du niveau technologique de leur civilisation. Au contraire, bien que le taux de mortalité fût plus élevé chez les tribus primitives, du fait de l'absence de soins, ce furent les civilisations urbaines et industrialisées, à fortes concentration de population, qui furent les plus touchées du fait qu'elles favorisaient la propagation rapide du virus.
Au niveau humain, on estime le nombre de victimes compris entre 21 millions (d'après l'Institut Pasteur) et 50 millions d'individus (d'après l'OMS). Le consensus international penchant plutôt pour la première évaluation, et tranchant aux alentours de 30 millions de victimes.
Plus précisément, au cours de ces différentes vagues, les États-Unis, premier pays touché, perdirent près de 549 000 citoyens ; la France, modeste pays comparé aux États-Unis, en perdit pourtant près de 408 000, le Royaume-Uni 220 000 « seulement ». De l'Allemagne et de l'Autriche, alors dans le chaos de la défaite, ne ressortent aucune étude statistique. Globalement, en Europe occidentale, ce fut sans doute près de 2 à 3 millions de morts. L'Inde et la Chine, comme on l'a vu précédemment, eurent chacune environ 6 millions de morts. Le Japon en eut près de 250 000.
- Source : Institut Pasteur
En Océanie, le bilan fut variable. Le gouvernement des Samoa américaines isola l'archipel et parvint à protéger sa population. A l'inverse, les autorités néo-zélandaises des Samoa occidentales firent preuve de négligence, et 90% de la population fut infectée. 30% de la population adulte masculine, 22% des femmes et 10% des enfants périrent. Des navires quittant les ports néo-zélandais apportèrent la grippe aux Tonga, à Nauru et aux Fidji ; les taux de mortalité s'y élevèrent à 8%, 16% et 5%, respectivement. Le taux de mortalité en Nouvelle-Zélande elle-même fut de 5%.
Pour les autres pays, tels que les colonies africaines, l'Amérique du Sud et la Russie (alors en pleine refonte communiste), il n'est fait mention nulle part de quelconques statistiques, mais on peut, en fonction des populations de l'époque et de la mortalité moyenne, y estimer le nombre de morts total à près de 6 millions. Probablement plus. On obtient ainsi de 20,5 millions à 21,5 millions de morts dus à cette pandémie.
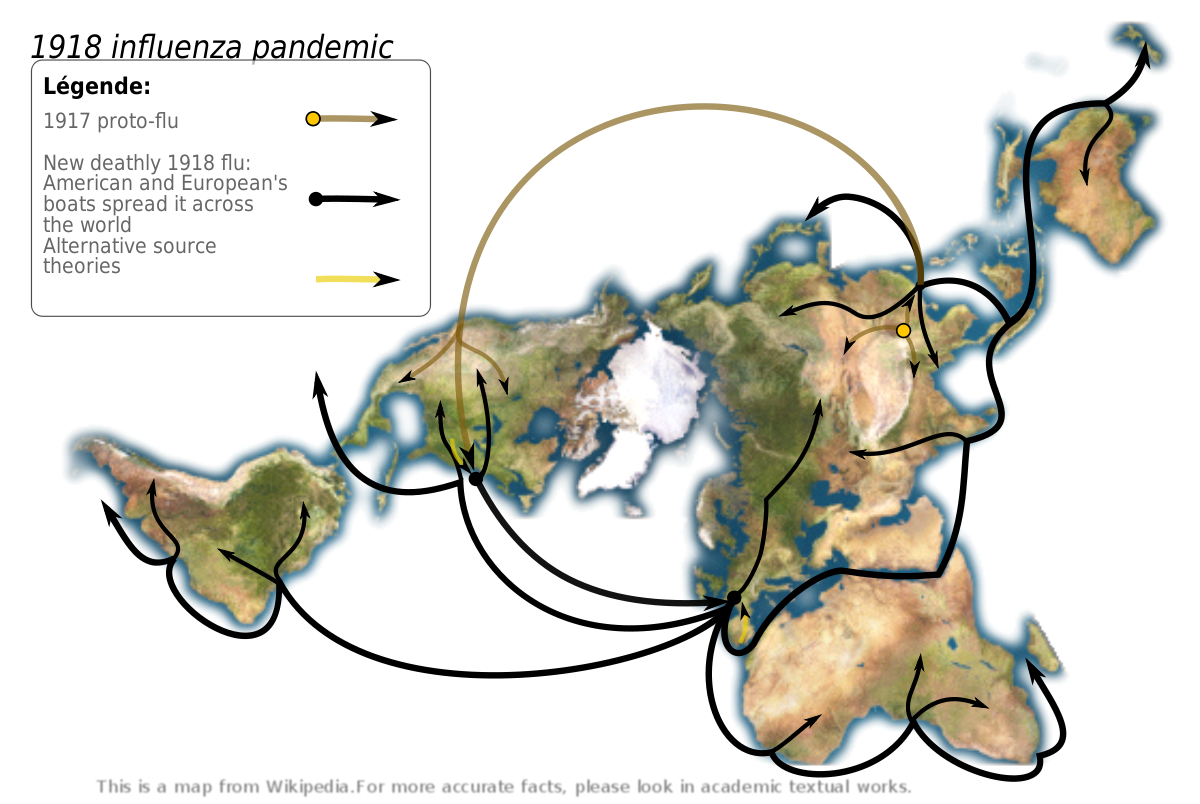
Après plus de 30 millions de morts emportés par la guerre et cette grippe, et au maximum le double : 60 millions, la pandémie s'acheva définitivement vers le début de l'été 1919. Tout le monde se réjouit, dans ce monde qui, après 4 ans de guerre suivis de cette pandémie, était à reconstruire.
Cependant, un oubli anodin d'alors a aujourd'hui son importance : aucune souche n'ayant pu être conservée, aucune étude n'a pu être faite sur l'origine de sa contagiosité et de sa virulence, l'une comme l'autre restant inexpliquées.
Pour en savoir plus sur ses propriétés, nous sommes ainsi obligés de nous contenter de l'étude du virus de la grippe en général.

















































