Cengeps - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Introduction
| Centre national de gestion des essais de produits de santé | |
|---|---|
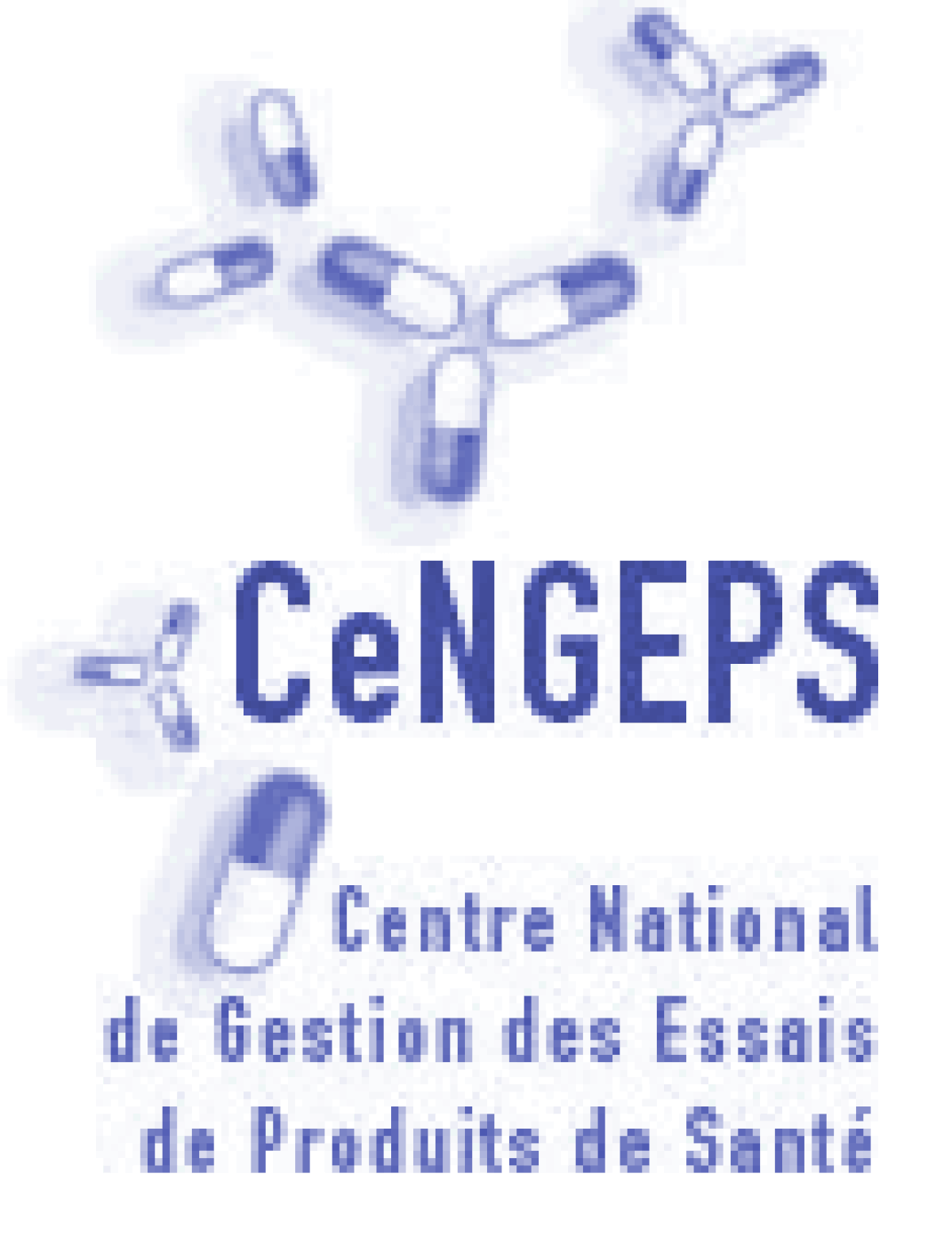 | |
| | |
| Création | Mars 2007 |
| Siège | Hospices civils de Lyon, Lyon |
| Pays |
|
| Directeur | Vincent Diebolt |
| Disciplines | Pharmacie |
| Site internet | http://www.cengeps.fr/ |
| modifier | |
Le Groupement d’intérêt public « CeNGEPS » (centre national de gestion des essais de produits de santé) a été créé fin mars 2007 (publication au Journal officiel du 28 mars 2007) pour une durée de quatre ans. Il est présidé par le Pr Patrice Jaillon, chef du service de pharmacologie de l’hôpital St-Antoine à l’AP-HP. Son directeur est Vincent Diebolt, directeur d’hôpital, qui a dirigé le pôle « recherche § innovation » de la Fédération hospitalière de France pendant quatre ans et demi.
Exemple même de partenariat public/privé en matière de recherche, le GIP « CeNGEPS » a été initié lors des rencontres du Conseil stratégique des industries de santé (CSIS). Cette instance de discussion a été mise en place en 2005 par le Premier ministre de l’époque, Jean-Pierre Raffarin, pour renforcer l’attractivité de la France pour les industries de santé, sur le modèle du «Pharmaceutical Industry Competitiveness Task Force » (PICTF) créé par Tony Blair en Grande-Bretagne. Elle associe au plus haut niveau les pouvoirs publics représentés par le 1er ministre, les ministres de la santé, de la Recherche, de l’Économie, Finances et Industrie et des représentants des laboratoires pharmaceutiques.
Mission
« Recruter plus, plus vite et mieux » dans les essais cliniques industriels en France ». Il a pour mission de renforcer les performances de l’organisation de l’expérimentation médicale en France afin d’en faciliter la réalisation, d’augmenter le nombre de sujets inclus et d’accélérer l’obtention des résultats. La vocation du CeNGEPS n’est pas de réaliser lui-même des essais cliniques ou de conduire une activité d’expérimentation médicale. Il est de garantir que cette expérimentation pourra se dérouler sans heurts dans les meilleures conditions avec l’infrastructure nécessaire.
Nature juridique du GIP CeNGEPS
Le CeNGEPS est un groupement d’intérêt public, une formule juridique créée par l’article 21 de la loi 83 -610 du 15 juillet 1982 qui permet d’associer, dans un objectif commun, au sein d’une même personne morale de droit public structure des personnes morales de droit public et de droit privé.
Le GIP est composé de neuf membres :
- l’Inserm détenteurs de 9% de parts.
- les sept Délégations inter-régionales de recherche clinique (DIRC) détentrices de 6% chacune.
- le Leem (les entreprises du médicament), syndicat représentant les laboratoires pharmaceutiques en France, détenteur de 49% des parts du GIP.
Quatre partenaires associés participent à ses instances avec compétence consultative:
- l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).
- la Fédération hospitalière de France (FHF).
- la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (FNCLCC).
- l’Association de la conférence des présidents d’université pour la recherche (ACPUR).
Contexte de mise en place : l’expérimentation médicale, une cause nationale ?
Fonction de l'expérimentation médicale
L’expérimentation humaine des produits de santé fait partie des étapes de développement des innovations médicales et conditionne leur utilisation et leur commercialisation. Elle est précédée d’études in vitro et d’expérimentations animales en particulier dans le domaine de la pharmacodynamie, de la pharmacocinétique et de la toxicologie. L’expérimentation clinique sur l’homme du médicament comprend trois phases successives qui permettent de tester sur un nombre de plus en plus important, d’abord de volontaires sains, puis de patients, l’efficacité et l’innocuité d’une nouvelle molécule ou d’un nouveau dispositif médical. Ce développement en trois étapes permet également de déterminer la posologie et les indications d’utilisation. Cette expérimentation ne peut être assurée que par des médecins, qui sont appelés investigateurs.
L’expérimentation du médicament ne s’arrête pas une fois obtenue l’autorisation de mise sur le marché (AMM) qui autorise sa commercialisation. Les essais cliniques peuvent être réalisés tout au long du cycle de vie d’un produit et ne sont pas cantonnés aux étapes qui précédent sa commercialisation. Un médicament, même lorsque son efficacité et ses conditions d’utilisation ont été définies, est susceptible d’extensions d’indications dans des pathologies ou des groupes de patients où son efficacité n’avait pas été testée au départ.
Parce que leur réalisation dépend de la mobilisation de patients, les essais cliniques associent, à des niveaux d’implication variable, l’ensemble des opérateurs de santé :
- en priorité les établissements hospitaliers
- pour les essais en cancérologie, les centres de lutte contre le cancer
- les cabinets de médecine de ville
- etc.
Importance de l’expérimentation médicale
L’expérimentation médicale est une étape déterminante dans la poursuite du progrès médical.
L’activité d’expérimentation :
- permet aux patients de bénéficier en France d’un accès accéléré à l’innovation médicale
- constitue un mode de formation continue pour les praticiens de santé leur permettant d’enrichir leur arsenal diagnostique et thérapeutique
- contribue à maintenir l’implantation des centres de recherche § développement des laboratoires pharmaceutiques en France qui emploient aujourd’hui 100 000 personnes
- participe, par l’activité de publication qu’elle génère, au renom international des équipes associées
C’est l’un des indicateurs pris en compte pour déterminer l’allocation financière de l’assurance-maladie aux établissements publics de santé au titre de leur activité de recherche.
Les menaces pesant sur le maintien de l'expérimentation médicale
Plusieurs indicateurs attestent des menaces qui pèsent sur l’activité d’expérimentation médicale en France:
- Des indicateurs chiffrés :
- diminution de 32% du nombre de nouveaux essais cliniques réalisés en France de 1998 à 2006 (1467 essais cliniques à promotion industrielle en 1998 pour 1000 essais en 2007/source Afssaps).
- faible taux de recrutement de patients par centre, la France s’éloignant de la moyenne européenne (6,3 en France v/7,5 en Europe).
- des délais de signature des conventions hospitalières pour la mise en place des essais cliniques qui vont jusqu’à 299 jours entre la 1ère déclaration et la dernière convention hospitalière signée
- Une image ternie auprès des grands laboratoires pharmaceutiques :
l’organisation de la recherche clinique en France est jugée moins performante que celle des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne par les laboratoires pharmaceutiques
Or un jour de délai en plus pour l’obtention des résultats des essais, c’est un jour de commercialisation en moins pour les industriels et c’est plus de temps passé, donc du temps perdu pour les structures où sont menées les expérimentations.


















































