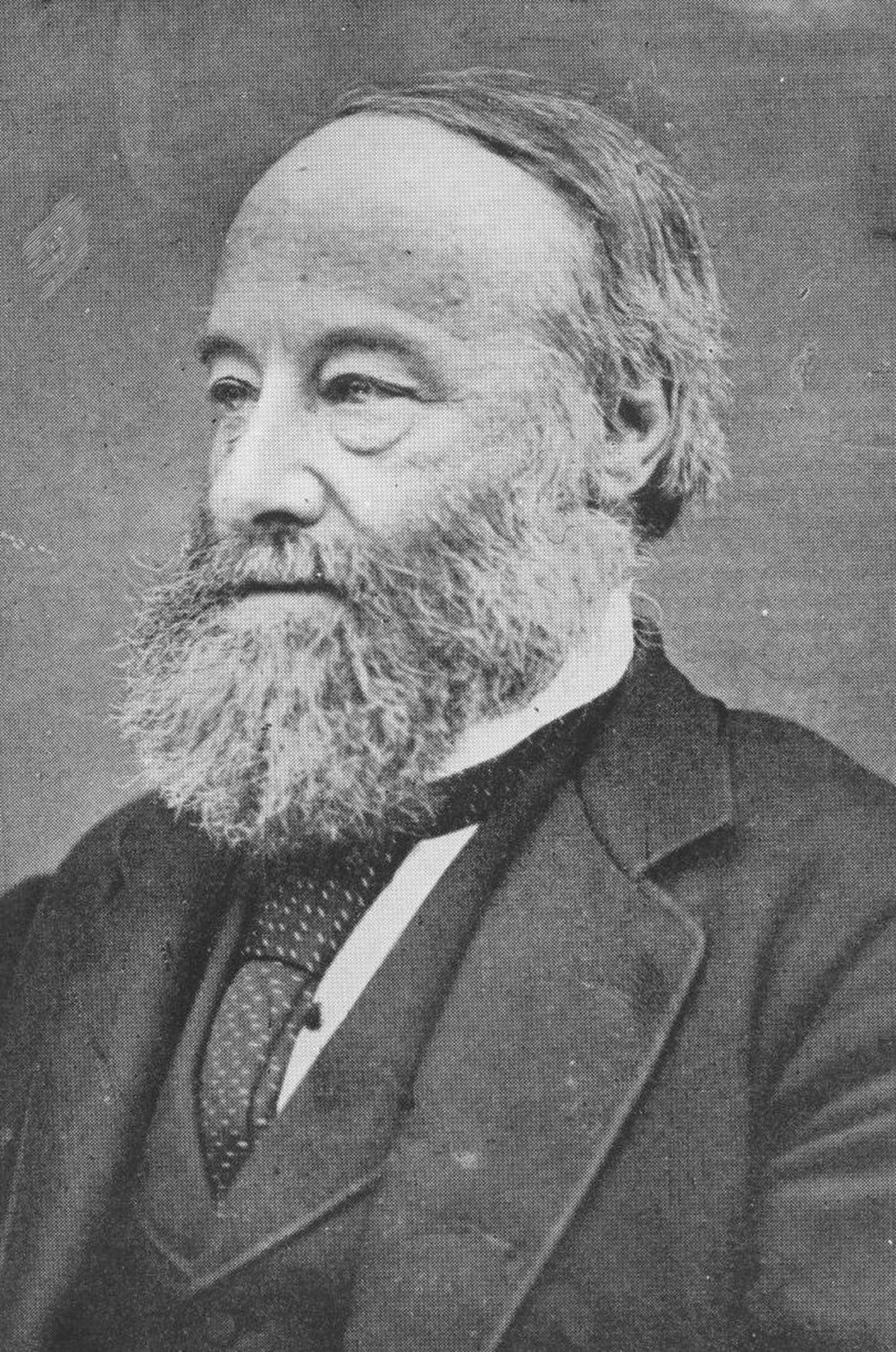Sadi Carnot (physicien) - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Le doute ou les ingrédients d’une tragédie
Une question demeure : pourquoi Sadi Carnot ne fit-il rien paraître entre les huit années qui séparèrent la publication des Réflexions de la date de sa mort ? Même si plusieurs explications peuvent être avancées, la raison la plus probable est qu’il n’avait plus confiance dans ses théories et qu’il se serait trouvé incapable de fonder une nouvelle théorie de la chaleur. Avec le calorique, Sadi Carnot se trouvait face à un des obstacles épistémologiques les plus difficiles à surmonter et cher à Gaston Bachelard : le substantialisme c’est-à-dire l’explication monotone des propriétés physiques par la substance.
Parmi ses écrits posthumes, un manuscrit intitulé Recherche d’une formule propre à représenter la puissance motrice de la vapeur d’eau, rédigé entre novembre 1819 et mars 1827 mais probablement après les Réflexions, fut conservé. Dans celui-ci il ébauchait la première loi de la thermodynamique, en tentant de préciser le lien entre travail et chaleur. Cette note fut finalement publiée en 1878, c’est-à-dire trop tardivement pour pouvoir influer sur le développement de la science, par Hippolyte dans un volume édité en hommage à son frère dans lequel il inséra une « Notice biographique sur Sadi Carnot ». C’est sans doute au printemps 1832 que Sadi découvre le principe de l’équivalence et qu’il reprend les conclusions d’un long mémoire, qui fut finalement détruit par Hippolyte, dans de brèves notes. Ces notes publiées également en 1878, indiquent qu’il avait alors renoncé à la théorie du calorique qui imprégnait encore son essai de 1824, et au sujet de laquelle il avait déjà émis des doutes dans les Réflexions. Il semble qu’il avait admis que la chaleur n’est rien de plus que de la puissance motrice (nous dirions aujourd’hui de l’énergie), proposant avec dix ans d’avance sur Julius Robert von Mayer une valeur numérique de l’équivalent mécanique de la chaleur à 2 % près et obtenue semble-t-il avec plus de rigueur scientifique.
Pour valider ses avancées, il avait esquissé des expériences détaillées, que nous dirions aujourd’hui à enthalpie constante, et semblables à celles de Benjamin Thompson. Mais à la différence de celui-ci, il avait l’intention de mesurer le travail fourni et la chaleur produite, tout en faisant varier les matériaux utilisés. Dans ce sens, il espérait fermement trouver un équivalent mécanique constant de la chaleur et qui aurait eu la même valeur pour toutes les expériences. Il envisageait aussi des mesures utilisant des gaz et des liquides pour calculer l’équivalent mécanique de la chaleur.
Il est difficile de savoir s’il aurait pu effectuer ces expériences de façon satisfaisante. L’histoire de la thermodynamique était encore longue pour parvenir à la théorie, de sorte qu’on ne peut guère sous-estimer les difficultés qu’il aurait dû surmonter.
Il aurait aussi fallu convaincre, en particulier le grand corps des chimistes et de ceux qui faisaient des recherches sur l’électricité : tous étaient profondément attachés à la théorie du calorique. Enfin, il faut attendre James Prescott Joule pour voir la théorie dynamique de la chaleur enfin formulée. Sept ans séparent encore sa première publication (1843) et la publication de Rudolf Clausius qui mettait en accord la théorie dynamique de la chaleur (Joule) et les théories de Sadi Carnot.
Au final, il est regrettable mais malheureusement probable que Sadi Carnot soit mort en croyant qu’il avait échoué alors qu’il fonda tout simplement une branche de la science vaste et fondamentale, aux structures complexes, la thermodynamique, qui relie entre elles la physique, la chimie, la biologie et même la cosmologie.