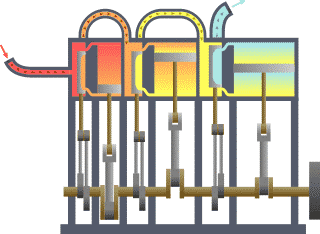Thermodynamique - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Introduction
On peut définir la thermodynamique de deux façons simples : la science de la chaleur et des machines thermiques ou la science des grands systèmes en équilibre. La première définition est aussi la première dans l'histoire. La seconde est venue ensuite, grâce aux travaux pionniers de Ludwig Boltzmann.
Avec la physique statistique, dont elle est désormais une partie, la thermodynamique est l'une des grandes théories sur lesquelles se fonde la compréhension actuelle de la matière.
Science des grands systèmes en équilibre
Définir la thermodynamique comme la science de l’équilibre des grands systèmes est une approche à la fois très rigoureuse et très générale.
- Équilibre statistique et loi des grands nombres
Si l’on jette un même dé, bien équilibré, un grand nombre de fois, on est sûr par avance que les fréquences d’apparition de chacune des faces seront proches d'un sixième. Plus le nombre de lancers est grand, plus les fréquences sont égales parce que le dé « explore » également toutes les possibilités qui lui sont offertes. La même chose se produit si on verse une goutte de colorant dans un verre d’eau. Si on attend assez longtemps, le verre est devenu uniformément coloré parce que toutes les molécules ajoutées « explorent » également toutes les possibilités, les régions à l’intérieur du verre, qui leur sont offertes.
Ces observations peuvent être généralisées. Lorsqu’un système est très grand, et lorsqu’il y a un sens à parler de l’équilibre du système, on peut prédire avec certitude la destinée de l’ensemble alors même que les destinées des nombreux individus sont imprévisibles.
- Petitesse des atomes
On sait aujourd’hui que les atomes, très petits, existent. Dans chaque échantillon de matière, il y a un très grand nombre d’atomes, par exemple des milliards de milliards dans un minuscule grain de sable. La physique des corps macroscopiques est donc toujours une physique des grands systèmes.
- Équilibres thermiques
L’étude des équilibres thermiques a une immense portée. Toutes les formes de la matière (gaz, liquides, solides, semi-fluides,...) et tous les phénomènes physiques (mécaniques, électriques et magnétiques, optiques,...) peuvent être étudiés en raisonnant sur l’équilibre des grands systèmes. La thermodynamique, que l’on identifie alors plutôt à la physique statistique, est une des bases les plus solides sur laquelle est édifiée notre compréhension de la matière.
Science de la chaleur et des machines thermiques
Les notions de chaleur et de température sont les plus fondamentales de la thermodynamique. On peut définir la thermodynamique comme la science de tous les phénomènes qui dépendent de la température et de ses changements.
Chaleur et température
Chacun a une connaissance intuitive de la notion de température. Un corps est chaud ou froid, selon que sa température est plus ou moins élevée. Mais une définition précise est plus difficile. L’un des grands succès de la thermodynamique classique au XIXe siècle, est d'avoir donné une définition de la température absolue d’un corps, qui a mené à la création de l'échelle kelvin. Celle-ci donne la température minimale pour tous les corps : zéro kelvin, soit -273,15°C. Il s'agit du zéro absolu, dont le concept apparaît pour la première fois en 1702 avec le physicien français Guillaume Amontons.
La chaleur est plus difficile à définir. Une ancienne théorie, défendue notamment par Lavoisier, attribuait à un fluide spécial (invisible, impondérable ou presque) les propriétés de la chaleur, le calorique, qui circulerait d’un corps à un autre. Plus un corps est chaud, plus il contiendrait de calorique. Cette théorie est fausse au sens où le calorique ne peut pas être identifié à une quantité physique conservée. La thermodynamique définit la chaleur comme un transfert d'énergie désordonnée d'un système avec le milieu extérieur. En effet l'énergie thermique correspond à l'énergie cinétique de molécules se déplaçant et subissant des chocs de manière aléatoire(appelés mouvement brownien). L'énergie transférée est dite désordonnée au niveau microscopique, par opposition au transfert d'énergie ordonnée au niveau macroscopique réalisé par le biais d'un travail.
Machines thermiques
La thermodynamique classique a pris son essor comme science des machines thermiques ou science de la puissance motrice du feu.
Sadi Carnot a initié les études modernes des machines thermiques dans un mémoire fondateur, Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance (1824). Le cycle de Carnot, étudié dans ce mémoire, reste le principal exemple théorique d’étude des machines thermiques. Plutôt que « puissance motrice », on dit aujourd’hui que les machines thermiques fournissent un travail, et on s’interroge sur la façon d’utiliser la chaleur pour produire du travail continu.
La chaleur est produite par le mouvement des corps macroscopiques. Il suffit de frotter ses mains pour s’en rendre compte. Inversement, la chaleur peut mettre des corps macroscopiques en mouvement. On peut les appeler des machines à feu ou machines thermiques. Systèmes macroscopiques, elles conservent leur mouvement tant qu’une différence de température entre une partie chaude et une partie froide est maintenue.
Exemples
Cette section présente quelques exemples où la puissance thermique joue un rôle.
- Une bougie allumée met en mouvement l’air qui l’entoure. Un courant ascendant est créé au-dessus de la flamme. Il est perpétuellement renouvelé par un courant d’air froid arrivant par en dessous. On peut les observer dans une pièce calme avec une plume de duvet ou en approchant une autre flamme. Il s'agit d'un courant de convection.
- L’eau dans une casserole sur le feu se met en mouvement comme l’air au-dessus de la bougie et comme tous les fluides au-dessus de surfaces suffisamment chaudes. Si on met un couvercle, un nouveau phénomène se produit. La vapeur soulève le couvercle, qui retombe ensuite pour être à nouveau soulevé, sans cesse jusqu’à épuisement du feu ou de l'eau, donc de la production de vapeur. On raconte que cette simple observation, que l’on peut faire dans toutes les cuisines, est liée à l’invention des machines à vapeur. Le mouvement du couvercle est trop petit pour être intéressant. Il s’arrête aussitôt commencé, car la vapeur qui le pousse s’échappe tout de suite. Mais si on met le couvercle dans un cylindre, on obtient un piston qui peut être poussé par la vapeur ou tout autre gaz sur une longue course. Les machines à vapeur et les moteurs thermiques ne sont pas toujours construits sur le principe du piston et du cylindre. Les autres solutions ne sont pas très différentes. On peut considérer que l’expérience du couvercle de la casserole est à l’origine des inventions de tous les moteurs thermiques.
- Avant les travaux de Sadi Carnot, les hommes connaissaient la turbine à vapeur. Elle se compose d'une boule de métal en rotation sur un axe. L’eau qu’elle contient est chauffée par en dessous. Deux jets de vapeur tangentiels et opposés mettent alors la boule en mouvement. Ce système n’a pas été amélioré avant les temps modernes. Les réacteurs des avions d’aujourd’hui (turbines à gaz) fonctionnent en grande partie sur le même principe que cet ancêtre de la turbine.
- La puissance motrice du feu a été beaucoup plus développée pour faire des armes. La balle, l’obus, ou tout autre projectile, est poussé dans le canon par un gaz très chaud produit par la combustion de la poudre ou de tout autre explosif. Le canon forme un cylindre dans lequel circule un projectile qui forme le piston.
- Les fluides de la surface terrestre, l’atmosphère et les océans, sont mis en mouvement par la chaleur du Soleil. Pour les océans, la gravitation joue aussi un rôle dans les marées. La puissance du vent est donc une forme de la puissance motrice du feu.