Sadi Carnot (physicien) - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Place de Sadi Carnot dans l’histoire des sciences
Influence de l’œuvre de Lazare Carnot sur celle de son fils
Pour l’historien des sciences, plusieurs questions se posent quant à la relation qu’entretiennent les œuvres des deux ingénieurs :
- Comment se fait-il que Lazare ainsi que Sadi, aient énoncé certaines propositions qui, une génération plus tard, devaient devenir fondamentales dans la physique de l’énergie, tandis que leurs contemporains n’en avaient pas remarqué l’intérêt ? Chez Sadi, il s’agit de la relation symbolisée par l’expression
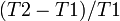


- L’idée de processus réversible chez Sadi représente-t-elle l’application à l’analyse des machines à feu de la théorie des mouvements géométriques développés par son père ?
- Enfin, existe-t-il une méthode originale imaginée par Lazare pour sa « science des machines », méthode que Sadi aurait appliquée aux machines à feu ?
Une œuvre de synthèse
Pour D.S.L Cardwell, le livre de Sadi Carnot, quoi que beaucoup moins connu que De revolutionibus orbium coelestium de Copernic, a une importance comparable dans l’histoire de la science moderne car il a permis, fait particulièrement rare, de poser les bases d’une discipline entièrement nouvelle : la thermodynamique.
Pourtant l’œuvre de Carnot possède une dimension originale. Copernic travaillait dans une discipline clairement définie et reconnue ; il pouvait s’appuyer sur un héritage fait de réflexions et d’observations accumulées pendant deux millénaires (les éphémérides). Sadi Carnot, quant à lui, a dû faire œuvre de synthèse entre différentes disciplines scientifiques et techniques. Pour cela il a fallu sélectionner les données à étudier, construire des théories à partir de concepts, lois et principes tirés des sciences de la chaleur et de la mécanique, qui étaient encore séparés, de technologies en plein développement comme la vapeur ou déjà plus établies comme l’hydraulique, mais qui étaient également encore sans liens entre elles. Par ailleurs, lui seul voyait en 1824 le besoin de cette science nouvelle, à la fois pour ses applications pratiques mais aussi pour des raisons fondamentales.
La révolution carnotienne
D’un point de vue plus général, les travaux de Sadi Carnot marquèrent le début de ce que Jacques Grinevald appelle la Révolution carnotienne et qui nous fait basculer dans une société thermo-industrielle avec l’utilisation massive de l’énergie fossile (charbon puis pétrole). Désormais la puissance du feu permet l’avènement d’une machine nouvelle, construite autour d’un moteur, et qui constitue une bifurcation dans l’histoire de l’outil. Elle permet l’éviction de la force motrice de l’homme, de l’animal, des éléments naturels habituels comme le vent et l’eau pour donner sens à la vieille représentation collective des créatures animées qui va d’Héphaïstos au fantôme électrique d’Hadaly. Parallèlement cette puissance motrice du feu va distendre le lien millénaire entre technique et milieu géographique immédiat, avec le développement sans précédent des réseaux et des flux et la concentration géographique des équipements qui devient possible par la délocalisation de cette puissance.
En forme de bilan
Sadi Carnot a découvert les deux lois sur lesquelles repose toute la science de l’énergie malgré des obstacles qui paraissaient insurmontables. Il a donné une mesure de la puissance exceptionnelle de son intuition en énonçant ses lois quand les faits étaient en nombre insuffisant, leur précision grossière et surtout quand les progrès de la science naissante étaient freinés par la théorie erronée du calorique indestructible.
Il a intuitivement décidé que la machine à vapeur ressemblait au vieux moulin à eau, qui produit de l’énergie en faisant tomber de l’eau d’un niveau élevé à un niveau plus bas, qu’elle produit de l’énergie en faisant tomber de la chaleur de la température élevée de la chaudière à celle plus basse du condenseur. Il a senti que cette différence de température était un phénomène clair, mais que la chute de la chaleur elle-même l’était beaucoup moins et il a eu soin dans sa loi de faire jouer le rôle essentiel à la chute de température. Nous dirions aujourd’hui qu’il a deviné qu’il y avait une différence entre la chaleur-forme d’énergie et la chaleur-tombant comme l’eau du moulin. Nous savons qu’il a fallu 40 ans après son livre pour définir l’entropie à partir de la quantité de chaleur comme étant l’équivalent de l’eau du moulin et nous admirons qu’il ait évité ce problème délicat et finalement rejeté le premier la théorie du calorique.
Avec sa portée universelle, son œuvre constitue probablement un cas unique dans l’histoire de la science moderne et, en ce sens, Nicolas Léonard Sadi Carnot fut certainement l’un des penseurs les plus pénétrants et les plus originaux que notre civilisation ait produits.
Pour certains, il restera « un météore dans l’histoire des sciences », une figure singulière pour qui « avec une feuille de papier, une plume de crayon et un esprit, avoir créé la base d’une nouvelle science, relève d’un esprit tout à fait admirable ». « La mort des grands hommes laisse autant de regrets que d’espoirs inédits ».


















































