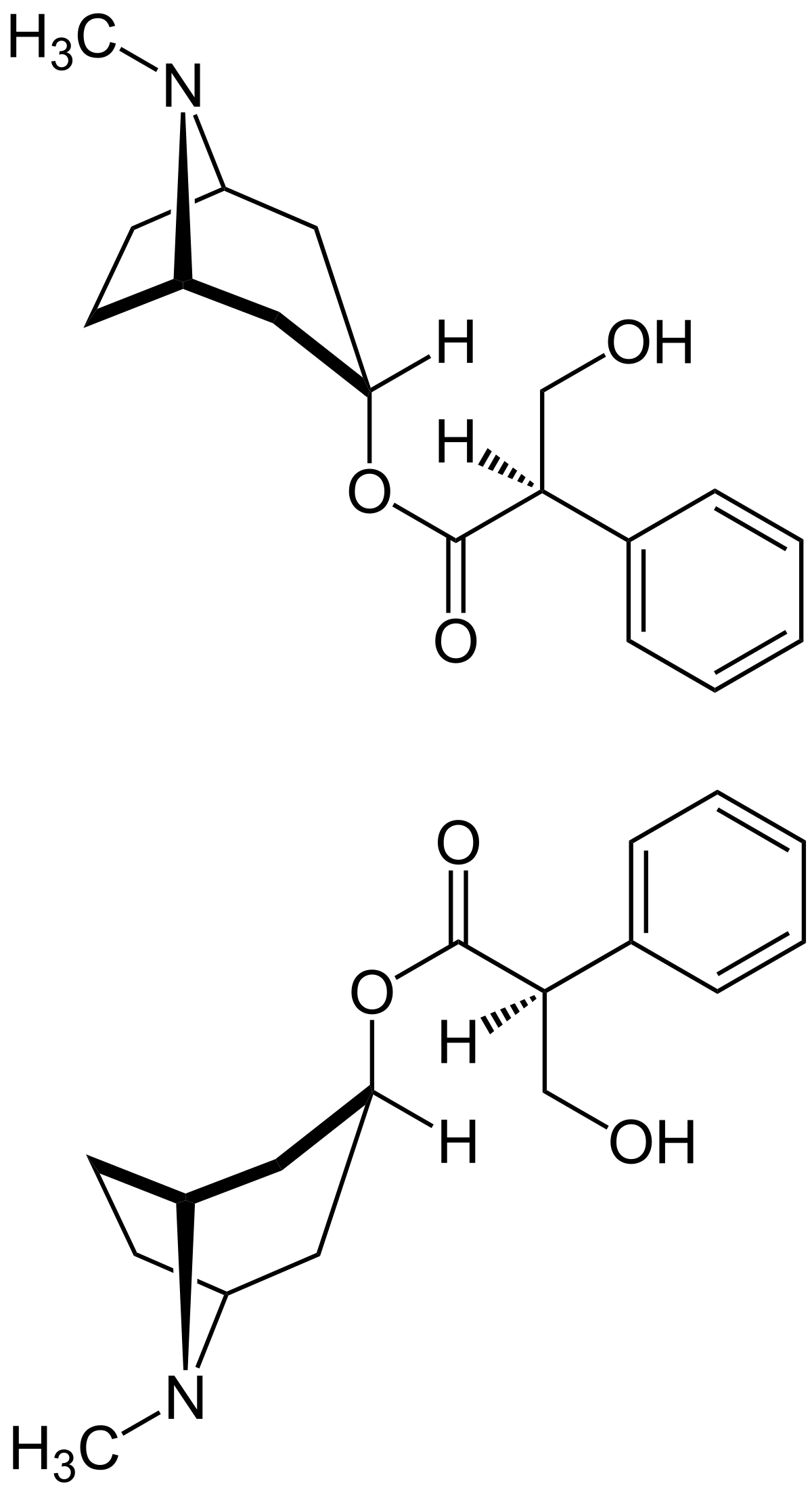Atropine - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Usage médical
En inhibant les récepteurs cholinergiques muscariniques, l'atropine diminue le tonus du parasympathique, si bien que l'influence du sympathique devient prépondérante.
Effets utiles
Au niveau périphérique, elle induit surtout des effets parasympatholytiques. Ainsi, à dose thérapeutique, elle provoque une accélération cardiaque, une diminution des sécrétions (sueur et salive), un relâchement des muscles lisses et une mydriase (dilatation de la pupille) prononcée (assuré par le système sympathique). Cette dernière propriété est mise à profit en ophtalmologie pour faciliter l'examen de l'œil. En administration locale sous forme de collyre, l'atropine a une très longue durée d'action.
En s'opposant à l'effet de l'acétylcholine sur les muscles lisses, l'atropine les relâche. Elle a donc une action antispasmodique.
Indications
- C'est le médicament de choix, par voie intra-veineuse ou souscutanée, contre le malaise vagal. L'atropine est également utilisée pour accélérer la fréquence cardiaque en cas de bradycardie transitoire et lors de certains troubles de la conduction cardiaque notamment lors d'un infarctus du myocarde.
- L'atropine s'utilisait aussi pour diminuer les tremblements chez les parkinsoniens. Elle est remplacée par des antiparkinsoniens de synthèse possédant des propriétés atropiniques et par la L-Dopa.
- Avant les interventions chirurgicales, elle est utilisée en prévention de la bronchosécrétion, du bronchospasme, et du laryngospasme.
- Mal des transports (akinétose).
- Antidote à certaines intoxications (gaz neurotoxiques à usage militaire, pesticides, etc.).
Sa durée d'action est relativement courte.
Effets secondaires
- Sécheresse de la bouche par arrêt de salivation
- Sécheresse de la peau par arrêt de sudation
- Hypertonie oculaire
- Constipation
- Élévation de la température corporelle par vasodilatation au niveau de la peau et l'absence de sueur
- Vision trouble pour la lecture de près (arrêt de l'accommodation)
- Rétention d'urine chez les personnes prédisposées (hypertrophie de la prostate)
L'atropine peut provoquer une grave intoxication à la dose de 10 mg (ce qui représente plus de dix fois la dose habituelle), qui peut ensuite provoquer la mort par dépression de la respiration et par dépression du système cardio-vasculaire. À doses importantes, elle stimule d'abord, puis induit excitation et délire en perturbant la mémoire avant de provoquer une paralysie, un coma, puis la mort.
- Inhibition de nombreuses sécrétions physiologiques (sécrétions nasales, bronchiques, pancréatiques, gastriques, etc.).
- Accentuation des sensations douloureuses.
Utilisation en médecine vétérinaire lors d'intoxication aux organophosphorés et aux carbamates (pesticides).
Contre-indications
- Hypertrophie de la prostate
- Glaucome à angle fermé
- Myasthénie
- Bronchite chronique
Précautions d'utilisation
L'atropine passe la barrière placentaire.