Bernard Courtois - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Découverte de l'iode
Découverte d'un nouveau corps
Il quitte le laboratoire Seguin en 1804 et se consacre essentiellement à l'industrie. Cette même année, il s'endette avec son père de près de 32 528 francs afin de reprendre à Paris une salpêtrière artificielle (fabrique de salpêtre). Il reprend cette activité à Paris au moment où les guerres napoléoniennes réclament le salpêtre nécessaire à la fabrication de la poudre à canon. Des procédés nouveaux sont inventés. En tant que responsable de la régie des poudres, Antoine Lavoisier donne à cette activité une nouvelle rationalité. Le salpêtre est élaboré dans des « salpêtrières » où le développement des bactéries nitrifiantes sur des mélanges terreux appropriés est favorisé. Les terres enrichies en salpêtre doivent alors être lessivées. Les eaux-mères obtenues sont ensuite traitées par des cendres de bois riches en potasse afin d’obtenir la cristallisation du salpêtre. Bernard Courtois utilise ces nouveaux procédés qu'il améliorera par la suite. Il est enregistré comme un industriel parisien en février 1806, en tant que salpêtrier au 39, rue Sainte-Marguerite, adresse de la nitrière de son père, vendue en mai de la même année. Il ouvre sa propre nitrière au 9 rue Saint-Ambroise à Paris. En 1808, il se marie avec Madeleine Morand, la fille d'un coiffeur parisien.
Il ne se doute pas, qu’en passant de la recherche pure à l’industrie, il va découvrir un nouveau corps qui se révélera si utile en médecine : l’iode.


Tout commence avec la poudre à canon. Pour fabriquer cette poudre, on lessive des terres contenant du salpêtre. Puis, sur les eaux ainsi obtenues, on fait agir des cendres de bois riches en potasse, ce qui provoque la cristallisation du salpêtre.
Après filtration et évaporation, le salpêtre cristallise. Ce procédé est peu efficace, car une bonne part du potassium présent dans les cendres réagit avec d'autres cendres calciques. Par ailleurs, les cendres de bois sont à cette époque de guerres napoléoniennes, peu disponibles notamment à cause du blocus commercial organisé autour de la France rendant difficile l’approvisionnement en cendres potassiques dont la Suède est le principal fournisseur. Elles sont donc beaucoup plus chères que le varech (algues marines) et ses cendres. Pour ces deux raisons d'amélioration du procédé chimique et d'économies de bois, Bernard Courtois utilise les cendres de varech, abondant sur les côtes de Bretagne. Sa découverte en 1811 de l'iode est l'objet de plusieurs versions.
- Selon les uns, c'est en ajoutant accidentellement une trop grande quantité d'acide chlorhydrique à la solution d'extraction de cendre d'algues servant à préparer la potasse nécessaire à l'isolement du salpètre, qu'il provoque un nuage de vapeur violette qui se condense en cristaux d'iode.
- Selon une autre version, c'est le fait que l'iode des algues corrode ses récipients qui aurait attiré son attention sur cette substance. En effet, il aurait remarqué que les chaudières servant à la préparation du nitrate de soude étaient rapidement perforées. Il en étudie les causes et trouve que le cuivre se combine avec une substance inconnue. Il poursuit ses recherches et obtient un corps simple : l'iode.
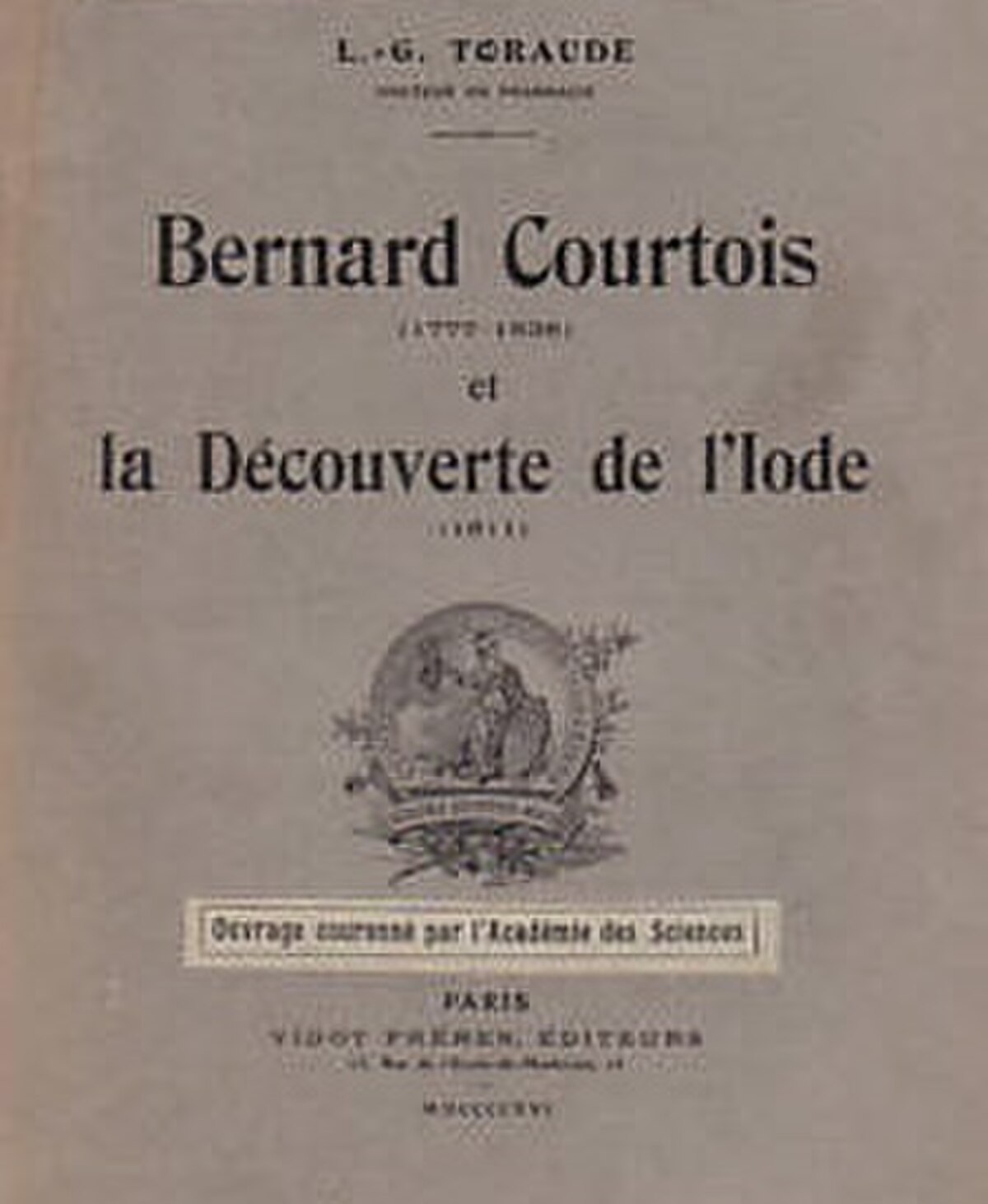
Il commence à étudier les propriétés de ce nouveau corps par des combinaisons avec d'autres. Dès 1812, Bernard Courtois se penche sur les applications de l'iode à la photographie. Cependant par manque de temps ou d'argent, il en laisse ensuite l'étude à deux chimistes de sa connaissance et d'origine dijonnaise comme lui : Charles-Bernard Desormes et Nicolas Clément, qui publient leurs recherches en 1813. Trop occupé par l’exploitation de sa nitrière, Bernard Courtois cesse ses travaux sur l’iode.
« Bernard Courtois découvrit, en 1811, dans les eaux-mères des cendres de varech, une matière solide noirâtre, dont il ébaucha l'étude. Mais, détourné des travaux de laboratoire par les soins qu'exigeait une fabrication très active de salpêtre et de plusieurs autres produits, il engagea Clément à continuer ses recherches ; celui-ci en communiqua les résultats à l'Académie des sciences le 6 décembre 1813. Les eaux-mères des lessives de varech, dit Clément, contiennent en assez grande quantité une substance très singulière et bien curieuse ; on l'en retire avec facilité : il suffît de verser de l'acide sulfurique sur les eaux-mères, et de chauffer le tout dans une cornue dont le bec est adapté à une allonge, et celle-ci à un ballon. La substance qui s'est précipitée sous la forme d'une poudre noire brillante, aussitôt après l'addition de l'acide sulfurique, s'élève en vapeur d'une superbe couleur violette quand elle éprouve la chaleur ; cette vapeur se condense dans l'allonge et dans le récipient, sous la forme de lames cristallines très brillantes et d'un éclat égal à celui du plomb sulfuré cristallisé ; en lavant ces latines avec un peu d'eau distillée, on obtient la substance dans son état de pureté. »
— Louis Figuier, Les Merveilles de la Science, la Photographie, librairie Furne, Jouvet et Cie, Paris, 1868
Les biographes de Bernard Courtois étaient partagés sur l'année de la découverte de l'iode, entre 1811 et 1812. La commission de l'Académie des sciences finit par retenir 1811, après avoir retrouvé une lettre de la veuve Courtois.
Controverse sur sa découverte
La découverte de l'iode fût l'objet de nombreuses controverses. En effet, Bernard Courtois trop occupé par sa nitrière, n'avait pas pris le soin de publier sur ce nouveau corps. En revanche, ayant délégué l'étude de l'iode et donné de nombreux échantillons à d'autres chimistes, il y eut controverse sur son découvreur, notamment entre les chimistes Humphry Davy et Louis-Joseph Gay-Lussac.
« Un des échantillons que Courtois avait distribués, était tombé dans les mains de Humphry Davy, qui se trouvait accidentellement en France. Frappé des singulières propriétés de ce corps, le chimiste anglais en fit aussitôt l'objet d'une étude rapide et, dans une lettre qu'il adressa à Cuvier, et que ce dernier lut à l'Institut le 13 décembre, il examina ses combinaisons avec le potassium, le sodium, les métaux et quelques gaz. Enfin, le 27 décembre de la même année, M. Colin, alors répétiteur à l'École polytechnique lut également à l'Institut une note sur quelques nouvelles combinaisons de l'iode : expériences exécutées sous les yeux et sous la direction de M. Gay-Lussac. L'empressement qu'avait mis Humphry Davy à publier ses premiers résultats, immédiatement après les premières communications faites à l'Institut, et les insinuations des journaux anglais qui tendaient à en reporter la priorité sur leur compatriote, indisposèrent M. Gay-Lussac, au point que ce chimiste crut devoir rétablir les faits, dans son grand mémoire sur l'iode, publié le 1er août de l'année suivante. »
— Paul-Antoine Cap, Études biographiques pour servir à l'histoire des sciences, 1857

Voici dans quels termes Gay-Lussac présente l'historique de la découverte de l'iode par Bernard Courtois.
« Il y avait près de deux ans que M. Courtois avait fait la découverte de l'iode, lorsque M. Clément l'annonça à l'Institut le 29 novembre 1813. M. Courtois avait observé plusieurs de ses propriétés, et particulièrement celle qu'il a de former une poudre très-fulminante, lorsqu'on le traite par l'ammoniaque. Il s'était proposé d'en faire connaître tous les caractères, mais, détourné des travaux de laboratoire par les soins qu'exigeait une fabrication très-active de salpêtre et de plusieurs autres produits, il engagea M. Clément à continuer ses recherches. M. Clément, par des motifs semblables, ne put y consacrer que quelques moments. Néanmoins, il découvrit, entre autres résultats, qu'en mettant l'iode en contact avec le phosphore, on obtenait un acide gazeux, mais il conclut de ses expériences que ce gaz était composé de 1/4 d'acide muriatique et de 3/4 d'iode... M. Clément était encore occupé de ses recherches, lorsque M. Davy vint à Paris, et il crut ne pouvoir mieux accueillir un savant aussi distingué, qu'en lui montrant la nouvelle substance qu'il n'avait encore montrée qu'à MM. Chaptal et Ampère. Je rapporte ces circonstances pour répondre à l'étrange assertion que l'on trouve dans le journal de MM. Nicholson et Tilloch, n° 189, p. 69 : « Il paraît que l'iode a été découvert depuis environ deux ans ; mais tel est l'état déplorable de ceux qui cultivent les sciences en France, qu'on n'en avait rien publié jusqu'à l'arrivée de notre philosophe anglais dans ce pays. » C'est de M. Davy que l'on parle. Peu de temps après avoir montré l'iode à M. Davy, et lui avoir communiqué le résultat de ses recherches, M. Clément lut sa note à l'Institut et la termina en annonçant que j'allais les continuer. Le 6 décembre, je lus en effet à l'Institut une note qui fut imprimée dans les Annales de chimie. Personne n'a contesté jusqu'à présent que je n'aie fait connaître le premier la nature de l'iode, et il est certain que M. Davy n'a publié ses résultats que plus de huit jours après avoir connu les miens. »
— Louis Joseph Gay-Lussac, Grand mémoire de l'iode, 1814
L'iode doit son nom en 1813 à Louis Joseph Gay-Lussac, à qui Bernard Courtois a donné des échantillons. Il la dénomme « iode », de « iodès » qui veut dire « violet » en grec, en raison des vapeurs violettes qu’elle dégage quand on la chauffe.



















































