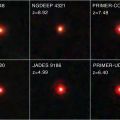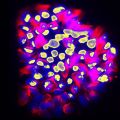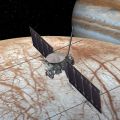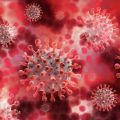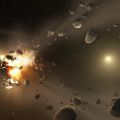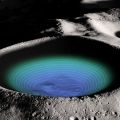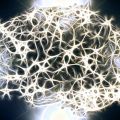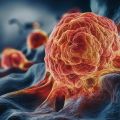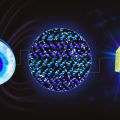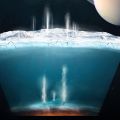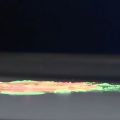Droit de l'espace - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
La question de la reconnaissance des organisations internationales par le Droit de l'Espace
Le Droit de l'Espace a été élaboré au sein de l'Organisation des Nations Unies et, plus précisément, du Comité des Nations Unies pour les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique (UNCOPUOS). Il s'agit d'un droit essentiellement inter-étatique dans lequel les organisations internationales ne sont pas reconnues sur le même pied que les États. La raison en est sans doute une certaine méfiance dans le contexte de la Guerre froide pour des organisations de type politique (OTAN, CEE) et la relative inexistence d'organisations spécialisées (naissance de l'ELDO et de l'ESRO, précurseurs de l'Agence spatiale européenne (ESA), en 1964 et de l'ESA elle-même en 1975).
Les traités de l'Espace ont prévu la possibilité pour les organisations internationales intergouvernementales d'accepter, par voie d'une déclaration ad hoc, les dispositions qui pouvaient être pertinentes à leur égard. Ces organisations ne deviennent donc pas parties à part entière, mais, en tant que parties acceptantes, elle peuvent devenir titulaires de droits et d'obligations vis-à-vis des autres parties à ces traités. L'acceptation par les organisations internationales est en outre subordonnée, par les traités eux-mêmes, à la condition qu'une majorité de leurs États membres soient parties au traité en question. Une exception remarquable toutefois: le Traité de l'Espace de 1967 ne prévoit pas une telle acceptation par une organisation internationale intergouvernementale. Il est possible pour une telle organisation, sur base d'un acte unilatéral, d'accepter les dispositions du Traité de 1967, mais cette acceptation n'aura pas d'effet synallagmatique.
En pratique, cette restriction à la capacité d'adhésion des organisations internationales n'a pas beaucoup de conséquences, même si le nombre d'organisations ayant fait une déclaration d'acceptation des traités reste très limité. Toutefois, sur certains points, l'absence de participation des organisations internationales au Traité de l'Espace de 1967 pose des questions d'ordre juridique. Ainsi en est-il de l'immatriculation des objets spatiaux: il n'est pas clair si l'immatriculation réalisée par une organisation internationale a pour effet d'étendre sa juridiction et son contrôle sur l'objet spatial puisqu'un tel effet est exclusivement prévu par le Traité de 1967 auquel elle n'est, par définition, pas partie.
Les principes fondamentaux
Le principe de la liberté d'accès et d'utilisation
Selon ce principe, devenu règle de droit international coutumier, aucun État ne peut se voir imposer des restrictions ou des conditions par un autre État pour accéder à l'espace extra-atmosphérique, l'explorer et l'utiliser conformément au droit international. Ce principe est souvent mis en avant par les États qui souhaitent utiliser l'Espace comme source d'informations stratégiques sur les activités d'États tiers. Ainsi, le survol du territoire d'un État par un satellite de reconnaissance est, en principe, libre.
En outre, un État ne peut se voir refuser une coopération lui permettant de participer à l'exploration et l'utilisation de l'Espace avec une nation y ayant accès pour des motifs discriminatoires. La seule discrimination admise est celle, positive, en faveur des pays en voie de développement afin de leur assurer le bénéfice des activités spatiales.
L'exercice de ce principe va souvent de paire avec la question de la définition et/ou de la délimitation de l'espace extra-atmosphérique par rapport à l'espace aérien qui est, lui, susceptible d'être soumis à une juridiction nationale. L'absence de délimitation en droit international est revendiquée par les partisans de la conception fonctionnelle du droit des activités spatiales. Selon cette conception, peu importe le milieu dans lequel l'objet spatial évolue, ce sont ses caractéristiques techniques et sa finalité qui entrent en ligne de compte pour déterminer si l'on a affaire à des activités spatiales ou non.
La notion d'« espace extra-atmosphérique » est fallacieuse et résulte d'une mauvaise traduction française. La limite de l'atmosphère n'intervient pas dans la définition des activités spatiales, même si l'absence d'air implique que l'objet qui évolue hors de l'atmosphère ne puisse être considéré comme un aéronef, selon la définition internationale de ce dernier.
Le principe de non appropriation
Malgré son intitulé, le principe de non-appropriation ne porte pas directement sur la négation de tout droit de propriété sur tout ou partie de l'espace extra-atmosphérique, y compris les corps célestes (les planètes et astéroïdes du système solaire de la Terre). En réalité, ce principe prohibe toute extension de souveraineté nationale sur tout ou partie de l'espace extra-atmosphérique. De cette absence de souveraineté nationale découle l'absence de toute juridiction susceptible de fonder un droit subjectif. Ainsi, la personne qui revendiquerait l'un ou l'autre droit subjectif (propriété, usage, etc.) sur tout ou partie de l'Espace ne pourrait fonder cette revendication sur aucune loi applicable.
Cette nuance est importante car la possibilité d'une reconnaissance de droits subjectifs individuels sur la base du droit international n'est, quant à elle, pas exclue par le Droit de l'Espace. Ainsi, un système similaire à celui mis en place par la Partie XI de la Convention de Montego Bay sur le Droit de la Mer pourrait, le cas échéant, permettre d'octroyer des droits à des entreprises afin de leur permettre d'exploiter certaines zones riches en ressources minérales sur la Lune ou sur d'autres corps célestes. C'est d'ailleurs sur ce postulat qu'est bâti l'article 11 de l'Accord sur la Lune de 1979 qualifiant ces ressources de Patrimoine commun de l'humanité.
Par contre, ce principe empêche l'utilisation de la notion de terra nullius, toute reconnaissance de droits de propriété, par quelque État que ce soit, sur des parcelles lunaires, sur une portion de l'orbite géostationnaire ou sur toute autre partie d'un corps céleste.
L'absence de toute souveraineté nationale sur tout ou partie de l'Espace ne signifie pas que les objets qui y sont lancés ne sont pas susceptibles d'être soumis à la juridiction d'un État.
Le principe de la conformité au droit international
Si ce principe semble évident, il détermine de manière objective les contours de certaines notions et de certains autres principes, tel que celui de l'utilisation à des fins pacifiques.
La conformité au droit international est également un élément fondamental de l'exercice de la liberté d'utilisation de l'Espace. Elle implique notamment le respect du principe de non agression et de règlement pacifique des différends.
Le principe de l'utilisation à des fins pacifiques
Dès la fin des années 1950, Soviétiques et Américains se sont distanciés sur cette notion. En réalité, aucune disposition n'impose à un État d'utiliser l'Espace en général à des fins pacifiques. Ce principe se déduit de plusieurs dispositions du Traité de l'Espace de 1967, dont l'article III qui cite le maintien de la paix et de la sécurité internationale comme objectif poursuivi par la conformité des activités spatiales au droit international, et l'article XI du même Traité qui vise à favoriser, par l'échange d'informations, la coopération internationale en matière d'exploration et d'utilisation pacifiques de l'espace extra-atmosphérique.
En ce qui concerne les corps célestes (Lune, planètes), il est explicitement disposé que leur utilisation ne peut se faire qu'à titre exclusivement pacifique. Y est d'ailleurs prohibée toute activité militaires. L'implication de personnel militaire (par exemple à des fins scientifiques) n'est, elle, pas interdite.
Un autre élément fondamental de ce principe est la prohibition des tests, de l'installation et de l'utilisation d'armes de destruction massive (ADM) dans l'espace extra-atmosphérique. L'emploi d'autres armes est donc implicitement autorisé, sous réserve de conformité au droit international et de certaines zones protégées tels les corps célestes sur lesquels toute arme est prohibée. L'utilisation à des fins scientifiques ou technologiques de sources d'énergie nucléaire n'est pas interdite mais réglementée par la Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies 47/68 (cf. plus haut).
En dehors de ces derniers cas, force est de constater que les activités militaires dans l'espace extra-atmosphérique sont une réalité depuis le début de l'Ere spatiale. Les récents développements et la crainte d'une "arsenalisation" de l'Espace et d'une nouvelle course à l'armement poussent certaines nations (Russie, Chine) à chercher à limiter l'utilisation militaire. En attendant, il semble que, abstraction faite de la prohibition des activités militaires sur les corps célestes et des ADM dans l'Espace, le principe de l'utilisation à des fins pacifiques se confonde par interprétation avec celui de la conformité au droit international.
Le principe d'assistance mutuelle
Ce principe commande aux nations actives dans l'espace extra-atmosphérique de porter assistance aux représentants ou aux ressortissants d'autres nations en cas de danger. Cette assistance ne se limite pas au secours dans l'Espace mais également à la surface terrestre. Ainsi, un statut spécial d'envoyé de l'humanité est conféré aux spationautes. Ce statut leur octroie une protection quelque peu similaire à celle des diplomates, garantissant leur sauvegarde et leur retour dans leur pays.
Le principe de la responsabilité internationale
Ce principe présente une double facette.
Il s'agit d'abord de responsabiliser chaque État aux risques que présentent les activités spatiales. Il s'agit ensuite de ménager des recours effectifs et utiles à la victime du dommage. Un système reposant sur deux mécanismes de responsabilité distincts a dès lors été mis sur pied.
Autorisation et surveillance continue
La première forme de responsabilité internationale est prévue par l'article VI du Traité de l'Espace. Cette disposition prévoit que les États (parties) sont responsable du point de vue international de leurs activités spatiales nationales, que celles-ci soient menées par leur Gouvernement ou par leurs ressortissants particuliers. L'article VI impose aux États parties une obligation d'autorisation et de surveillance continue de ces activités.
Le libellé de l'article VI du Traité de l'Espace de 1967 a donné lieu à beaucoup de discussions et est sujet à controverse. S'il n'est pas contestable qu'un État puisse être tenu responsable, sur cette base, d'activités spatiales menées par un opérateur privé national, il n'est en revanche pas démontré que le législateur international ait voulu créer une responsabilité absolue à charge de l'État (le caractère absolu découlant d'une part, de l'absence de fait illicite et, d'autre part, de l'absence de toute possibilité d'exonération sans limite du montant de la réparation). Une telle responsabilité absolue résulte de l'interprétation de l'article VI selon laquelle un État est responsable du simple fait que l'activité spatiale nationale ait causé un dommage (on parlera ici d'interprétation "absolutiste"). Il n'est donc pas possible pour un État de s'exonérer de cette responsabilité en mettant en place et en œuvre un régime d'autorisation et de surveillance continue, tel que requis par l'article VI.
À plusieurs égards, une telle interprétation entre en conflit avec la théorie générale de la responsabilité internationale des États. Tout d'abord, parce qu'un État n'est pas responsable, du point de vue international, du fait de ses ressortissants nationaux. Il n'en va autrement que si ce fait découle ou est lui-même constitutif d'une violation, par l'État, de ses obligations internationales. Ensuite, contrairement à la responsabilité aquilienne de droit civil, le dommage n'est pas un élément constitutif de la responsabilité internationale. Il n'est pris en compte que dans la perspective d'une réparation. Or, l'interprétation de l'article VI "absolutiste" revient à faire un lien direct entre le fait (les activités spatiales) et le dommage, puisqu'il n'est nullement requis de faire la preuve d'un acte objectivement illicite (violation d'une obligation internationale).
L'interprétation plus classique de l'article VI consiste à y voir un cas particulier de la théorie de la responsabilité internationale. L'article VI du Traité de l'Espace ne ferait que préciser l'obligation imposée à l'État, en l'occurrence la mise en place et en œuvre d'un régime d'autorisation et de surveillance continue. Ce n'est que si l'État restait à défaut de mettre en œuvre de manière effective un tel régime que sa responsabilité internationale pourrait être engagée. Encore une fois, il ne s'agirait là que d'un cas particulier de la responsabilité internationale et non d'une exception, puisque l'État serait tenu de sa propre défaillance et non de celui de ses ressortissants nationaux.
À cette controverse s'ajoute l'incertitude liée à la notion d'activités spatiales nationales et d'État approprié. L'article VI ne définit en effet pas quel(s) est ou sont le(s) critère(s) pertinent(s) pour déterminer la nationalité des activités (contrairement aux biens ou aux personnes qui peuvent être localisées matériellement). Certains États considèrent qu'il s'agit tant des activités menées sous leur juridiction que des activités menées par leurs ressortissants nationaux. D'autres États (Belgique, Pays-Bas) considèrent au contraire que seul le lieu où sont menées les activité constitue un critère pertinent. La question à son importance lorsque l'on s'interroge sur le champ d'application de l'obligation d'autorisation et de surveillance imposée à l'État. Si l'on considère que les activités soumises à autorisation et à surveillance continue peuvent être menées hors de la juridiction de l'État approprié, notamment sur le territoire d'un État tiers, il faut accepter que la mise en œuvre effective de l'autorisation et de la surveillance continue soit soumise à l'autorisation de l'État du lieu où les activités sont menées. Cette interprétation revient donc à rendre l'État responsable d'activités qui sont menées hors de sa juridiction.
Dommage causé par des objets spatiaux
La seconde forme de responsabilité internationale liée aux activités spatiales est la responsabilité pour dommage prévue par l'article VII du Traité de l'Espace.
En anglais, la distinction est facilitée par l'emploi de termes distincts selon que l'on parle de la responsabilité internationale visée à l'article VI du Traité de l'Espace ("responsibility") ou de la responsabilité pour dommage visée à l'article VII ("liability"). Bien que l'on parle de responsabilité pour dommage, il s'agit bien d'une responsabilité internationale du fait qu'elle ne se conçoit et ne s'exerce qu'entre États.
Cette responsabilité découle de la qualité d'État de lancement qui est définie comme l'État qui procède au lancement, qui fait procéder au lancement, qui prête son territoire ou qui prête ses installations aux fins du lancement. En outre, cette responsabilité requiert un dommage causé par l'objet spatial directement. Dans le cas d'un dommage causé dans l'espace extra-atmosphérique, un troisième élément est requis: la démonstration d'une faute dans le chef de l'État de lancement ou qui lui soit imputable. Lorsque le dommage est causé sur terre ou à un aéronef en vol, la responsabilité est objective et n'est pas limitée quant à son montant. Les quatre critères pouvant coexister pour le même objet spatial dans le chef d'État distincts, plusieurs États peuvent être solidairement responsables du dommage. Il s'agit là d'une application de la théorie dite du risque créé.
Ces deux formes de responsabilités sont donc bien distinctes: la première porte sur des activités spatiales, la seconde porte sur des objets spatiaux. La première vise à assurer l'encadrement gouvernemental des activités spatiales, la seconde vise à assurer la réparation du dommage. Dans la première forme de responsabilité, on ne conçoit qu'un seul État responsable. Dans la seconde, plusieurs États peuvent être tenus solidairement.
À ce jour, il n'existe pas de cas judiciaire de mise en œuvre de responsabilité internationale liée aux activités spatiales. Le cas de la retombée, en 1979, sur le territoire nord-canadien, du satellite soviétique COSMOS 954 n'a pas aboutit à un contentieux judiciaire international et a été résolu par voie diplomatique. Toutefois, à l'instar de la responsabilité internationale prévue par l'article VI du Traité de l'Espace, la responsabilité pour dommage est sujette à discussions, en particulier quant à son étendue. L'évolution technologiques et économiques des activités spatiales est à l'origine de ces discussions qui portent sur le contenu exact de la notion d'État de lancement. La Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies 59/115 (cf. plus haut) n'a pas permis d'aboutir à une définition claire de cette notion et des critères qui la sous-tendent.
Cette évolution a abouti à l'apparition de problématiques liées à certains types d'activités mettant en jeu des objets spatiaux.
En premier lieu, dans les années 1980, les activités commerciales, menées par des opérateurs privés, se sont étendues aux activités de lancement jusque-là monopolisées par les Gouvernements. En second lieu, de nouvelles techniques de lancement sont apparues, notamment à l'aide de bases de lancement mobiles opérées depuis la haute mer. Ces deux phénomènes ont nécessité une interprétation de l'article VII du Traité de l'Espace afin de répondre à deux problématiques.
La première problématique est liée au critère pertinent à appliquer pour déterminer le ou les État(s) de lancement lorsque ce lancement est exécuté et commandité par des firmes privées pour leur propre compte. Dans ce cas, une première approche est de considérer la nationalité de l'opérateur et d'en déduire que l'État dont il est ressortissant procède ou fait procéder au lancement. Cette approche permet d'étendre la couverture de la victime potentielle à l'État de la nationalité de l'opérateur. Toutefois, elle a pour conséquence de faire peser sur cet État une insécurité juridique pour les mêmes raisons que celles expliquées plus haut au titre de la critique de l'interprétation "absolutiste" de l'article VI du Traité de l'Espace. La responsabilité pour dommage est susceptible de générer une dette très importante dans le chef de l'État sans qu'il lui soit loisible d'intervenir pour interdire ou conditionner le lancement. Ainsi, une entreprise qui obtient l'autorisation de lancement d'un État Y en ayant son siège social dans le pays X peut engager la responsabilité de l'État X en cas de dommage au sol. Une approche alternative est de considérer que l'interprétation de chacun des quatre critères définissant l'État de lancement doit nécessairement aboutir à identifier au moins un État responsable du dommage. Ceci nous mène à la seconde problématique.
Cette seconde problématique est illustrée par les activités de la compagnie "Sea Launch" qui opère des lancements à partir d'une base mobile montée sur une plateforme marine et ancrée, pour les besoins du lancement, en haute mer à hauteur de l'équateur. Certains spécialistes ont fait remarquer que, dans le cas d'un lancement commandité exclusivement par un particulier de droit privé, cette situation pouvait aboutir à l'absence de tout État responsable en cas de dommage causé par l'objet spatial. On peut en effet considérer qu'aucun État ne procède ou ne fait procéder (= ne commandite) le lancement et que celui-ci est opéré hors de tout territoire ou juridiction national(e) par des compagnies commerciales et pour le compte de sociétés de droit privés. Il semble en effet que ce cas de figure nécessite une interprétation de l'article VII du Traité de l'Espace. Cette interprétation peut être basée sur la notion d'État qui engloberait alors ses nationaux. La nationalité de l'opérateur et du commanditaire du lancement engagerait la responsabilité des États correspondants. Une autre solution serait de considérer qu'en l'absence de tout territoire national, les installations (plateformes, navires) utilisées constitueraient, du fait de leur immatriculation par un État, l'assiette d'une extension de sa juridiction territoriale (on parle alors de quasi-territorialité). Cet État serait tenu responsable en sa qualité d'État de lancement. Cette seconde interprétation a le mérite de laisser à l'État la possibilité de contrôler et de réguler les activités dont les conséquences lui seraient imputées.
Le principe de juridiction sur les objets spatiaux
Ce principe est lié à celui de la responsabilité. Afin que les objets spatiaux (habités ou non) restent soumis à une juridiction nationale et au contrôle d'un État, il est prévu qu'ils soient immatriculés par cet État. L'immatriculation a un effet constitutif de juridiction sur l'objet spatial et à son bord. L'État d'immatriculation doit en outre exercer son contrôle sur l'objet spatial.
L'obligation d'immatriculation à proprement parler découle de la Convention sur l'immatriculation de 1975, même si une telle immatriculation était déjà prévue par la Déclaration sur les Principes régissant les activités des États dans l'espace extra-atmosphérique (Résolution AGNU 1962 (XVIII), adoptée le 13 décembre 1963) et par l'article VIII du Traité de l'Espace.
L'immatriculation est réservée à l'État de lancement de l'objet spatial ou à l'un d'entre eux lorsqu'il y a plusieurs États de lancement (cf. plus haut). Cette règle n'est pas sans poser problème actuellement étant donné la pratique du transfert d'activités en orbite. Certaines activités d'opération spatiale (commerciales ou institutionnelles) peuvent en effet être transférées d'un opérateur à un autre pendant la durée d'exploitation d'un satellite. Lorsque le nouvel opérateur est établi ou a établi ses activités dans un pays (Pays B) qui n'est pas celui de l'opérateur initial (Pays A) et qui n'est pas "État de lancement" de ce satellite, il se peut que ce transfert emporte la responsabilité internationale prévue par l'article VI du Traité de l'Espace. Le Pays B peut se voir contraint d'autoriser et de superviser les activités du nouvel opérateur. Toutefois, n'étant pas État de lancement, il ne peut immatriculer le satellite, ni donc y exercer sa juridiction et son contrôle. De l'autre côté, le Pays A, en tant qu'État de lancement, demeurera responsable pour le dommage causé par ce satellite sans pouvoir exercer de supervision sur l'opérateur établi dans le Pays B.
Des "transferts d'immatriculation" ont été considérés dans certains cas, dont celui de la reprise de l'exploitation de satellites en orbite par la société néerlandaise New Skies Satellites. Ces satellites étaient repris dans la base de données informelles des Nations Unies comme des objets dont le lancement avait été commandité par les Pays-Bas. À la différence du Registre international des objets spatiaux, cette banque de données informelles tenue par le Bureau des Affaires spatiales de l'ONU rassemble des informations non officiellement communiquées par les États sur les objets spatiaux n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation en bonne et due forme. Une Note verbale des Pays-Bas, datée du 29 juillet 2003, a rectifié cette information en déclarant que les objets spatiaux dont question avaient été livrés à New Skies Satellites en orbite par une compagnie qui ne relevait pas de la juridiction des Pays-Bas. Dès lors, les Pays-Bas n'étaient pas à même d'immatriculer l'objet, ni de communiquer au Secrétaire Général des Nations Unies les données pertinentes pour cette immatriculation. Toutefois, sur base de l'article XI du Traité de l'Espace qui prévoit l'échange de données générales relatives aux activités spatiales respectives des États parties, les Pays-Bas ont pu transmettre un certain nombre de données afférentes auxdits satellites. Par la même Note verbale, les Pays-Bas reconnaissaient leur responsabilité internationale en vertu de l'article VI du Traité de l'Espace pour les activités de New Skies Satellites portant sur ces satellites. Dans le même temps, ils déniaient toute responsabilité au titre de l'article VI pour le dommage qui serait causé par les satellites, contestant leur qualité d'État de lancement. Les Pays-Bas prétendaient également à exercer leur juridiction et leur contrôle sur lesdits satellites. Cette dernière assertion est assez étonnante puisque la juridiction et le contrôle sur l'objet spatial sont réservés à l'État d'immatriculation et que cette qualité dépend directement et nécessairement de celle d'État de lancement précisément contestée dans leur chef par les Pays-Bas.
Ce cas d'espèce illustre le décalage existant entre d'une part l'État chargé d'autoriser et de superviser les activités et, d'autre part, l'État exerçant sa juridiction et son contrôle sur l'objet spatial et portant la responsabilité du dommage que cet objet pourrait causer. Cette situation est l'une des conséquences du phénomène de privatisation des activités spatiales qui rend ces activités de plus en plus complexes, notamment du fait d'élément d'extranéité et d'internationalisation.
Une autre question technique se pose quant à l'immatriculation d'objets spatiaux par des organisations internationales intergouvernementales (cf. plus bas).
Quoi qu'il en soit, le principe de l'immatriculation des objets spatiaux poursuit deux objectifs essentiels pour la sécurité et la viabilité des activités spatiales :
- permettre l'identification de l'État de lancement ou de l'un des États de lancement, notamment afin de ménager à la victime du dommage causé par cet objet un recours effectif en réparation ;
- assurer que les activités menées à bord de l'objet spatial (soit par des êtres humains, soit par télécommande) soient soumises à la juridiction et au contrôle d'un État. Ainsi, la création de propriété intellectuelle ou d'informations classifiées à bord d'un objet spatial peut se faire dans un cadre juridique déterminé. Il en va de même pour les crimes et délits qui pourraient être commis à bord d'un objet spatial.
Le principe de non-interférence, de non-dégradation et de non-contamination
Il s'agit d'éviter que les activités des États ne causent des effets préjudiciables ou des modifications nocives de l'environnement spatial ou de l'environnement terrestre. La mise en œuvre de ce principe repose notamment sur des consultations internationales préalables à toute activité potentiellement préjudiciables. Cette disposition peut notamment justifier l'action préventive contre des États dont les activités sont susceptibles de générer des débris spatiaux. Toutefois, une telle action demeure fort théorique: l'exemple du tir de destruction d'un satellite déclassé par l'armée chinoise en janvier 2007 montre qu'alors que de telles consultations auraient pu être utiles, elles n'ont pas été envisagées dans le cadre du Traité de l'Espace et ce, pour des raisons stratégiques liées à des intérêts de défense. Il en a été de même du tir de destruction par l'armée américaine d'un satellite espion à la dérive en février 2008. Cependant, à la différence du tir chinois, la destruction du satellite américain a limité le nombre de débris créés ainsi en orbite.
Un autre cas d'application de ce principe est l'importation de matériel biologique sur d'autres planètes qui peut interférer avec la recherche de formes de vie. Cette hypothèse a été soulevée dans le cadre de l'exploration de la planète Mars.
Le principe de transparence et de libre accès aux installations et équipements
Un rôle particulier est réservé au Secrétaire Général des Nations Unies pour collecter l'information transmise par les États au sujet de leurs activités spatiales et pour rendre cette information accessible aux autres États et à la Communauté scientifique.
En outre, sur le modèle de ce que prévoit le Traité sur l'Antarctique de 1959, un système de contrôle mutuel des États par voie de visites de leurs installations et équipements respectifs est applicable aux activités menées sur les corps célestes.