Faibles doses d'irradiation - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Radioprotection contre les faibles doses
Limites d'exposition admises
Pour permettre une gestion simple du risque et dans une logique de prudence, les commissions internationales ont retenu pour établir les normes la relation linéaire sans seuil fondée sur une relation de proportionnalité entre le risque et les doses reçues. Depuis sa création en 1928, la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) produit régulièrement des recommandations sur la protection contre les rayonnements ionisants ; ces recommandations sont habituellement reprises par les organisations internationales et par les États.
Historiquement, le système de prévention des risques radiologiques a d'abord été fondé sur la notion de seuil : une exposition était jugée admissible si elle restait largement en dessous de la dose où des conséquences sanitaires apparaissent. La première limite de dose, qui date de 1938, concernait les seuls professionnels et équivalait à 500 à 700 millisieverts (mSv) par an. Ces fortes doses ne peuvent résulter que de situations accidentelle, et peuvent constituer la limite au-delà de laquelle un accident du travail doit être reconnu ; la CIPR justifiant ses limites par comparaison avec d’autres risques professionnels.
Après la seconde guerre mondiale, l’action cancérogène des rayonnements a été reconnue et il est devenu évident que des expositions inférieures aux limites peuvent avoir des conséquences graves. La CIPR recommande alors un abaissement des limites de dose : 3 mSv par semaine pour les travailleurs (soit environ 150 mSv par an) et le dixième de cette valeur pour la population (en raison de possibles risques génétiques et de la sensibilité de certains individus qui les rend particulièrement vulnérables aux rayonnements). La Publication 1 de la CIPR, de 1959, remplace la limite professionnelle hebdomadaire par une limite annuelle qui tient compte de l’accumulation des doses ; cette limite correspond à une moyenne de 50 mSv par an mais autorise des dépassements exceptionnels, bornés à 30 mSv par trimestre, soit un maximum de 120 mSv par an. En 1963, la CIPR s’intéresse de très près aux cancers radio-induits et aux effets héréditaires, risques potentiels des faibles doses ; et la limite annuelle est fixée à 50 mSv pour les travailleurs et à 5 mSv pour les personnes du public, dans la mesure (à partir de 1977) où la moyenne sur la vie ne dépasse pas 1 mSv par an.
La Publication 60 de la CIPR, publiée en 1991, fait la synthèse des travaux sur les risques de cancers radio-induits, et pose que le maximum tolérable sur la vie entière est 1 sievert pour les travailleurs et 70 mSv pour les personnes du public. Les limites de dose annuelles en sont déduites : abaissées à 20 mSv pour les premiers (avec dépassement autorisé jusqu’à 50 mSv une année, dans la mesure ou la moyenne sur 5 ans ne dépasse pas 20 mSv par an) et maintenues à 1 mSv pour les seconds..
Le principe ALARA
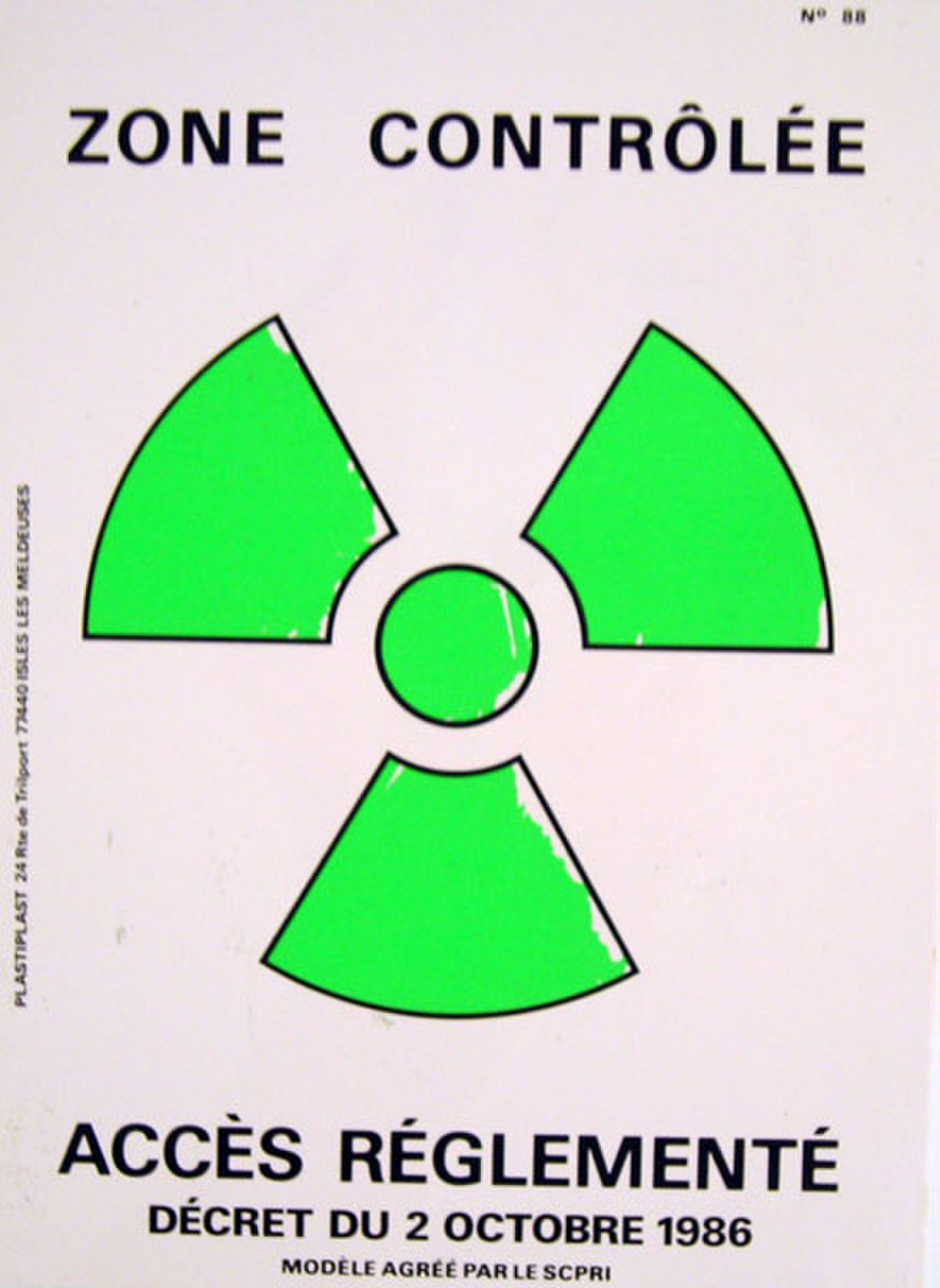
Le système de radioprotection est un système de gestion du risque radiologique aujourd'hui plutôt fondé sur le principe de précaution : le niveau de dose auquel on expose quelqu'un doit être « ALARA » dans la terminologie de la CIPR : As Low As Reasonably Achievable, aussi bas que ce que l'on peut raisonnablement atteindre, et justifié par une raison suffisante.
Cette hypothèse est moins la traduction d'une connaissance scientifique, qu'une attitude intellectuelle destinée à fonder l'action en matière de radioprotection. Le principe ALARA est avant tout destiné à susciter une approche globale de la radioprotection, une radioprotection de gestion a priori des doses individuelles et collectives fondée sur la fixation d'objectifs optimisés, complémentaire à la surveillance des seuils de radioprotection.
Cette gestion vise un équilibre « raisonnable » entre protection et économie, le R du principe ALARA. L'obligation de comportement à caractère incitatif, qui sous-tend ce principe d'optimisation, motive les exploitants à atteindre au mieux les objectifs dosimétriques qu'ils se sont fixés en matière de gestion des niveaux d'exposition résiduels, tout en agissant au mieux des intérêts de la collectivité et de leurs intérêts propres dans le milieu concurrentiel où ils se trouvent placés. L'optimisation implique que, par une analyse détaillée d'opérations envisagées et partant d'une expérience dans des situations similaires, on recherche les voies d'amélioration possibles et l'on décide, le cas échéant, la mise en œuvre de moyens supplémentaires à un coût jugé acceptable.
Ce principe ALARA a guidé à l'adoption ultérieure de l'hypothèse d'une relation linéaire et sans seuil considérée comme prudente au niveau des faibles doses. L'instrument naturel d'une telle optimisation consiste à surveiller et réduire au mieux la dose collective, c'est-à-dire la somme des expositions reçues sur l'ensemble des « zones surveillées ». Dans ce cadre, le choix d'une approche « linéaire sans seuil » s'impose naturellement (et indépendamment de tout fondement scientifique), parce qu'elle permet d'additionner directement des expositions qui peuvent être d'intensités très variables. Ainsi, l'ensemble du personnel est conscient et solidaire de l'objectif collectif, chacun en proportion de la dose individuelle reçue.
La limite est considérée comme la frontière de la région des doses inacceptables ; les valeurs proches de la limite doivent être très strictement réglementées, et les doses proches de la limite ne sont considérées comme tolérables que dans la mesure où les niveaux d'exposition résiduels sont optimisés. Le but de cette approche est de créer une culture de radioprotection, qui en fasse une préoccupation constante de tous les acteurs impliqués, et ne soit pas limitée aux seules zones réputées « dangereuses » parce que proche de la limite, mais s'étende à l'ensemble des « zones surveillées ».
Cependant, alors que l'effort doctrinal de la CIPR porte sur le principe d'optimisation, c'est paradoxalement la fixation des limites qui demeure la principale préoccupation de ceux qui ont la charge de transcrire en normes juridiques le système de gestion du risque radiologique recommandé par la CIPR.
Position officielle de la CIPR sur l'approche linéaire
L'approche « linéaire sans seuil » est formulée par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) de la manière suivante :
- (§29) « At low doses, of the order of those caused by natural background radiation, the increase in the incidence of stochastic effects is assumed by the Commission to occur with a small probability and in proportion to the increase in radiation dose over the background dose. Use of this so-called linear, non-threshold hypothesis or LNT, is considered by the Commission to be the best approach to managing risk from radiation exposure. » (Aux faibles dose, de l'ordre de celles provoquées par l'irradiation naturelle, la commission retient comme hypothèse que l'augmentation des effets stochastiques ne correspond qu'à une faible probabilité, en proportion de l'augmentation de l'irradiation par rapport à cette exposition naturelle. La commission considère que retenir cette hypothèse appelée « linéaire sans seuil » (LSS en français, LNT en anglais) est la meilleure approche pour gérer les risques associés à l'exposition aux radiations.)

Cette approche a été retenue par la commission pour des raisons de simplicité administrative : parce qu'elle permet d’additionner les diverses doses reçues par un travailleur au cours de son activité professionnelle quelles que soient la durée de l’exposition et la nature des rayonnements. Grâce à cette approche, les limites réglementaires peuvent être constatées directement sur un dosimètre, qui additionne toutes les expositions comme le fait une pellicule photographique et fournit directement la limite réglementaire.
Bien que retenant l'approche « linéaire sans seuil » pour proposer les limites d'exposition aux rayonnements, la CIPR précise que cette relation n'est pas applicable aux faibles doses en tant que telles :
- (§57) « the Commission judges that it is not appropriate, for the formal purposes of public health, to calculate the hypothetical number of cases of cancer that might be associated with very small radiation doses received by large numbers of people over very long periods of time. » (La commission estime qu'il n'est pas correct, pour les évaluations de santé publique, de calculer le nombre hypothétique de cancers qui peuvent être provoqués par une très faible dose de radiation à laquelle est exposée une très grande population pendant un temps très long)
L'approche « linéaire sans seuil » de la radioprotection ne signifie pas que les mécanismes d'induction de cancer sont intrinsèquement linéaires. Cette approche reste valide même si ces mécanismes sont non linéaires, et qu'elle correspond à une « atténuation » de ces non-linéarités. Des lois à seuil, hyper-linéaires, sub-linéaires peuvent par ailleurs être préférées pour des études scientifiques en radiobiologie, sans que ce soit contradictoire avec une approche simplifiée recommandée pour la réglementation de la radioprotection.


















































