Fondation européenne pour les métiers de l'image et du son - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Statuts
Statut administratifs
Bien que cet établissement remplisse des missions de service public à caractère administratif (la formation initiale et continue), il a été constitué en établissement public à caractère industriel et commercial par le décret no 98-371 du 13 mai 1998. La Fémis devient alors École nationale supérieure des métiers de l'image et du son. Son statut a été modifié par la loi du 26 juillet 2005 et par le décret du 3 novembre 2006.
L'école est financée à 75 % par le ministère de la culture, à 14 % par la taxe d'apprentissage et à 15 % par des ressources propres. En 1997, le budget global de fonctionnement de la Fémis s'est élevé à 44,9 millions de francs, dont 31,5 millions de francs de subventions de fonctionnement du CNC. Transformée en EPIC, elle a bénéficié en 1998 d'une subvention de fonctionnement du ministère de la culture de 31,50 millions de francs. Cette subvention a été inscrite au titre III du budget du ministère de la culture et non plus parmi les crédits du titre IV affectés au CNC. Les dépenses de l'école et ses recettes sont contrôlées en permanence par un contrôleur financier dépendant du ministère du Budget. La fémis est soumise pour ses achats à l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 et à son décret d'application no 2005-1742 du 30 décembre 2005.
Le président de l'école est nommé par décret en conseil des ministres. Il exerce sa fonction à titre bénévole. Le directeur de l'école est nommé par arrêté du Ministre de la Culture.
Rachid Bouchareb (cinéaste), Roxane Arnold (distributrice-exploitante), Claire Denis (cinéaste), Pascal Breton (producteur), Radu Mihaileanu (cinéaste) et Caroline Champetier (directrice de la photographie) ont été nommés en 2008 par Christine Albanel membres titulaires du conseil d’administration de l'école. Pascale Ferran (cinéaste), Alain Attal (producteur), Céline Sciamma (cinéaste), Dominique Hennequin (mixeur), Jacques Bidou (producteur) et Emmanuel Giraud (producteur) en sont les membres suppléants.
Labels
La Fémis porte le label Enseignement Supérieur Culture (ESC), créé par le Ministère de la culture et regroupant les grandes écoles françaises d'enseignement supérieur consacrées au domaine artistique.
L'école fait également partie du cercle restreint des écoles de cinéma de renommée mondiale, au même titre que la Tisch School of the Arts de l'Université de New York, USC à Los Angeles, la National Film and Television School de Londres, le Centro Sperimentale di Cinematografia de Rome, la FAMU de Prague ou le VGIK de Moscou.
La Fémis est membre du CILECT (Centre international de liaison des écoles de cinéma et de télévision) et du GEECT (groupement européen des écoles de cinéma et de télévision). La Fémis entretient des liens privilégiés avec les grandes institutions culturelles : la Bifi, les Archives françaises du film, et les cinémathèques en régions. Elle cultive également un partenariat régulier avec les salles d’art et essai, l’agence du Court-Métrage, la CST, le GREC, la SCAM.
Concours
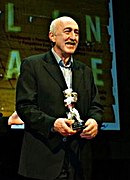
Conditions
Le concours de la Fémis est l'un des concours les plus "lourds" des grandes écoles françaises, tous domaines confondus. Il s'échelonne sur cinq mois environ, de mars à juillet, et nécessite plus de 200 correcteurs et jurés, choisis parmi les professionnels du cinéma en activité.
Les inscriptions sont ouvertes aux titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années d'études après le baccalauréat (trois pour le concours distribution/exploitation), âgés de moins de 27 ans au 1er janvier de l'année du concours, ou aux candidats âgés de moins de 30 ans au 1er janvier de l'année du concours et pouvant justifier d'une activité professionnelle d'au moins quatre années. Dans les faits, les étudiants reçus ont souvent déjà atteint le niveau bac+3. Les candidats français et européens passent les épreuves du concours national, et les candidats étrangers ne dépendant pas de l'Union européenne passent les épreuves du concours international, organisées dans les ambassades de France à l'étranger). Chaque candidat doit mentionner dès l'inscription le département qu'il souhaite intégrer.
Tous les candidats doivent être francophones et ne peuvent se présenter plus de trois fois au concours.
Taux de réussite
Le concours national est réputé très sélectif. Un millier de candidats s'inscrivent chaque année au concours général. Les candidats au concours se répartissent environ de la manière suivante : 50 % en réalisation, 15 % en montage, 13 % en scénario, 10 % en image, 5 % en production et en son et 2 % en décor.
Le pourcentage d'admis par rapport au nombre de candidats est faible : au total seuls 3 % des candidats inscrits au concours sont admis à l'école. Dans le détail, le taux de réussite est en moyenne de 1 % pour le très convoité département réalisation (pour lequel s'inscrivent presque la moitié des candidats), de 3 % pour le département scénario et le département image, de 5 % pour le département montage et le département décor, de 9 % pour le département production et de 12 % pour le département son.
La faible proportion d'élèves reçus à l'école est justifiée, selon son ancien président Claude Miller, par le fait que « le secteur du cinéma et de l'audiovisuel en général ne sont que peu créateurs d'emplois nouveaux ». Le directeur de l'école, Marc Nicolas, évoquait effectivement « une volonté de l'État de ne pas former trop de gens à des professions qui ne concernent que 50 000 personnes en France ».
Détails des épreuves
Premier tour (pré-admissibilité)
Les deux épreuves sont communes à tous les candidats, quel que soit le département demandé.
- Écriture d'un dossier d'enquête sur un thème imposé, parmi trois propositions. Ce document écrit, d'une quinzaine de pages, peut être accompagné d'images (dessins, photographies), de sons (bandes sonores) ou d'un film vidéo. La forme est laissée libre au candidat mais ne doit pas répondre aux règles d'un travail de type universitaire.
- Épreuve sur table d'analyse de séquence. Il est demandé aux candidats d'analyser un court extrait de film projeté au début de l'épreuve (généralement les 10 premières minutes d'un long-métrage de fiction).
Taux de réussite au 1er tour : de 10 % (candidats au département Réalisation) à 30 % (candidats au département Décor).
Deuxième tour (admissibilité)
Les candidats admissibles au deuxième tour passent les épreuves correspondantes au département pour lequel ils se sont inscrits»
- Département Réalisation
- Épreuve de scénario : Écriture d'un synopsis ou d'un projet de scénario, accompagné d'une scène dialoguée, d'après un thème imposé choisi parmi trois propositions.
- Épreuve de tournage et de direction d'acteurs : Tournage d'une scène dialoguée, imposée et tirée au hasard, avec deux acteurs et un caméraman, sur un plateau de cinéma, en présence de deux jurés.
- Épreuve de dérushage : Analyse des images tournées lors de la précédente épreuve, et discussion avec deux autres jurés n'ayant pas assisté au tournage.
- Département Image
- Épreuve écrite : Connaissances techniques (physique, optique, mathématiques, électricité), culture générale, histoire de l'art et du cinéma.
- Épreuve pratique et orale : Réalisation d'une planche-contact photographique sur un thème imposé, discussion autour du travail rendu.
- Département Scénario
- Épreuve écrite : Écriture d'un synopsis et d'une scène dialoguée, sur un thème imposé choisi parmi trois propositions.
- Épreuve orale : Invention d'une histoire de scénario et développement à l'oral, sur un sujet imposé tiré au sort.
- Département Son
- Épreuve écrite : Connaissances techniques (acoustique, physique, mathématiques, électricité), culture générale, histoire de l'art et du cinéma.
- Épreuve pratique et orale : Réalisation d'un document sonore sur un thème imposé, et discussion.
- Épreuve d'acuité et de sensibilité auditive : Analyse technique et artistique de divers documents sonores.
- Département Décor
- Épreuve d'élaboration de décor : Réalisation sur table d'un projet de décor (dessins, plans, maquettes) d'après un scénario imposé.
- Épreuve orale : Discussion ouverte sur les documents fournis lors de la précédente épreuve.
- Département Production
- Épreuve unique et orale : Choix d'un projet parmi cinq propositions de longs-métrages imposées au candidat, préparation d'un argumentaire relatif au choix, soutenance du projet, et propositions de production + même procédé concernant un court-métrage, pour lequel le candidat doit proposer un projet de direction de production.
Taux de réussite du premier au deuxième tour : de 30 % (candidats au département Réalisation) à 70 % (candidats au département Son)».
Troisième tour (admission)
C'est une seule épreuve orale et publique, avec le président et les membres du jury. Le jury est généralement composé de 7 membres (un réalisateur, un producteur, un scénariste, un mixeur ou ingénieur du son, un directeur de la photographie, un monteur et un chef décorateur). L'épreuve consiste en une discussion libre de 30 minutes sur les projets du candidat, ses motivations, son parcours, sa culture, ses expériences. Le troisème tour s'échelonne sur une dizaine de jours.
A l'issue des entretiens, le jury choisit les reçus parmi les candidats du concours général, auxquels s'ajoutent les candidats du concours international. Les candidats reçus ne sont pas classés et n'ont pas connaissance de leurs notes aux épreuves. Ils peuvent les demander à la sortie de l'école, une fois diplômés. Les dossiers et les copies restent la propriété de l'école. Les candidats non reçus peuvent obtenir le détail de leurs notes quelques semaines après la fin des épreuves. L'âge moyen d'un élève admis est de 23 ans. Les promotions comportent généralement un peu plus de garçons que de filles, dans un rapport de 60-40. Les départements réalisation et son sont traditionnellement plutôt masculins, alors que les départements scénario et décor sont plutôt féminins.
Taux de réussite du deuxième au troisième tour : de 33 % (candidats au département Réalisation) à 50 % (candidats au département Production, Son ou Décor).
Historique du concours
| Année | Film proposé à l'épreuve d'analyse de séquence | Thèmes proposés pour le dossier d'enquête | Président du jury | Promotion |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | L'Aurore - Allemagne, Friedrich Wilhelm Murnau | La Porte. L'Argent. La Perspective. | Henri Colpi (réalisateur) | 1 |
| 1987 | Monsieur Klein - France, Joseph Losey | L'Harmonie. Le Commencement. Le Poison. | René Laloux (réalisateur, dessinateur) | 2 |
| 1988 | L'Argent - France, Robert Bresson | Les Cheveux. La Rupture. La Honte. | Maurice Failevic (réalisateur) | 3 |
| 1989 | Voyage au bout de l'enfer - USA, Michael Cimino | La Fête. Les Transports. Lieu(x) de culte. | Anne Luthaud (dramaturge, romancière) | 4 |
| 1990 | Nouvelle Vague - France, Jean-Luc Godard | La Preuve. Le Retard. La Rumeur. | Anne Luthaud (dramaturge, romancière) | 5 |
| 1991 | Gertrud - Danemark, Carl Theodor Dreyer | L'Écho. Le Modèle. Le Deuxième. | Jack Gajos (président de la Fémis) | 6 |
| 1992 | Toni - France, Jean Renoir | L'Empreinte. Le Monstre. La Vibration. | Jack Gajos (président de la Fémis) | 7 |
| 1993 | Les Nuits blanches - Italie, Luchino Visconti | La Peau. Le Vent. L'Intrus. | Jack Gajos (président de la Fémis) | 8 |
| 1994 | Cinq femmes autour d'Utamaro - Japon, Kenji Mizoguchi | La Mosaïque. L'Horizon. Le Doute. | Jean-Jacques Beineix (réalisateur) | 9 |
| 1995 | Identification d'une femme - Italie, Michelangelo Antonioni | Le Déchet. La Transparence. La Colère. | Christine Pascal (réalisatrice) | 10 |
| 1996 | L'Impératrice rouge - Allemagne, Josef von Sternberg | La Ligne. Le Système. Le Sable. | Robert Enrico (réalisateur) | 11 |
| 1997 | Monsieur Verdoux - USA, Charlie Chaplin | Le Secret. Le Cri. La Table. | Philippe Carcassonne (producteur) | 12 |
| 1998 | Val Abraham - Portugal, Manoel De Oliveira | Le Pli. La Racine. La Chute. | Jérôme Deschamps (metteur en scène, dramaturge) | 13 |
| 1999 | Le Grondement de la montagne - Japon, Mikio Naruse | Le Jardin. L'Ombre. La Spirale. | Humbert Balsan (producteur) | 14 |
| 2000 | Blade Runner - USA, Ridley Scott | (Le) Noir. Le Vide. Le Parfum. | Otar Iosseliani (réalisateur) | 15 |
| 2001 | Good Men, Good Women - Taïwan, Hou Hsiao-hsien | La Marche. L'Étoffe. L'Instrument. | Cédric Kahn (réalisateur) | 16 |
| 2002 | La Captive - France, Chantal Akerman | La Boîte. La Feuille. L'Unique. | Olivier Assayas (réalisateur) | 17 |
| 2003 | Femme Fatale - USA, Brian De Palma | Le Milieu. La Machine. Le Reste. | Benoît Jacquot (réalisateur) | 18 |
| 2004 | Viridiana - Espagne, Luis Buñuel | L'Arme. La Vitesse. Le Caché. | Emmanuèle Bernheim (romancière, scénariste) | 19 |
| 2005 | Van Gogh - France, Maurice Pialat | Le Papier. La Gourmandise. La Frontière. | Romain Goupil (réalisateur) | 20 |
| 2006 | Tigre et Dragon - Chine, Ang Lee | Le Blanc. Le Chantier. Le Second. | Pierre Chevalier (producteur) | 21 |
| 2007 | De la vie des marionnettes, RFA/Suède, Ingmar Bergman | Le Voisin. L'Incident. La Main. | Bruno Nuytten (directeur de la photographie, réalisateur) | 22 |
| 2008 | L'Enfant aveugle 2, Pays-Bas, Johan van der Keuken | Le Geste. Miniature. Le Repas. | Abderrahmane Sissako (réalisateur) | 23 |
| 2009 | A History Of Violence, USA, David Cronenberg | La Constance. L'Arbre. Classer. | Raoul Peck (réalisateur) | 24 |
| 2010 | Brève histoire d'amour, Pologne, Krzysztof Kieślowski | L'Attention. Le Lit. Le Fragment. | Jean-Paul Civeyrac (réalisateur) | 25 |



















































