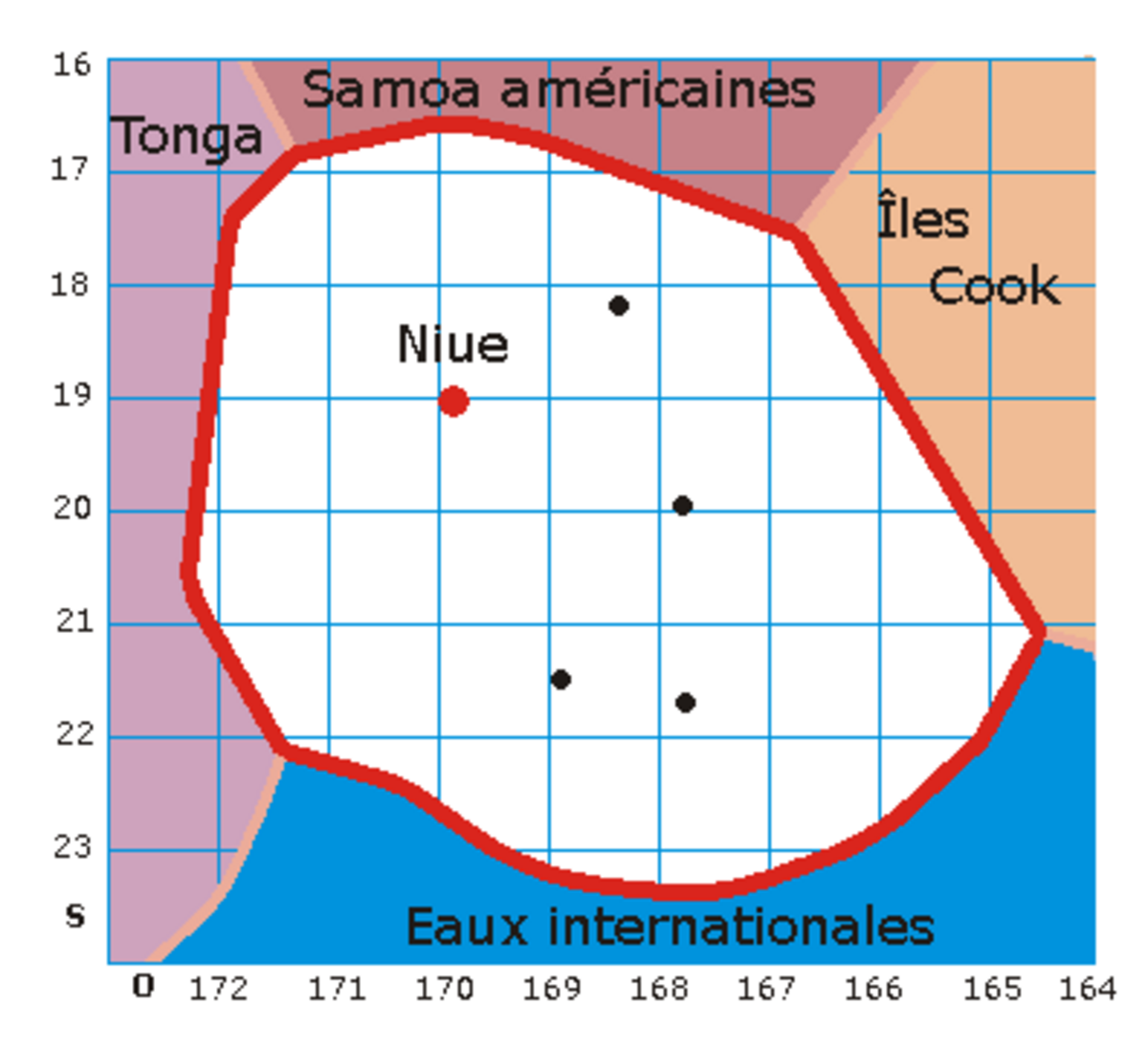Niue - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Économie
L'économie niuéenne est totalement dépendante de l'aide officielle néo-zélandaise, qui avec environ 15 millions de dollars néo-zélandais assure les trois quarts du budget local. La plus grosse partie de ce budget est utilisé pour les infrastructures. La plupart des services publics sont gratuits.
Les importations sont 45 fois plus importantes que les exportations. C'est l'une des balances commerciales les plus déséquilibrées du monde.
Le tourisme, la vente de timbres aux philatélistes et les royalties des compagnies de pêche assurent un apport d'argent. L'attribution des noms de domaine de premier niveau du pays est également une important ressource financière, celui-ci (.nu) ayant une prononciation proche des mots anglais, néerlandais ou suédois signifiant « nouveau » ou « maintenant ».
En 1993, Niue créa un centre financier afin d'accueillir les compagnies off-shore fuyant leurs taxes locales. Depuis, plus de 6 000 sociétés se sont enregistré, assurant 10% des revenus du pays. En 2002, suite à des rumeurs sur le transit de capitaux appartenant à des cartels sud-américains, puis des menaces de sanctions, Niue mit un terme aux activités bancaires (mais pas aux enregistrements de sociétés), ce qui lui permit d'éviter d'être listé sur la liste noire des paradis fiscaux non coopératifs.
En 1996, le gouvernement néo-zélandais dépensa 10 millions de dollars pour agrandir la piste de l'aéroport et construire l'hotel Matavai afin de promouvoir le tourisme, sans grand succès. Sur les 3000 visiteurs annuels, la moitié sont des niuéens expatriés, 7% sont des néo-zélandais.
L'agriculture est marginale (8 % de l'île consiste en des cultures permanentes) et son produit (noix de coco, fruit de la passion, miel, taro, igname, manioc, patate douce, vanille) peu exporté. L'usine de fabrication de noix de coco a fermé en 1989 suite à un cyclone tandis que le cyclone Ofa détruisit en 1990 les cultures de citrons et de fruits de la passion. Une nouvelle usine a ouvert ses portes en 2004.
Biodiversité
Flore
L'île de Niue abrite 629 espèces de plantes vasculaires, dont 175 sont locales. L'île peut être divisée en deux grandes zones de végétation : la forêt tropicale dans l'arrière-pays, et la zone côtière. La plupart de la superficie est peuplée d'arbustes et seuls quelques hectares sont couverts de forêt vierge.
L'occupation humaine a impacté la végétation de Niue de façon significative. La forêt vierge, constituée de grands arbres et d'arbustes, n'est plus présente que dans la partie centrale de l'île, appelée forêt d'Huvalu, où toute activité humaine est strictement interdite. Une grande partie du territoire restant est parsemé d'une forêt secondaire.
Faune
Les mammifères terrestres ne sont représentés à Niue que par les espèces introduites par l'homme : chiens, porcs et chats. La seule exception est le Renard volant des Tongas (Pteropus tonganus), une espèce de chauve-souris, qui joue un rôle important dans l'écosystème de l'île: il pollinise une proportion importante de plantes indigènes. Cependant, la déforestation et le braconnage a conduit à une diminution de sa population.
Niue abrite 31 espèces d'oiseaux dont la plupart ne sont pas endémiques. Les sous-espèces endémiques sont l'Échenilleur de Polynésie (Lalage maculosa whitmeei) et le Stourne de Polynésie (Aplonis tabuensis brunnescens)
Les eaux de Niue abrite une grande quantité d'espèces, notamment le serpent venimeux Laticauda schystorhyncha, ainsi qu'un grand nombre d'anémones de mer et de petits poissons, qui trouvent refuge dans la barrière de corail entourant l'île.
Protection
Le gouvernement de Niue consacre une attention considérable à la protection de l'environnement, et l'île dispose de plusieurs réserves naturelles. La plus grand d'entre elles, la zone de conservation de la forêt d'Huvalu, est située dans la partie orientale de l'île entre les villages de Liku et Hakupu et sa superficie de 54 km2 abrite environ 188 000 animaux.
Au sud de l'île est situé la réserve marine d'Anaunau (anciennement connu sous le nom Namoui) d'une superficie de 27 67 hectares.