Anguille d'Europe - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Effectifs, Dynamique des populations
Jusqu'au milieu du XXe siècle, l'anguille figurait en Europe parmi les espèces plus communes. À titre d'exemple, en 1983, Boisneau estimait que dans le département de l'Ille-et-Vilaine (Bretagne, France), elle était la première ressource piscicole en termes de biomasse (et la troisième en termes de nombre). Elle a pourtant brusquement fortement régressé dans les années 1980-90 au point d'être aujourd'hui menacée et protégée (depuis juin 2007).
Vingt ans plus tard, bien que chaque femelle soit capable de pondre un grand nombre d'œufs, la mortalité des anguilles européennes était « supérieure au seuil de renouvellement des générations », ce qui condamne l'espèce sans actions pour la sauver.
Le Conseil des ministres de l'Union européenne a en septembre 2007 validé un règlement européen instituant un plan de restauration de l'espèce. La Commission européenne a approuvé le plan de gestion de l’anguille en France en Février 2010.
Menaces
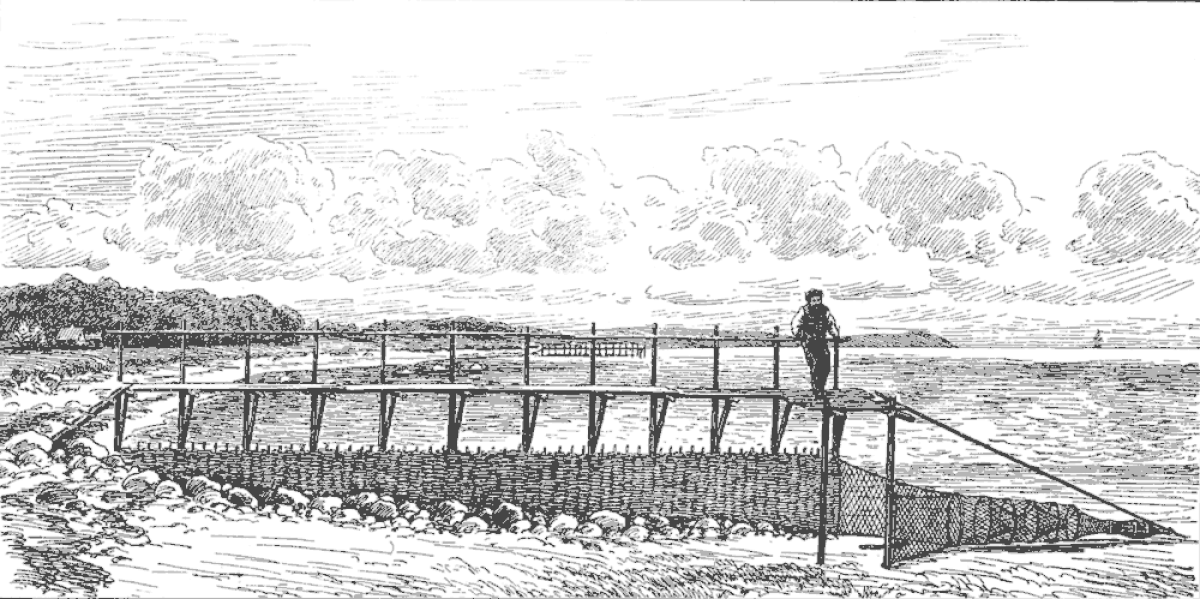

L'explication de sa régression semblent multifactorielle, impliquant divers contaminants toxiques (divers organochlorés et pesticides bioaccumulés par l'anguille), la surpêche des civelles et peut-être des adultes, le braconnage, les obstacles sur la route des alevins et plus récemment une augmentation du taux de parasitisme dont par Anguillicola crassus qui peut perturber la migration marine des adultes semblent aussi avoir une part importante de responsabilité.
Biologie, comportement
Le cycle de vie de l'anguille, son activité, ses déplacements et son comportement alimentaire sont fortement marqué par les rythmes saisonniers et nycthéméraux.
- La température est un stimulus important : la civelle et l'anguille jaune ne s'activent qu'au dessus de 10-13 °C, sous lesquelles elles se cachent dans des gîtes ou dans le sédiment (gravier pour la civelle, vase ou zone profonde pour l'adulte). Mais une température très élevée, de plus de 25 °C par ex s'accompagne d'une léthargie qui peut être expliquée par une chute du taux nocturne d'Oxygène de l'eau);
- La lumière joue un rôle majeur chez la civelle et semble importante chez l'adulte qui n'est généralement actif que la nuit, avec quelques exceptions observées chez les petites anguilles jaunes (de moins de 150 mm) qui sont parfois actives de jour quand elles colonisent un milieu, voire - temporairement - chez certaines anguilles de plus de 250 mm en marais quand il fait chaud et que le taux d'oxyène est le plus élevé (après-midi) (Chez d'autres espèces, on observe que certains parasitisme peuvent rendre les individus parasités moins prudents) ;
- Le cycle lunaire, probablement via la lumière solaire renvoyée par la surface de la lune lors de la pleine lune qu'en raison d'un rythme endogène, semble avoir une importance chez l'adulte (argenté en particulier, qui migrent essentiellement de nuit, et les prototypes de bypass leur permettant d'éviter les turbines montrent qu'elles utilisent plus volontiers (3 à 4 fois plus) les systèmes au fond de l'eau que près de la surface (ici sur une écluse). La lumière a aussi une importance marquée chez la civelle. La turbidité et l'importance de la colonne d'eau sont alors également importantes ; River research and applications , Vol. 21, N° 10 ; p. 1095-1105 ;
- les effets de crue sont également importante. Ils aident notamment les civelles à franchir certains obstacles et à plus rapidement coloniser les territoires inondés.
L'anguille adulte a une respiration particulière ; au 3/4 percutanée et pour 1/4 fournie par les branchies, qui lui permet de ramper hors de l'eau durant quelques minutes voire plusieurs heures (en environnement très humide). L'anguille peut ainsi sortir des cours d'eau pour - en rampant dans l'herbe - gagner des fossés, mares ou étangs isolés.
En cas d'assèchement d'un point d'eau, les anguilles peuvent ainsi gagner d'autres milieux plus accueillant grâce à leur peau et leur mucus particulièrement résistants à la dessiccation tout en étant assez perméable pour permettre des échanges gazeux importants.
L'anguille jaune devient - à ce stade - territoriale et peut fortement se sédentariser. Pour des raisons non comprises, la colonisation d'une zone apparemment homogène de marais peut être (ou être devenue ?) très hétérogène. Elle n'exploite alors qu'une petite zone dont la nature et la surface varient fortement selon les individus, leur taille et la richesse du milieu (il peut s'agir d'eaux douces, mais aussi saumâtre et plus rarement salées, soumise ou non à marnage, avec des gîtes estivaux (plus en profondeur quand l'individu est plus gros). 20 % des anguilles marquées et recapturées sur un cours d'eau de Bretagne nord l'ont été sur le lieu initial de leur marquage durant 8 années de suivi, et en Espagne on a observé une recolonisation très lente par l'anguille jaune de sites dépeuplés Les premières expériences de captures-recapture en fleuve, dans les année 1960 avaient fait estimer qu'une anguille pouvait exploiter 40 km de fleuve. Les moyens plus modernes de télémétrie ont réduit cette hypothèse à quelques milliers de m2 en lac ou en rivière ; Par exemple, le territoire d'une anguille était de 1300 m2 à 2700 m2 dans un petit lac espagnol, et seulement de 100 à 150 m2 chez une anguille suivie durant 2 ans par pit-tag) dans un petit cours d'eau espagnol. En 2001, Baisez estimait qu'en moyenne une anguille jaune adulte occupait dans un marais ouest-atlantique français un territoire moyen d'environ 300 m de berge et 1000 m2 (un peu plus pour les gros individus)
Le comportement migratoire de l'anguille
Le comportement migratoire des larves reste assez mystérieux. Celui des civelles est mieux connu, mais est soumis à de nombreux facteurs qui interagissent de manière complexe.
Parmi ces facteurs, les spécialistes ont listé, outre le débit et le coefficient de marée :
- La Température de l’eau : Comme ont peut s’y attendre puisque cette espèce est un animal à sang froid, la température influe beaucoup sur son métabolisme et par suite sur sa vitesse de migration, sur son temps d’acclimatation à l’eau douce, en estuaire où la température peut parfois descendre près 0 °C, même dans le sud de la France (après la fonte des neiges, par exemple avec 2 °C déjà mesuré dans l’estuaire de l’Adour) au moment de l’arrivée des civelles.
- Si l’eau est à moins de 10 °C, les civelles diminuent leur activité biologique et tendent à se sédentariser dans l’estuaire.
- Si la température chute encore (vers 4 et 6 °C), elles s’immobilisent.
- La migration active commence ou reprend à 10-12 °C.
- Un autre facteur important est le différentiel de température eau douce/eau de mer ; Si ce différentiel dépasse 5 °C (et à partir de 3 °C de différence), pour des raisons mal comprises, la remontée des civelles semblent provisoirement inhibée. Ceci explique que des captures importantes de civelles en migration aient pu être faite dans certains estuaires alors que la température était inférieure à 10 °C. La température de la mer variant proportionnellement beaucoup moins que celle des fleuves en raison de l’inertie thermique de l’océan, c’est la température des cours d’eau, de l’estuaire ou de la baie qui influeront le plus ce différentiel, les courants marins et les vents conservant néanmoins une certaine importance.
- On peut donc penser que la tendance au réchauffement climatique et au réchauffement des cours d’eau par certaines installations de refroidissement industriel (dont de centrales nucléaires) pourrait encourager une remontée plus précoce des civelles. Inversement une fonte plus importante ou précoce de neige ou glaciers peut localement apporter en amont des cours d’eau une eau plus froide qui figerait un certain temps les populations de civelles.
- Le stade de développement : Ce stade est souvent mesuré par le niveau de pigmentation de la civelle. Celle-ci remonte plus activement quand elle est plus pigmentée (Cicotti, 1993) alors qu'elle s'adapte peu à peu à l'eau douce.
- Exposition à la lumière :
- La civelle est très sensible à la luminosité ambiante, laquelle dépend le jour de l'ensoleillement ou de la luminosité du ciel diurne, ne la nuit de l'heure et du cycle lunaire, ainsi que de la couverture nuageuse ou de la présence d'un éclairage artificiel. Un autre facteur est la turbidité et la hauteur d'eau.
- On a montré in vivo et in vitro que les civelles ont en estuaire un comportement lucifuge (elles fuient la lumière, même à des intensités très faibles, à partir de 10-11 W/cm2 (Bardonnet et al, 2005a) pour la civelle non pigmentée, (stade 5B) et 10-10 à 10-8 w/cm2 pour les stades pigmentés (6A0 à 6A3). Les individus se laissent porter par le courant de marée derrière le front de marée dynamique. Et ils se placent verticalement dans la colonne d'eau en fonction de la luminosité ambiante et de la turbidité de l'eau.
- Avant qu’elles ne se pigmentent, et dans la plupart des estuaires étudiés, leur migration anadrome se fait essentiellement de nuit et en surface. Mais on a constaté que dans les eaux turbides où la lumière pénètre mal, (ex estuaire du Couesnon) la migration peut alors se faire de jour et en profondeur (Lafaille et al, 2007).
Les cours d’eau étant de plus en plus turbides en raison d’une intensification des labours et parsuite de l’érosion des sols et de l'eutrophisation ; les dates et vitesses de migration peuvent être perturbées ou modifiées par ce phénomène. L’aggravation de l’importance et de la fréquence des crues pourrait aussi avoir un impact.
Sur les bassins de l’Adour et de la nivelle, plusieurs auteurs ont noté que la luminosité nocturne et de la turbidité influaient sur le comportement vertical de migration de la civelle Bardonnet et al, 2005a) ont étudié le comportement de la civelle en terme de hauteur dans la colonne d’eau.

















































