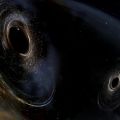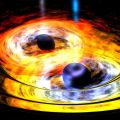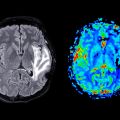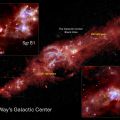Institut géographique national (France) - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
La recherche
L'activité de recherche est organisée au sein d'un Service de la recherche de la Direction technique ; ce service comprend quatre laboratoires :
- le COGIT (Conception d'objet et généralisation de l'information topographique), spécialisé en SIG et cartographie
- le MATIS (Méthodes d'analyse et de traitement d'images pour la stéréorestitution), spécialisé en photogrammétrie et vision par ordinateur
- le LOEMI (Laboratoire d'optique, d'électronique et de micro-informatique) qui développe des instruments (notamment de prise de vues)
- le LAREG (Laboratoire de recherche en géodésie), un laboratoire de géodésie situé dans les murs même de l'ENSG, qui entretient ITRF, le référentiel géodésique mondial.
L'organisation de l'IGN

La direction générale est à la tête de huit directions sectorielles
- Secrétariat Général
- Direction des ressources humaines
- Maîtrise d'Ouvrage déléguée au Service public
- Direction Technique et de la Qualité
- Direction de l'Édition
- Direction de la Production
- Direction Commerciale
- École Nationale des Sciences Géographiques
Les activités internationales et la communication sont dirigées par des directeurs délégués rattachés directement à la Direction Générale.
Services en ligne
A l'IGN aussi, les services en ligne commencent à se substituer massivement aux livraisons matérielles ou aux démarches à effectuer à des guichets ou en boutique. C'est ainsi que les commandes de cartes ou de photos peuvent être effectuées depuis les années 1990 au moyen d'une boutique en ligne. Le service "Carte à la carte" permettant le cadrage personnalisé d'une carte imprimé spécialement et livrée par courrier. Enfin, le Géoportail commence à proposer à tous, professionnels et grand public, des services de visualisation de cartes ou d'exploitation de données géographiques produites par l'IGN ou d'autres contributeurs du Géoportail.
L'Ecole Nationale des Sciences Géographiques
Afin de former ses personnels techniques, l'IGN maintient un établissement d'enseignement de pointe dans le domaine des sciences géographiques : l'ENSG, à Marne-la-Vallée. Sur les quatorze cycles de formation dispensés à l'ENSG, trois sont plus précisément destinés aux techniciens et ingénieurs stagiaires de l'IGN :
- les dessinateurs-cartographes ;
- les techniciens-géomètres ;
- les ingénieurs des travaux.
Recrutés sur concours avant d'intégrer l'ENSG, les élèves de ces cycles y passent deux ou trois ans puis rejoignent l'Institut. Les cycles destinés à la formation des techniciens et ingénieurs stagiaires de l'IGN sont également ouverts à la formation d'ingénieurs civils ainsi qu'à des étudiants étrangers. L'ENSG est aussi associée aux quatre laboratoires de recherche pilotés par l'IGN.
Les activités de production et d'édition
Les réseaux géodésiques et de nivellement
Le service de la géodésie et du nivellement (SGN) assume les missions de production et d'édition des données permettant le positionnement à la surface du globe. Le LAREG (Laboratoire de Recherche en Géodésie) est le cadre permettant à l'IGN de participer aux réseaux internationaux de collaboration scientifique en géodésie. Après avoir longtemps été contrainte par les techniques d'observations optiques à effectuer au sol, la géodésie a pleinement profité de l'arrivée des satellites, de l'informatique et des réseaux de télécommunication. C'est ainsi qu'aujourd'hui, grâce à la collaboration de nombreux partenaires autour du Réseau GNSS permanent (RGP), des engins de travaux publics peuvent être pilotés en temps réel avec une précision d'ordre centimétrique. De la même façon, la position des caméras des avions photographes est également parfaitement connue, ce qui permet de d'alléger les opérations en aval tout en améliorant la qualité des bases de données issues de ces photographies.
Les activités aériennes et la Photothèque nationale

Une des missions de service public de l'IGN est d'assurer le renouvellement de la couverture photographique aérienne de la France. Pour ce faire, les avions de l'IGN photographient le territoire français. Longtemps argentiques, les prises de vues sont aujourd'hui numériques, ce qui améliore les traitements de restitution. L'IGN dispose de quatre avions sur sa base aérienne de Creil ; ils couvrent actuellement la totalité du territoire en cinq ans. Les prises de vues aériennes permettent la réalisation des bases de données numériques et de la carte grâce aux techniques de restitution photogrammétriques.
Parmi les avions notables de l'IGN, on peut citer 8 anciens bombardiers LeO 45, les 14 Boeing B-17 « Forteresses volantes » utilisées de 1946 à la fin des années 1980, les 8 Hurel-Dubois HD-34 utilisés jusqu'en 1985, une Alouette III, des AeroCommander, un Fokker 27 et un Mystère 20. Le parc actuel est constitué de 4 Beechcraft Super King Air 200T.
La Photothèque nationale conserve les clichés du territoire réalisés depuis 1921 d'abord par le Service géographique de l'Armée, puis par l'IGN, sur son site de Saint-Mandé. La Photothèque nationale assure également la conservation des missions aériennes déposée au titre du dépôt légal.
La mise à jour en continu des bases de données
La conception du référentiel à grande échelle (RGE) a inclus la mise en œuvre d'un cycle de mise à jour dès lors que les bases étaient achevées pour chaque département ; pour les orthophotographies (BD ORTHO), le cycle de mise à jour a d'abord été de cinq ans et s'améliore progressivement ; pour les bases de données vectorielles topographiques et d'adresse (BD TOPO, BD ADRESSES ) la mise à jour s'effectue "en continu" selon un cycle d'une année à l'intérieur de chaque département.
Pour cela, l'IGN a déployé en région plus de cent techniciens qui collectent les évolutions à intégrer dans les bases de données, au plus près du terrain. Pour les aider dans cette tâche et pour bénéficier d'informations récentes, l'IGN développe, depuis 2004, une politique de partenariats auprès d'organismes utilisant des bases de données IGN et produisant eux-mêmes des données métier géolocalisées, tant au niveau national (IFN, la Poste, DGFip, RTE...) que départemental (Services départementaux d’Incendie et de Secours, Conseils généraux). En contrepartie, l'IGN fournit à ses partenaires les informations leur permettant d'améliorer leurs propres bases de données, tant en termes d'actualité que d'exhaustivité. Avec la mise en ligne, en février 2009, d'un site dénommé "RIPart" (acronyme de Remontée d'Informations Partagées), l'IGN teste les possibilités offertes par les nouvelles technologies internet et l'API Géoportail afin d'associer les utilisateurs du RGE en général et ses partenaires en particulier à la mise à jour de ses bases.
Bases de données numériques
L'IGN fournit à ses clients publics ou privés des bases de données géographiques, constituant tout ou partie de systèmes d'information géographique. Ils permettent sur un fond de carte ou d'imagerie aérienne de sélectionner, ajouter et représenter des informations thématiques localisées. L'IGN constitue et actualise notamment le Référentiel à grande échelle (RGE), comprenant quatre composantes : topographique, orthophotographique, parcellaire et adresse.
- Le RGE
Le Référentiel à grande échelle est un ensemble de données géolocalisées comprenant une orthophotographie, un assemblage de données cadastrales géolocalisées, des données vectorielles topographiques et les adresses géolocalisées; il couvre l'ensemble des départements français de métropole et d'outre-mer ainsi que Mayotte. Le contenu du RGE est défini par arrêté en date du 19 avril 2005.Le RGE a été constitué de 2000 à 2008; le premier ensemble de données couvrant totalement le territoire a été l'orthophotographie dont la première édition a été achevée en 2003 pour répondre aux besoins de mise en œuvre de la politique agricole commune (PAC).c'est sur cette orthophotographie que le levé des parcelles agricoles a été reporté et a permis le contrôle de l'attribution des primes à la production agricole. Les autres données du RGE répondent de même à des besoins clairement identifié en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de protection de l'environnement, de défense et de sécurité.
- Bases scannées (ou "image" ou "raster")
Pour obtenir rapidement des cartes numériques utilisables dans des SIG, le premier processus utilisé a consisté à scanner les cartes papiers, à isoler la partie utile, à géolocaliser le fichier et enfin à assembler les images obtenues en les redécoupant en dalles selon un découpage régulier ; ce travail a été effectué pour toutes les séries de cartes de l'IGN. Ces cartes sont maintenant utilisables sur le Géoportail et la carte de France routière dite SCAN1000 est téléchargeable gratuitement. http://professionnels.ign.fr/ficheProduitCMS.do?idDoc=5327966 A l'heure du tout numérique, ces images de cartes sont maintenant générées directement à partir des bases de données au moyen d'un processus complexe permettant d'obtenir le rendu cartographique final auquel les utilisateurs sont habitués. Ces images numériques peuvent alors être utilisées sur des supports numériques, éditées sur des sites web ou imprimées sur du papier.
- Bases maillées
Les principales bases de données maillées de l'IGN sont les grilles de calculs géodésiques et la base de données altimétiques. La principale fonction de ces bases est de permettre de calculer des valeurs numériques par interpolation. Leur visualisation par colorisation en fonction des valeurs permet également d'obtenir une représentation de l'espace géographique.
- Bases vectorielles
Les bases vectorielles de l'IGN se différencient par la précision des points enregistrés et par le modèle conceptuel de données qui organise l'information qu'elles contiennent. Chaque base de données vise donc des ensembles d'applications dans certaines plages d'échelles. C'est ainsi que la BD TOPO répond à un ensemble d'applications assez étendu à "grande échelle" (précision métrique, édition possible du 1:8 000 au 1:50 000) alors que GéoFLA ne vise que des représentations de cartographie statistique avec une précision "à la commune". La BD CARTO est un intermédiaire entre ces deux options.
- Bases 3D
L'IGN a produit dès les années 1970 des données permettant de représenter la volumétrie des bâtiments dans les espaces urbains; la base TRAPU (Tracé automatique de perspectives urbaines) permettait d'enregistrer les bâtiments sous forme de polyèdres; la base ainsi enregistrée permettait d'effectuer le tracé des bâtiment en vue perspective en choisissant à volonté le point de vue et l'axe perspectif. Des travaux de recherche ont amené en 2008 à produire de manière semi-automatique un "bâti 3D" qui permet d'associer des textures réelles aux façades et toitures de bâtiment.
- Bases de données européennes
L'IGN diffuse les bases de données européennes élaborées par Eurogeographics à l'aide des données fournies par chacun de ses membres, les instituts ou agences cartographiques nationales d'Europe. Il s'agit d'EGM (EuroGlobalMap, base topographique vectorielle de précision décamétrique, ERM (EuroRegionalMap, base topographique vectorielle de précision hectométrique), EBM (EuroBoundaryMap, base vectorielle des limites administratives) et EuroDEM (modèle numérique du relief du terrain).