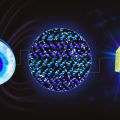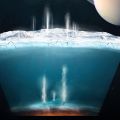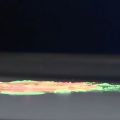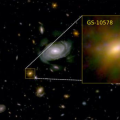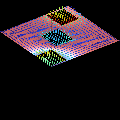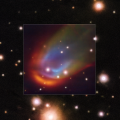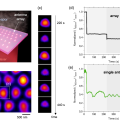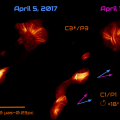Jean-Frédéric Oberlin - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Introduction
| Jean-Frédéric Oberlin | |
| Portrait par J. Gottfried Gerhardt vers 1800 | |
| | |
| Naissance | 31 août 1740 Strasbourg |
|---|---|
| Décès | 1er juin 1826 (à 86 ans) Waldersbach |
| Profession(s) | Pasteur |
| Formation | Docteur en philosophie |
Johann-Friedrich Oberlin, Jean-Frédéric Oberlin en français, né le 31 août 1740 à Strasbourg et mort le 1er juin 1826 à Waldersbach, est un pasteur protestant alsacien, piétiste et apôtre du progrès social.
Biographie
Fils de Jean-Georges Oberlin (1701-1770), professeur au gymnase protestant de Strasbourg, et Marie-Madeleine, née Feltz (1718-1787), Oberlin reçut son éducation à l’Académie de sa ville natale. Porté par ses goûts et par une piété exaltée vers la carrière ecclésiastique, il y étudia la théologie et se fit remarquer parmi ses condisciples non seulement par son intelligence, son application et la pureté de ses mœurs, mais aussi par un enthousiasme religieux qui se rencontre rarement chez un jeune homme de son âge. Ayant obtenu, en 1763, le grade de docteur en philosophie, il entra, en qualité de précepteur, dans la maison du chirurgien Ziegenhagen, où il passa trois années.
En 1766, il se vit offrir la place peu recherchée de pasteur à Waldersbach, un village pauvre de la haute vallée de la Bruche, situé dans le comté du Ban-de-la-Roche, sur le versant ouest du Champ du Feu. Dès le XVIIe siècle, quelques pasteurs, pénétrés de l’importance de leur mission, comme Jean Nicolas Marmet, Jean Georges Pelletier, de Montbéliard, et surtout son prédécesseur, Jean Georges Stuber, avaient contribué à améliorer le bien-être de la population déshéritée de cette région. Stuber avait réussi à établir une école convenable, et grâce à ses soins, grâce aussi à son Alphabet méthodique pour faciliter l’art d’épeler et de lire en français, la plupart de ses paroissiens lisaient à peu près couramment, lorsqu’il quitta ce coin de terre qui partageait, avec le reste de l’Alsace, le privilège de jouir d’une entière liberté de conscience, pour aller desservir celle de Saint-Thomas à Strasbourg.
Beaucoup restait à faire pour éclairer la contrée, mais Oberlin, qui ne recula pas devant cette rude tâche, s’attacha d’abord à gagner le cœur des habitants par sa douceur, ses manières affables et sa charité. Lorsqu’il y fut parvenu, il commença par leur faire sentir la nécessité de rendre praticables les chemins détestables qui reliaient entre eux les cinq villages de la paroisse, et d’ouvrir une communication régulière jusqu’à la grande route pour mettre le comté en rapport avec Barr et Strasbourg. Il vainquit la résistance qu’il rencontra en prenant lui-même la pioche et en se mettant le premier à l’ouvrage. Il leur fit ensuite construire un pont, soutenir par des murailles les terrains près de s’écrouler, bâtir des maisons solides et commodes. Le 6 juillet 1768, il se maria avec la fille d’un professeur à l’université de Strasbourg, Madelaine-Salomé Witter, chez qui il trouva une compagne fidèle et une aide précieuse pour les réformes qu’il projetait.
L’agriculture pouvant être améliorée, Oberlin fit, d’abord en public, divers essais de culture, puis il acheta un grand nombre d’instruments aratoires, qu’il vendit au prix coûtant ou même au-dessous de ce prix aux cultivateurs qu’il pourvut de semences appropriées à la nature du sol. Il renouvela les plants de pomme de terre, créa des engrais et des prairies artificielles, planta des vergers et des pépinières dans des terrains auparavant stériles, et introduisit le lin, le trèfle et diverses espèces d’arbres fruitiers, d’herbages productifs, de légumes et de céréales, auparavant entièrement inconnus dans le pays. Avec le temps, et sous sa judicieuse direction, le cours des ruisseaux fut fixé, les marais asséchés et ce sol aride, fertilisé par ses soins, prit un aspect plus riant. La culture de la pomme de terre et celle du lin firent, en même temps, de tels progrès, que les cultivateurs trouvèrent bientôt dans l’exportation d’une partie des produits de leurs champs des ressources considérables qui servirent à des améliorations nouvelles.
En même temps qu’il instruisait les hommes faits, Oberlin apprenait aux jeunes adultes ce qui pouvait les intéresser comme cultivateurs et comme chrétiens. Lorsqu’il vit que ses paroissiens appréciaient l’utilité de ses leçons, il voulut les associer d’une façon plus directe aux réformes dont il poursuivait l’accomplissement avec persévérance et fonda, à cet effet, une petite société d’agriculture, qu’il affilia à celle de Strasbourg, et qui encouragea l’élevage des bestiaux par la distribution de prix annuels. Pour faciliter la transaction des affaires, il organisa deux caisses. Une caisse d’emprunts prêtait sans intérêts aux agriculteurs de petites sommes remboursables à époque fixe, à la seule condition d’une scrupuleuse exactitude dans le remboursement si l’on ne voulait être privé pendant un certain temps de la faculté de renouveler les emprunts. Une caisse d’amortissement, créée à l’aide de cotisations volontaires, contribua à la liquidation des dettes qui grevaient leurs propriétés.
Comme presque aucun métier, même les plus utiles, n’était exercé dans la paroisse, il en résultait des privations nombreuses ou un surcroît de dépense. Oberlin choisit donc parmi les jeunes garçons ceux dont il devinait l’habileté, les habilla et plaça en apprentissage à Strasbourg un certain nombre de jeunes gens, pour leur faire apprendre les métiers de maçon, charpentier, forgeron, menuisier, vitrier, maréchal et charron. Enfin il fit venir dans la paroisse un médecin et des sages-femmes, vulgarisa la connaissance et l’emploi des plantes médicinales, et ouvrit une pharmacie. Peu à peu, cette aisance accrut considérablement la population qui, ne se composant que de 80 à 100 familles dans les commencements, en comptait 5 à 600, quarante ans plus tard.
Si Oberlin était plein de zèle pour propager le bien-être matériel, il ne perdait pas non plus l’occasion de développer l’instruction chez la jeunesse. Il fit également marcher, de front avec les établissements destinés à pourvoir au bien-être matériel de ses paroissiens, les institutions propres à développer parmi eux l’instruction religieuse et l’éducation intellectuelle. Un de ses premiers soins fut de rebâtir l’école de Walsbach. Loin d’être en cette circonstance secondé par les paysans, il éprouva de leur part une violente opposition, et fut obligé, pour les apaiser, de leur promettre que l’entretien de cette maison, élevée dans l’intérêt général, ne tomberait jamais à leur charge. Comptant sur la Providence, Oberlin exposait beaucoup, en la circonstance, sa fortune qui était pourtant médiocre. Ses ressources pécuniaires n’étant pas suffisantes à exécuter ce qu’il se proposait, il s’en procura de nouvelles en établissant à Waldersbach une pension, où il eut souvent jusqu’à douze élèves ; il employait la majeure partie le produit de ces leçons au profit de la paroisse. Ce ne fut que peu de temps avant sa mort que le traitement d’Oberlin fut porté au-delà de 1 000 francs. La suite des évènements justifia néanmoins sa pieuse témérité lorsque, quelques années plus tard les paysans, mieux inspirés, lui vinrent en aide et construisirent à frais communs une école dans chacun des autres villages. Oberlin s’empressa alors d’établir une émulation entre les cinq maisons. La bibliothèque, que son prédécesseur Stuber avait fondée, fut considérablement augmentée à ses frais, des Bibles répandues en grand nombre avant même la fondation de la Société biblique de Paris. Il fit réimprimer plusieurs ouvrages utiles, publia un almanach dégagé de fables et de préjugés, se procura des cartes géographiques, des livres d’histoire naturelle, une machine électrique et différents instruments de physique.
C’est à lui (ou plutôt à sa jeune servante Sara Banzet ) qu’on doit la première idée de l’école maternelle lorsqu’il réunit les petits enfants dans des chambres spacieuses, convenablement disposées, et les plaça sous l’inspection de surveillantes, qu’il forma lui-même en les faisant passer par une sorte d’apprentissage. Ces surveillantes devaient diriger leurs jeux d’une manière utile, enseigner aux plus grands à filer, à tricoter et à coudre, et varier ces occupations en leur expliquant des cartes de géographie ou des estampes coloriées relatives à quelque sujet tiré de la Bible ou de l’histoire naturelle.
L’influence bienfaisante d’Oberlin se manifesta encore par de nombreux actes. Voyant, un jour de 1779, les paysans accabler un colporteur juif d’injures, il leur reprocha de se montrer eux-mêmes indignes du nom de chrétiens, chargea sur ses épaules le ballot de marchandises de l’étranger, le prit par la main et le conduisit jusqu’à sa demeure. Le dimanche suivant, il prononça en chaire un sermon intitulé « Dieu a-t-il rejeté son peuple ? », où il affirmait « je suis aussi Israélite, de la postérité d’Abraham, de la tribu de Benjamin. » On loue encore son désintéressement, sa tolérance, sa philanthropie qui embrassait tout le genre humain : on raconte qu’il vendit son argenterie pour contribuer à l’œuvre des missions, et qu’ému de compassion par le sort des esclaves Noirs, il renonça à l’usage du sucre et du café, qui lui semblaient arrosés de leur sang.
Afin de fournir du travail à tous les bras, le travail des champs ne suffisant pas à soutenir la majorité des habitants, l’infatigable pasteur chercha dans l’industrie de nouveaux moyens d’existence : il établit une filature de coton, à laquelle il rattacha des salles d’asile sous la direction de sa femme et de quelques personnes charitables, et donna des prix aux meilleures fileuses. En 1814, sa réputation attira au Ban-de-la-Roche un ancien directeur de la République helvétique, Legrand, qui forma une fabrique de passementerie en rubans de soie.
Oberlin accueillit favorablement la Révolution française, participant à l’organisation les fêtes civiques données au Ban-de-La-Roche qu’il préside et organisant des collectes de vêtements pour les conscrits. Lors de la suppression de son traitement par les autorités du département, il prit, pour pouvoir survivre et continuer son œuvre pastorale, une patente professionnelle et devient « artisan en tricotage ». Convoqué à Strasbourg en novembre 1793, il y fait une profession de foi républicaine, dépose le rabat et la robe pastorale et reçoit un certificat de civisme le 18 décembre suivant. Lorsque la Convention ferma de force toutes les églises, Oberlin créa un club jacobin au sein duquel il prêcha, sous le nom d’« orateur de la Société populaire », les « clubistes », qui furent obligés, une fois la salle de l’auberge où ils se réunissaient devenue trop petite, de se transporter vers « le Saint Temple de la Raison et de l’Éternel », qui n’était autre que le temple du village. Quand la Convention ordonna la suspension de l’exercice des cultes, Oberlin se mit à avoir des « réunions » chez les paroissiens chaque décadi, expliquant que l’Éternel devrait agréer tout autant le repos du décadi que celui du sabbat, et donnant des suggestions pour continuer à célébrer la Sainte-Cène. Ce patriote sincère et partisan du gouvernement républicain ne craignit pas de braver les terroristes en sauvant le plus de proscrits qu’il put, sans distinction d’opinions ou de culte.
Les services que rendit Oberlin, pendant plus d’un demi-siècle, à l’agriculture, lui firent décerner, en 1818, une médaille d’or par la Société centrale de Paris. À cette occasion, un des membres, François de Neufchâteau, qui à plusieurs reprises était venu sur les lieux, déclara que lorsqu’on voudrait organiser des colonies agricoles, la création de celle de Walsbach serait un des meilleurs modèles à suivre ; il ajouta que parmi les communes rurales déjà existantes il n’en était aucune, même des plus florissantes, où les perfectionnements de l’économie sociale fussent aussi complets et où l’on ne put méditer avec fruit les Annales du Ban-de la-Roche, commencées en 1770 par le bienfaiteur du pays. Depuis près d’un siècle que son canton plaidait contre les anciens seigneurs au sujet d’un droit de propriété et d’usage dans les forêts qui couvraient la montagne, même la Révolution n’avait pas mis fin à ces contestations ruineuses. Après y avoir préparé de loin ses paroissiens, tant dans la conversation que dans la chaire, il parvint à les amener à un arrangement, qui fut signé chez le préfet du Bas-Rhin, Adrien de Lezay-Marnésia.
Admirateur enthousiaste de Lavater et de Gall, Oberlin, pour exercer son talent comme physionomiste, il avait recueilli un grand nombre de silhouettes, an bas desquelles il écrivait son jugement. Il possédait également une collection de pierres luisantes de toutes couleurs, dont il se servait pour tirer des conjectures sur le caractère des personnes d’après la préférence qu’elles donnaient à l’une ou à l’autre.
À la suite de l’œuvre de piété et des efforts du ministre de l’Évangile, pas une commune en France ne put rivaliser avec le Ban-de-La Roche ni en moralité ni en instruction. Les succès rencontrés par Oberlin au Ban-de-la-Roche répandirent son nom en France et à l’étranger. Plusieurs sociétés philanthropiques l’admirent dans leur sein ; la Société biblique de Londres le choisit pour son principal correspondant. Plusieurs princes lui envoyèrent des témoignages d’estime ou de riches présents. Le 16 fructidor an II, il reçut de la Convention une mention honorable pour sa contribution à « l’universalisation de la langue française ». En 1818, la Société centrale d’agriculture lui décerna une médaille d’or. Le 1er septembre 1819, Louis XVIII le nomma chevalier de la Légion d'honneur. Cependant sa plus douce récompense était l’amour de ses paroissiens, qui le vénéraient à l’égal d’un père.
Sans cesser d’être d’accord avec ses coreligionnaires sur les bases essentielles de la foi, il s’était formé sur le monde supérieur des idées singulières, assez semblables à celles des spiritualistes et des théosophes modernes et dont il affirmait retrouver la source dans l’Évangile, mais les théories plus ou moins étranges dont il aimait à s’occuper n’eurent d’autre influence sur lui que de fournir un aliment puissant aux qualités de son cœur. Ses sermons, quoique fort simples, étaient rédigés avec grand soin ; après la Bible, il tirait volontiers ses sujets d’instruction de la vie de personnes distinguées, mortes ou vivantes ; la nature lui offrait aussi un vaste champ de leçons, dans la mesure où il savait trouver dans toutes ses opérations des images des choses spirituelles.
Oberlin jouit jusqu’à la fin de sa longue, vie d’une robuste santé. Dans les dernières années de sa vie, il se reposa de la plupart des fonctions pastorales sur son gendre. Lorsque sa dernière maladie se déclara tout à coup, elle ne dura que quatre jours et Oberlin mourut à l’âge de quatre-vingt-six ans, après un ministère de cinquante-neuf ans. Son corps fut enterré au village de Fouday, au milieu d’un immense concours de gens de toutes conditions, protestants et catholiques déplorant à l’envi la perte de cet homme. Sa femme, morte en 1784 après seize années de la plus heureuse union, l’avait rendu père de neuf enfants. Deux avaient précédé leur mère dans la tombe. L’ainé, Friedrich, périt sur les bords du Rhin en 1793, servant comme volontaire dans l’armée de la République. Le second, Heinrich, fut victime du dévouement avec lequel, quoique malade, il travailla à arrêter les progrès d’un incendie. Un troisième Heinrich-Gottfried, docteur en médecine, est l’auteur d’un livre intitulé Propositions géologiques pour servir d’introduction à un ouvrage sur les éléments de chorégraphie, avec l’exposé de leur plan et de leur application à la description géognostique, économique et médicale du Ban-de-La Roche, Strasbourg et Paris, 1806, in-8°. Il était le frère du philologue et archéologue Jérémie-Jacques Oberlin.
Aucun des écrits d’Oberlin n’a été publié, mais il a laissé en manuscrit des Sermons, écrits d’un style très simple et très familier, les Annales du Ban de la Roche depuis 1770, une sorte d’Autobiographie, portant la date de 1784, et une réfutation du traité De senectute de Cicéron, terminée en 1815.