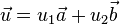Vecteur - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Approche algébrique
Coordonnées et vecteurs colonnes
Dans un plan, deux vecteurs














pour indiquer les composantes du vecteur. Le tableau est appelé vecteur-colonne et correspond à un cas particulier de matrice. Les opérations algébriques sur les vecteurs sont simples, avec une telle représentation. Additionner deux vecteurs revient à additionner chacune des composantes et la multiplication par un scalaire revient à multiplier chaque composante par le scalaire.
Dans un plan vectoriel, un vecteur s'identifie à un couple de scalaires, et dans l'espace à un triplet. Si les nombres choisis sont réels alors un plan (respectivement un espace) s'identifie à R2 (respectivement à R3). Ici, R désigne l'ensemble des nombres réels.
Ébauche d'une construction algébrique
La logique précédente, appliquée pour une dimension égale à deux ou trois se généralise. Il est ainsi possible de considérer la structure Rn où de manière plus générale Kn avec K un ensemble de scalaires possédant de bonnes propriétés (précisément, K est un corps commutatif). Une telle structure possède une addition, et une multiplication par un scalaire définies comme au paragraphe précédent.
Il est possible de généraliser encore la définition d'un vecteur. Si un ensemble E possède une addition et une multiplication scalaire sur un corps commutatif et si ses opérations vérifient certaines propriétés, appelées axiomes et décrites dans l'article détaillé, alors E est appelé espace vectoriel et un élément de E vecteur.
De très nombreux exemples d'ensembles mathématiquement intéressants possèdent une telle structure. C’est le cas par exemple des espaces de polynômes, de fonctions vérifiant certaines propriétés de régularité, de matrices... Tous ces ensembles peuvent alors être étudiés avec les outils du calcul vectoriel et de l'algèbre linéaire.
La notion de dimension fournit le premier résultat de classification concernant les espaces vectoriels. Dans un espace vectoriel de dimension finie n, il est possible, moyennant le choix d'une base, de se ramener au calcul sur des vecteurs colonnes de taille n. Il existe également des espaces vectoriels de dimension infinie. L'ensemble des fonctions de R dans R est ainsi un espace vectoriel sur le corps des nombres réels, de dimension infinie. Vue sous cet angle, une telle fonction est un vecteur.
Construction algébrique et géométrie
Si les deux constructions, algébrique et géométrique sont équivalentes pour les structures vectorielles du plan et de l'espace usuel, la géométrie apporte en plus les notions de distance et d'angle.
La notion de produit scalaire permet de combler cette lacune. Un produit scalaire associe à deux vecteurs un réel. Si les deux vecteurs sont identiques le réel est positif. Il existe un produit scalaire tel que la norme du vecteur soit égale à la racine carrée du produit scalaire du vecteur avec lui-même. La géométrie euclidienne apparait alors comme l'étude d'un espace affine comprenant un espace vectoriel de dimension deux ou trois sur le corps des réels, muni d'un produit scalaire : plan affine euclidien ou espace affine euclidien.
Une fois équipée d'un produit scalaire, il devient possible de définir sur l'espace vectoriel des transformations classiques de géométrie euclidienne comme la symétrie, la rotation ou la projection orthogonale. La transformation associée aux espaces vectoriels laisse toujours invariant le vecteur nul. Les rotations permettent de définir la notion d'angle pour les vecteurs. L'angle






L'approche algébrique permet de définir toutes les notions de la géométrie euclidienne, elle généralise cette géométrie à une dimension quelconque si les nombres sont réels. Dans le cas des nombres complexes une construction analogue, appelée espace hermitien, existe.