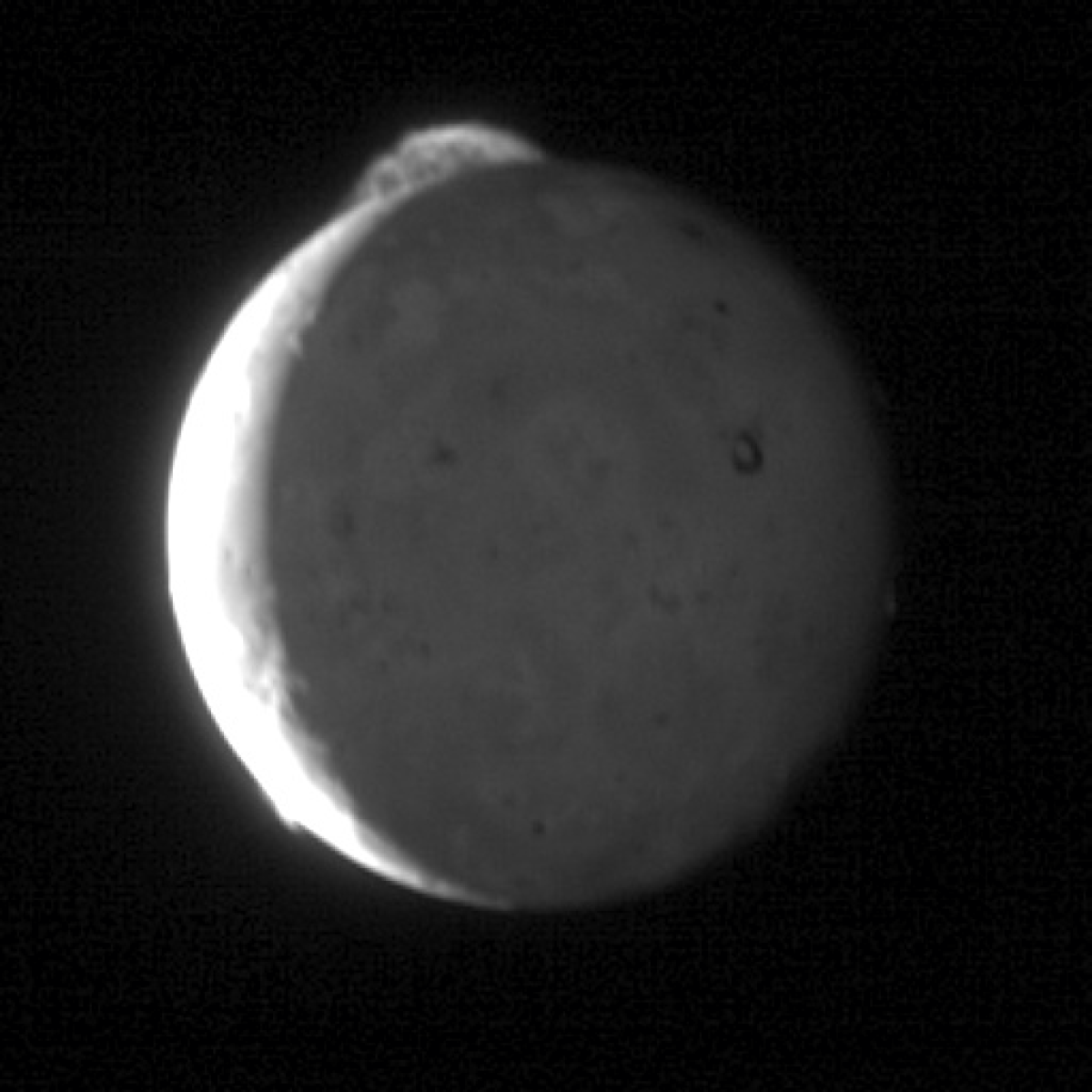Volcanisme sur Io - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Origine du volcanisme
La principale origine de la chaleur permettant la fusion partielle des couches internes de Io est différente de celle sur Terre. Ainsi, en ce qui concerne la Terre, cette température élevée provient principalement de la chaleur résiduelle suite à son accrétion ainsi que de la désintégration des isotopes radioactifs. Dans le cas de Io, cette chaleur tire essentiellement son origine de la dissipation des importantes forces de marée. Ces forces de marée sont provoquées par sa proximité avec Jupiter, par l'écart de masse entre les deux astres, par la révolution synchrone de Io autour de sa planète et par l'excentricité orbitale de Io.
Durant sa révolution autour de Jupiter, Io ne se trouve pas à la même distance de sa planète. Entre le périapside où la lune se trouve le plus près de Jupiter et l'apoapside ou moment où elle en est le plus loin, les déformations de Io se traduisent par deux renflements de cent mètres d'amplitude. Comme Io effectue une révolution synchrone en présentant toujours la même face à Jupiter, la lune ne peut faire varier sa vitesse pour minimiser ces déformations. Enfin, la proximité de Io avec Jupiter et l'écart de masse entre les deux astres expliquent l'importance des déformations, l'attraction gravitationnelle engendrée par Jupiter sur Io étant beaucoup plus importante que dans le cas inverse. Les importantes forces de marée que connait Io auraient dû modifier sa trajectoire afin de trouver une orbite permettant de minimiser les forces engendrées par Jupiter. Cependant, Io est maintenue sur son orbite par Europe et Ganymède, deux autres lunes de Jupiter, qui entretiennent aussi l'excentricité de son orbite par un phénomène de résonance. Ainsi, tandis que Ganymède effectue une révolution autour de Jupiter, Io en réalise quatre et quand Europe en effectue une, Io a fait deux fois le tour de la planète. Cette stabilisation de l'orbite de Io lui permet aussi de ne pas se rapprocher de Jupiter et de franchir la limite de Roche ce qui lui vaudrait de se disloquer lorsque les forces de marée l'emporteraient sur la cohésion interne du satellite.
Les masses rocheuses composant Io sont ainsi soumises à des frictions permanentes. À partir d'une certaine profondeur, les conditions de température et de pression combinées à ces forces de friction permettent la fusion partielle de ces roches sous la forme d'un magma. Ce dernier remonte jusqu'à la surface de Io et donne des laves au cours des éruptions volcaniques. La remontée de ce magma ne s'effectue pas par convection mantellique comme sur Terre mais par déplacement de masses fluides sous l'effet de la gravité. Le flux de chaleur émis par la totalité de la surface de Io est de 0,6 à 1,6×1014 W. Néanmoins, cette chaleur interne s'évacue en quelques endroits du satellite au niveau des volcans tandis que la température du reste de sa surface est relativement basse. Cette situation n'est pas rencontrée sur Terre, la convection mantellique distribuant le flux de chaleur sur toute la surface du globe. Les mesures de ce flux de chaleur émis par Io sont cependant supérieures aux calculs effectués en fonction des forces de marées subies actuellement par le satellite. Certains astrophysiciens expliquent ce phénomène par l'existence d'une chaleur latente produite lorsque les forces gravitationnelles exercées sur Io étaient beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui.
Panaches volcaniques
La découverte des panaches volcaniques des patera Pele et Loki en 1979 a fourni des preuves concluantes de l'activité géologique de Io. En général, les panaches se forment lorsque le soufre et le dioxyde de soufre sont éjectés vers le ciel par les volcans à des vitesses atteignant un kilomètre par seconde. Ces panaches créaient des nuages de gaz et de poussière volatiles en forme de parapluie. Certains composés additionnels, notamment le sodium, le potassium et le chlore, pourraient y être présents. Bien qu'impressionnants, les panaches volcaniques sont en fait relativement rares. Ils n'ont été constatés que sur quelques dizaines des 150 volcans en activité qui ont été observés. Les cratères d'impact étant absents de la surface de Io, les retombées des panaches volcaniques auraient recouvert ceux qui ne l'ont pas été par les coulées de lave, ces dernières ne couvrant pas toute la superficie de la lune.
Le type le plus commun de panache volcanique observé sont les panaches dits de type Prométhée. Ils sont formés de poussières soufflées par la différence thermique lorsque des coulées de laves incandescentes se déversent sur du dioxyde de soufre gelé en surface. Le contraste thermique vaporise les matériaux et les projette dans les cieux. Les exemples de panaches de type Prométhée incluraient ceux des volcans Prométhée, Amirani, Zamama, et Masubi. Cela ne s'élève alors normalement pas au-delà de 100 kilomètres avec des éruptions qui projettent la matière à une vitesse moyenne de 0,5 km/s. Les panaches de type Prométhée sont riches en poussières avec un cœur dense surmonté d'une voûte formant une onde de choc, ce qui donne à l'ensemble l'aspect d'un parapluie. Ils forment des dépôts circulaires lumineux, d'un rayon de 100 à 250 kilomètres essentiellement composés de dioxyde de soufre gelé. Les éruptions de ces volcans sont en flot continu et s'étendent sur de vastes surfaces, renouvelant sans cesse le matériau projeté en l'air. Cela explique la longévité du phénomène observé. Quatre des six panaches de type Prométhée observés par la sonde Voyager 1 en 1979 furent aussi observés par les missions Galileo et New Horizons en 2007. Les panaches de poussière peuvent être facilement observés dans les lumières du spectre visible. Cependant, différents panaches de type Prométhée ont un halo supérieur difficile à voir car plus riche en gaz et, en conséquence, plus ténu.
Les plus grands panaches de Io, du type de celui de Pelé, sont créés quand le soufre et le dioxyde de soufre s'échappent, sous forme de gaz. Ces composés chimiques proviennent du magma volcanique en éruption, des bouches éruptives ou des lacs de lave, et transportent avec eux des éjectas de silicates pyroclastiques. Les quelques panaches de ce type qui ont pu être observés sont la conséquence d'éruptions explosives qui, par essence, sont imprévisibles et éphémères. Le volcan Pele déroge cependant à ce dernier point. Son panache, bien qu'intermittent, est lié à la présence d'un lac de lave permanent. Les particules éjectées à de grandes vitesses qui atteignent 1 km/s sont celles rejetées par les bouches éruptives où règnent les températures et les pressions les plus élevées. Les éjectas s'élèvent alors à des hauteurs comprises entre 300 et 500 kilomètres.
Ils forment des dépôts rouges, composés de courtes chaînes de soufre, et noirs, composés de silicate pyroclastiques, entourés d'un large anneau rouge de 1 000 kilomètres composé lui aussi de soufre. Généralement, les panaches du type Pelé sont plus pâles que les panaches de type Prométhée en raison de la faible teneur en poussières. Aussi sont-t-ils qualifiés de « panaches furtifs ». Ils sont même parfois visibles seulement lorsque Io est dans l'ombre de Jupiter ou encore seulement dans le spectre de l'ultraviolet. Les petites poussières, qui sont observées dans les images du spectre visible, sont générées quand le soufre et le dioxyde de soufre se condensent alors que le gaz atteint le sommet de sa trajectoire balistique. C'est pourquoi on n'observe pas le tronc central sur ces panaches, tronc caractéristique des formes en parapluie des éruptions de type Prométhée. Ici les poussières ne sont pas éjectées à la source de l'éruption, elles sont formées au sommet de l'éjecta. Des exemples de panaches de type Pelé ont été observés à Pele, Tvashtar et Grian.