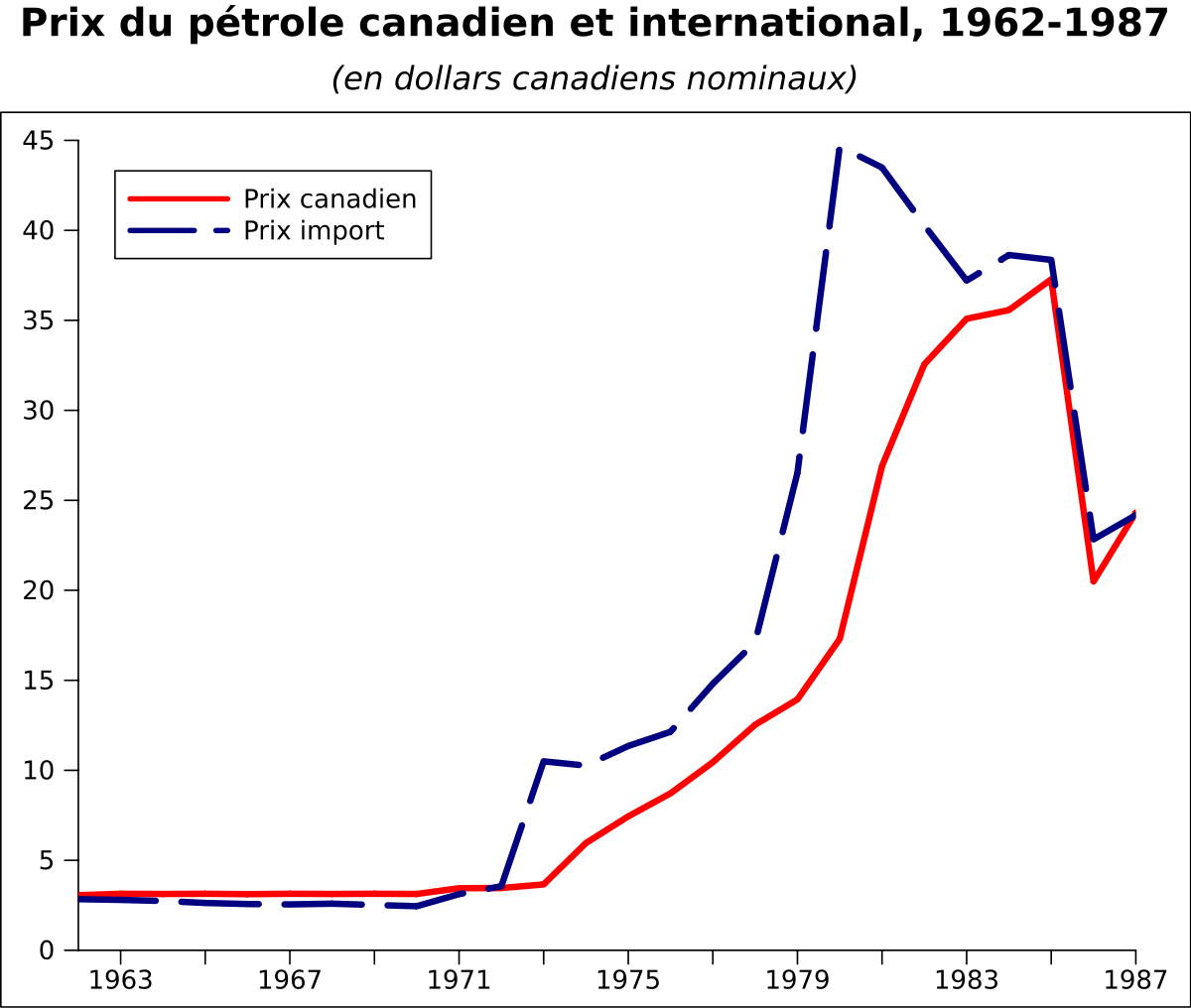Énergie au Canada - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Énergie fossile
Pétrole
Il a fallu plus d'un siècle avant que l'industrie pétrolière canadienne connaisse un véritable départ. Le Canada se targue d'avoir exploité le premier puits commercial au monde, à Petrolia, dans le sud-ouest de l'Ontario en 1858, mais le potentiel pétrolier de l'Alberta est mis en valeur depuis le début du XXe siècle. Un premier grand champ pétrolifère, celui de Turner Valley, est exploité à compter des années 1920.
La découverte d'un important gisement de pétrole à Leduc en février 1947 – une municipalité rurale située à une cinquantaine de kilomètres au sud-est d'Edmonton – arrive à point nommé pour le Canada. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la consommation de pétrole est en pleine croissance, en raison du développement du transport routier.
À cette époque, le charbon constituait plus de la moitié de toute l'énergie primaire consommée au Canada, alors que le pétrole et le gaz ne répondaient qu'au tiers des besoins énergétiques. La production de pétrole domestique ne comblait que 11% de la demande des raffineries canadiennes, le reste étant importé.
Leduc et les premiers pipelines
La découverte de Leduc entraîne une augmentation marquée de la prospection et des nouvelles découvertes, mais le pétrole de l'Alberta ne pourra être commercialisé à une grande échelle à moins qu'il puisse être transporté à coût modique vers les places de raffinage. En 1949, le gouvernement de Louis Saint-Laurent fait adopter la Loi sur les pipelines, qui s'inspire largement de la Loi sur les chemins de fer.
La nouvelle loi, adoptée à la veille d'une élection fédérale, établit un cadre légal balisant la construction et l'exploitation des oléoducs et gazoducs interprovinciaux et internationaux qui relieront les gisements et les lieux de transformation. Parmi les premiers à saisir l'occasion, la société américaine Imperial Oil débute la construction d'un oléoduc de 720 km, l’Interprovincial Pipeline, reliant Edmonton à Regina.
Reste maintenant à déterminer le tracé de l'oléoduc pour atteindre les raffineries de l'Ontario. Afin de réduire les coûts, on envisage de transporter le brut jusqu'au lac Supérieur, où il serait chargé sur des pétroliers et acheminé au centre pétrochimique de Sarnia. Deux tracés s'affrontent. D'un côté, Imperial Oil, le propriétaire du pipeline, fait la promotion d'un tracé en ligne droite qui rejoint le lac Supérieur, à Superior, dans le nord du Wisconsin. De l'autre, l'opposition conservatrice au Parlement revendique, au nom d'un nationalisme énergétique canadien, la construction d'un oléoduc entièrement en sol canadien, qui aurait Port-Arthur (aujourd'hui Thunder Bay) pour terminus.
Le problème est épineux pour C.D. Howe, député de Port-Arthur et « ministre de tout » dans les gouvernements de Mackenzie King et de Saint-Laurent. Howe et le gouvernement acceptent la proposition d'Imperial et le pétrole commence à s'écouler dans le pipeline de 1 840 km dès décembre 1950, juste à temps pour alimenter la croissance substantielle de l'économie canadienne au cours de la période 1951-1956. Le pipeline TransMountain, reliant Edmonton, Vancouver et les raffineries de Puget Sound, dans l'État de Washington est inauguré en 1954.
Compte tenu du débat houleux à la Chambre des communes au sujet de la construction du gazoduc Trans-Canada en 1956, l'élite politique canadienne, tant libérale que conservatrice, arrive à la conclusion que le développement du secteur pétrolier au Canada serait mieux servi par un tribunal administratif, qui désamorcerait le caractère explosif de ces questions. La commission Gordon, mise sur pied par les libéraux, arrive à cette conclusion dès 1957, mais le nouveau premier ministre, John Diefenbaker, décide plutôt de confier le dossier de la réglementation de cette industrie à un groupe dirigé par l'homme d'affaires Henry Borden, un conservateur.
Office national de l'énergie
Malgré ses ressources pétrolières connues et sa capacité de production — qui augmente de 300 000 à 437 000 barils par jour entre 1955 et mai 1957 en raison de la crise de Suez —, le Canada demeure un importateur net de pétrole. La rareté de l'infrastructure de transport entre régions productrices et consommatrices ne permet pas de développer les deux tiers du potentiel.
L'année suivante, la production albertaine redescend sous les 300 000 barils et deux visions contradictoires s'affrontent. D'une part, les producteurs indépendants canadiens, menés par la compagnie Home Oil et appuyés du premier ministre albertain, Ernest Manning, militent pour l'approvisionnement des raffineries de Montréal avec la construction d'un oléoduc qui aurait acheminé 200 000 barils par jour en 1960, pour augmenter a 320 000 barils en 1965.
Le projet aurait eu l'avantage de sécuriser l'accès au marché domestique pour les producteurs indépendants canadiens afin d'écouler un plus grand volume le plus rapidement possible, de créer de l'activité économique dans toutes les régions canadiennes, tout en réduisant les importations de brut dans l'est du Canada, ce qui aurait eu un avantage sur la balance des paiements et la sécurité des approvisionnements.
Toutefois, le coût du pétrole albertain livré à Montréal, principale place de raffinage du Canada à l'époque, aurait coûté 10 % plus cher que le brut vénézuélien livré par bateau par le Saint-Laurent ou l'oléoduc Portland-Montréal, affirment les compagnies pétrolières internationales installées à Montréal, ce qui aurait eu pour effet d'augmenter les prix à la pompe. Dans tout ce dossier, les parlementaires québécois demeurent silencieux, convaincus par l'argument des Sept Sœurs.
La commission Borden propose donc un compromis. Elle recommande la création d'un Office national de l'énergie et la création d'un marché protégé pour le pétrole canadien, mais établit une « frontière » au-delà de laquelle le pétrole serait acheté sur le marché international. Les régions à l'est de la rivière des Outaouais – en gros, le Québec et les provinces de l'Atlantique – continueront de s'approvisionner sur le marché international alors que les régions à l'ouest consommeront le pétrole de l'Alberta. La frontière, appelée la « ligne Borden », sera établie par le gouvernement Diefenbaker en 1961.
Politique d'exportation
La Politique nationale du pétrole (PNP) de 1961 tient compte des intérêts des uns et des autres; l'Alberta se garantit un marché réservé pour sa production dont les coûts sont plus élevés que le prix mondial, l'Ontario obtient l'expansion de son industrie pétrochimique et Montréal peut conserver ses prix moins élevés. L'équilibre de la balance commerciale est atteint pour le gouvernement fédéral puisque les importations de pétrole à bas prix de l'est sont compensées par des exportations du pétrole plus cher vers les États-Unis.
La place marginale occupée par les producteurs canadiens dans l'industrie pétrolière préoccupe assez peu les politiciens fédéraux dans les années qui précèdent le premier choc pétrolier. À l'exception de mesures fiscales proposées dans le discours du budget de 1963 de Walter L. Gordon, mesures qui ont dû être retirées en raison de l'opposition du Parti progressiste-conservateur, des pétrolières et des milieux financiers, les gouvernements Pearson et Trudeau ne freinent pas le mouvement de concentration de la propriété de l'industrie par des intérêts américains. Ainsi, en 1962, les huit grandes sociétés pétrolières internationales possèdent 62 % des concessions et 95 % de la capacité de raffinage. Tout au plus, les gouvernements font-ils quelques acquisitions, dont un intérêt de 45 %, acquis en 1967 dans la Panartic Oils, une entreprise de prospection spécialisée dans les projets spéculatifs des régions pionnières dans l'Arctique. Les gouvernements successifs se contentent plutôt de promouvoir l'exportation du pétrole canadien vers les États-Unis et l'Office national de l'énergie accède aux demandes de permis.
Le ministre de l'Énergie dans le premier gouvernement Trudeau, Joe Greene, s'était fait une priorité d'augmenter les ventes de pétrole et de gaz canadien, allant même jusqu'à affirmer en 1971 que le Canada disposait de 923 ans de réserves de pétrole et de 392 ans de réserves de gaz. Ces prévisions fort optimistes ne résisteraient pas aux événements qui allaient secouer le monde occidental moins de deux ans plus tard.
Le statu quo pour l'industrie commence à changer le 10 septembre 1971. Ce soir-là, les Albertains chassent le Crédit social du pouvoir après 36 années de règne ininterrompu. Le nouveau premier ministre, le conservateur Peter Lougheed, décide d'entamer des négociations avec l'industrie afin d'augmenter la redevance pétrolière prélevée par sa province et que le gouvernement précédent avait fixée à 16,7 % dans une loi datant de 1949. Le gouvernement va de l'avant et propose l'ajout d'une taxe sur les réserves, qui a le même effet que d'augmenter la redevance à 23 % en 1972. Cette proposition est retirée quelques mois plus tard, en raison de mesures fédérales et Lougheed décide unilatéralement de réorganiser le système de redevance, en fonction des augmentations de prix, ce qui désarçonne l'industrie, qui croyait pourtant avoir à faire avec un conservateur partisan de la libre entreprise.
Premier choc pétrolier

Pendant ce temps à Ottawa, le gouvernement est mal préparé à l'embargo déclaré par les membres de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP), à la suite du déclenchement de la guerre du Yom Kippour.
Le gouvernement fédéral manque d'information sur la situation et les réserves pétrolières et ses interventions précédentes dans le secteur pétrolier – notamment la tentative de prise de contrôle par le gouvernement de Home Oil, à l'époque la plus importante société pétrolière sous contrôle canadien – avaient été dictées par des impératifs politiques. La création d'une société pétrolière nationale devient une question abordée publiquement afin de faire face à la domination des capitaux américains sur les ressources naturelles canadiennes.
Les fonctionnaires travaillent sur une politique énergétique qui est rendue publique en juin 1973. La politique aborde la création d'une société pétrolière nationale (SPN) qui « pourrait être l'instrument puissant qui permettrait au Canada de faire contrepoids aux influences étrangères dans son propre secteur pétrolier et gazier ». Le rapport évite toutefois de trancher la question, se contentant de souligner certains avantages et inconvénients d'une telle décision.
Mais la situation géopolitique devient de plus en plus tendue et les prix montent. Le gouvernement Trudeau qui, quelques années plus tôt, moussait les exportations à destination des États-Unis et se targuait d'avoir des réserves immenses devient plus discret. L'Alberta, qui exporte 1,2 Mbbl/j en 1973 grâce à la levée des contrôles à l'importation américains, produit à la limite de ses capacités. L'Office national de l'énergie intervient et, pour la première fois de son histoire, refuse de permettre une partie des exportations, en raison de la capacité limitée de transport.
Les partis d'opposition réclament la création d'une SPN et les consommateurs sont mécontents de la hausse des prix à la pompe. Le 4 septembre 1973, Un mois avant le déclenchement des hostilités au Proche-Orient, le gouvernement annonce trois mesures. Il impose un gel « volontaire » des prix intérieurs pour cinq mois, annonce le prolongement de l'oléoduc interprovincial de Toronto à Montréal et impose une taxe à l'exportation de 40 cents le baril. Cette taxe à l'exportation passe à 1,90 dollar en décembre 1973, à 2,20 dollars en janvier 1974, à 4 dollars en avril et à 5,20 dollars en juin.
Parallèlement à cette effervescence à Ottawa, de nouveaux réseaux d'approvisionnement sont organisés d'urgence pour desservir les raffineries de l'est. En attendant l'ouverture de l'oléoduc Toronto-Montréal, qui livrera ses premiers volumes au milieu de 1976, des pétroliers et des trains font la navette entre Sarnia et Montréal, tandis que d'autres vaisseaux sont chargés de brut à Vancouver pour être expédiés à l'est, via le canal de Panamá.
Contrôle des prix
Le 22 novembre, le premier ministre Trudeau intervient à la télévision pour affirmer que l'Alberta a touché un avantage de 500 millions $ dans le passé en vendant du pétrole au prix fort à l'Ontario et que désormais, l'Alberta devrait subventionner les consommateurs de l'est, une première salve dans la guerre qui opposera Ottawa et Edmonton pendant toute une décennie.
La question fondamentale que soulève le nouveau programme de fixation d'un prix unique est le suivant : doit-on fixer ce prix unique en fonction du pétrole international livré au quai à Montréal ou utiliser le prix d'Edmonton? Les libéraux fédéraux se présentent comme l'arbitre ultime entre les intérêts des provinces productrices, qui veulent maintenir des prix plus élevés afin d'assurer la sécurité et la pérennité des approvisionnements et les provinces consommatrices, plus préoccupées par le maintien de leur secteur manufacturier et qui réclament, en conséquence, des prix plus bas.
Tandis qu'Ottawa en appelle à la « responsabilité fraternelle » des Albertains envers leurs compatriotes, Edmonton réplique que le pétrole et le gaz sont des ressources non renouvelables et qu'elles doivent être vendues « uniquement à des prix qui reflètent leur valeur réelle ».
Selon Peter Foster, Ottawa n'avait pas simplement pour but de préserver une équité théorique entre les régions. La croissance spectaculaire des revenus pétroliers du gouvernement albertain, qui produisait 90 % du brut canadien, pouvait mettre en péril le système de péréquation, bien que les revenus énergétiques n'étaient pas totalement comptabilisés dans le cadre de la formule. Et pendant qu'Edmonton augmente substantiellement ses redevances, Ottawa exclut ces paiements des dépenses déductibles, ce qui frappe doublement les producteurs.
En situation minoritaire au Parlement et donc soucieux des conséquences électorales des prix du pétrole, Trudeau convoque les premiers ministres à une conférence fédérale-provinciale sur l'énergie en janvier 1974, où il obtient des provinces l'adoption du principe d'un prix unique pour le pétrole à travers le Canada. Le prix du baril est fixé en mars à 6,50 $ pour le marché intérieur et à 10,50 $ pour le pétrole destiné à l'exportation, la différence entre les deux prix constituant une taxe à l'exportation. Les prix restent en vigueur jusqu'au 1er juillet 1975 et réduisent considérablement les volumes exportés, qui passent de 1,2 million de barils en 1973 à 282 000 barils quatre ans plus tard.
Le gouvernement fédéral peut donc respirer un peu. Après l'élection de juillet, où le Parti libéral obtient une majorité, le gouvernement fait adopter la Loi sur l'administration du pétrole, qui renforce les pouvoirs fédéraux en cas d'impasse dans les négociations avec les provinces. Une conférence fédérale-provinciale convoquée en avril 1975 ne réussit pas à obtenir un consensus, l'Ontario faisant valoir que 90 % de la hausse des 18 mois précédents s'était retrouvée dans les coffres des provinces productrices et du gouvernement fédéral. Ottawa conclut donc à l'échec de ce mécanisme et utilise donc ses nouvelles compétences en vertu de la Loi sur l'administration du pétrole pour imposer une hausse de 1,50 $ du prix administré qui passe à 8 $ le baril, à compter de juillet 1975. Les prix augmenteront graduellement deux fois par année durant les années suivantes, pour atteindre 80 % du prix mondial en 1978.
Petro-Canada
Le 6 décembre 1973, le gouvernement fédéral présente un programme en 11 points afin de remplacer la politique pétrolière héritée du rapport Borden. La pièce maîtresse de cette politique – qui a pour objectif l'autosuffisance canadienne en matière pétrolière avant la fin des années 1970 –, est l'annonce de la création prochaine d'une société pétrolière nationale, qui aurait pour mandat d'augmenter la présence d'intérêts canadiens dans l'industrie. Doern et Toner précisent toutefois que la volonté du gouvernement fédéral n'était pas de nationaliser le secteur, la création de ce qui deviendra Petro-Canada devant plutôt être considérée comme une alternative à la nationalisation.
Le projet de loi C-32 est présenté à la Chambre des communes en mai 1974, mais il mourra au feuilleton quelques jours plus tard, en raison de la défaite du gouvernement minoritaire. Reporté au pouvoir avec un mandat majoritaire lors de l'élection du 8 juillet 1974, le gouvernement libéral réintroduit le projet de loi abandonné avant la fin des travaux du Parlement précédent.
Dans le projet de loi qui a été adopté en 1975, Petro-Canada avait le mandat d'accroître la propriété canadienne dans le secteur, toujours dominé par Imperial et les autres majors américains, de servir d'intermédiaire avec d'autres SPN et d'investir dans l'exploration dans les régions pionnières de l'Arctique. Sans l'exclure totalement, la déclaration du premier ministre Trudeau de décembre 1973 avait insisté pour réduire les attentes au sujet de l'entrée de Petro-Canada dans les activités en aval – le raffinage et la vente au détail.

Le 1er janvier 1976, la nouvelle société de la Couronne amorce ses opérations modestement par une rencontre de ses quatre employés dans un café de Calgary. Pendant les premiers mois de son existence, Petro-Canada joue un rôle modeste, gérant les quelques intérêts pétroliers du gouvernement fédéral, dont la participation à Panartic Oil et la participation de 15 % dans le projet Syncrude d'exploitation des sables bitumineux.
En août, elle acquiert la société Arcan, la filiale canadienne du groupe Atlantic Richfield pour la somme de 340 millions $, ce qui permet à la société de débuter ses opérations d'exploration, notamment dans le delta du Mackenzie et dans la région de l'île de Sable, en Nouvelle-Écosse.
Moins de deux ans plus tard, Petro-Canada lance une offre publique d'achat sur Husky Oil, qui détenait des droits sur le gisement de Lloydmister, à la frontière de l'Alberta et de la Saskatchewan, mais la société d'État est doublée en douce par Alberta Gas Trunk Line (qui allait devenir NOVA). Qu'à cela ne tienne, l'attention portée à la prise de contrôle ratée de Husky en masque une autre transaction, avec Pacific Petroleum, qui est négociée en parallèle. La transaction de 1,5 milliard $, annoncée en novembre 1978 et complétée en juillet de l'année suivante, est financée à partir d'une émission d'actions privilégiées en devises américaines auprès des principales banques à charte canadiennes.
Bien que principalement impliquée dans l'exploration et l'extraction, Pacific est une entreprise intégrée, « présente dans le raffinage, la distribution et la commercialisation à l'ouest de Thunder Bay », mettant la société de la Couronne en concurrence directe avec les entreprise privées en aval pour les dollars des consommateurs.
La situation présente un dilemme pour le gouvernement conservateur minoritaire de Joe Clark, qui prend brièvement les rênes du pouvoir après l'élection du 22 mai 1979. Car aussi impopulaire qu'elle puisse être au sein du nouveau gouvernement – M. Clark a promis de privatiser la société pétrolière –, l'apparition de stations-service de Petro-Canada suscite une forte adhésion du public.
Deuxième choc pétrolier
Une autre raison refroidit l'ardeur du gouvernement à privatiser la société pétrolière nationale. La situation internationale s'emballe en raison de la prise de contrôle de l'Iran par les Gardiens de la Révolution et en conséquence, le prix du brut double dans la deuxième moitié du mois de mai 1979.
À nouveau, la situation géopolitique force le gouvernement du Canada à intervenir dans le dossier énergétique. Joe Clark se trouve pris — comme Trudeau avant lui —, entre les positions irréconciliables de deux premiers ministres aux intérêts diamétralement opposés. Et l'appartenance à la même famille politique des trois protagonistes de 1979 ne change rien à la situation. Bill Davis de l'Ontario plaide que chaque hausse d'un dollar du prix du brut augmente l'inflation de 0,6 % et le chômage de 0,2 % dans la province la plus populeuse du pays, tandis que Peter Lougheed de l'Alberta demande une hausse de prix qui ajusterait les prix administrés canadiens aux cours en vigueur à Chicago, en plus de demander le maintien de la proportion des revenus tirés par sa province. Clark doit également considérer l'impact sur les finances publiques d'un niveau de subvention élevé dans un contexte de déficit budgétaire important au niveau fédéral. En l'absence de consensus, le gouvernement présente une augmentation de la taxe d'accise sur l'essence de 18¢ le gallon, dans le budget présenté par le ministre des Finances, John Crosbie, le 11 décembre 1979. Quelques jours plus tard, le gouvernement conservateur subira la défaite dans un vote de confiance, ce qui provoque une deuxième élection générale en moins d'un an.
Mais contrairement à 1975, alors que Trudeau avait fait fi de l'intransigeance de Davis, Lougheed est le grand perdant de l'impasse de 1979. En contribuant à l'impasse qui a provoqué la défaite des Tories en chambre et au retour de Pierre Elliott Trudeau, l'année suivante, le premier ministre albertain s'est retrouvé avec un interlocuteur fédéral beaucoup plus enclin à imposer une politique plus centralisatrice, soulignent Doern et Toner.
Programme énergétique national
Développement du pétrole non conventionnel
Gaz naturel
Charbon

L'exploitation du charbon au Canada remonte au XVIIe siècle alors qu'une petite mine de charbon débute ses opérations dans la région de Minto, au Nouveau-Brunswick. En 1720, les soldats français ouvrent une mine au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, afin d'approvisionner la forteresse de Louisbourg. Après la Conquête, les mines du Cap-Breton ont commencé à exporter leur production vers Boston et d'autres ports aux États-Unis. Dans l'ouest canadien, des gisements ont commencé à être exploités à compter de 1852. À compter des années 1880, la construction du chemin de fer transcontinental à travers l'Alberta et la Colombie-Britannique a entraîné l'ouverture de mines à proximité du chemin de fer. Dès 1911, les mines de l'ouest produisaient déjà la majorité du charbon canadien et constituent aujourd'hui 95 % du total canadien.
Afin de protéger les mines du Cap-Breton de la concurrence américaine qui accédait au marché ontarien par les Grands Lacs, le gouvernement canadien impose des droits de douane dès 1887. Le gouvernement fédéral a longtemps poursuivi une politique de protection du charbon de la Nouvelle-Écosse qui s'est poursuivie par l'implication du gouvernement d'Ottawa dans l'exploitation des gisements de la région de Sydney, par l'entremise de la Cape Breton Development Corporation, ou DEVCO à compter de 1967. Les mines de Linden, Phalen et Prince ont cessé leur exploitation entre 1992 et 2001.
L'Alberta est aujourd'hui le principal producteur de charbon, qui abonde dans son sous-sol; on y retrouve des dépôts de charbon sur 48% du territoire.