Histoire de la faculté libre de médecine de Lille - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Naissance de la faculté libre de médecine de Lille
État des lieux de l'enseignement de la médecine à Lille en 1875
A Lille en 1805 une École secondaire de médecine est créée par arrêté préfectoral. Elle occupe les locaux de l'Hôpital Militaire. Cette École secondaire de médecine prend en 1852 le nom d'école préparatoire recevant une centaine d’élèves dont la moitié ne vise que le simple officiat de santé.
En 1872, le conseil municipal lillois demande la transformation de son école secondaire en faculté. Après l'inspection de l'instruction publique, cette demande est écartée, considérée comme trop coûteuse.
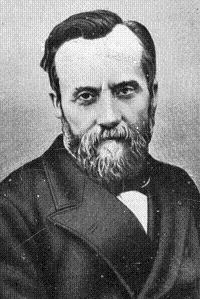
Il faudra attendre 1875 pour que cette transformation soit enfin acceptée.
Dans ces conditions, la création d’une faculté de médecine à Lille, de surcroît catholique, est un audacieux pari! Cette faculté verra donc le jour dès le deuxième semestre de l’année 1876. Le docteur Camille Feron-Vrau en est le principal artisan. Son objectif est la formation du médecin chrétien en réaction à l’enseignement officiel rationaliste et agnostique.
Avant même que les premières difficultés ne soient aplanies, Feron-Vrau proclame son but:
« Et tout d’abord, nous voulons tous une Faculté de médecine digne de notre université catholique, une Faculté de premier rang par les aptitudes scientifiques non moins que par la valeur morale des maîtres, par la distinction et l’élévation scientifique de ses élèves, par son fonctionnement, par la richesse de son matériel et de ses collections, par l’ensemble des services qu’elle est appelée à rendre à un degré éminent à notre région, à la France et à la religion catholique».
Les cliniques: l'Hôpital Sainte-Eugénie
La voie rendue libre, l'Institut Catholique de Lille ouvrait officiellement les portes de la faculté de Droit en novembre de la même année (1875).
Pour mériter le titre d'Université, l'Institut devait ajouter deux autres Facultés. Ce furent celles des lettres et des sciences qui naquirent les premières, car de graves difficultés surgirent lorsqu'on voulut créer la Faculté de Médecine.
En effet, l'installation d'une Faculté dont le but avoué était la préparation au doctorat en médecine n'était pas une mince affaire.
Elle devait respecter trois impératifs: posséder des bâtiments universitaires adaptés, rassembler un corps professoral qualifié et enfin posséder un minimun de 120 lits de médecine, de chirurgie et d'obstétrique pour l'enseignement de la clinique
La Faculté ne possède encore aucun de ces éléments et la tache immense de les réunir est confiée à C. Feron-Vrau.
Parmi les exigences celle de disposer « de cent vingt lits au moins », c’est-à-dire « la question de l’hôpital est /... / la plus importante à coup sûr et la plus difficile à résoudre», mais elle se trouve immédiatement satisfaite par « un coup de maître » de la commission d’organisation.
En 1866, l’administration des Hospices a entrepris la construction d’un vaste hôpital de 400 lits, placé sous le vocable de Sainte Eugénie, en hommage à l’épouse de Napoléon III.
Mais, le gros oeuvre terminé après une dépense de plusieurs millions, elle ne dispose plus des ressources suffisantes pour aménager le nouvel édifice et le mettre en état de recevoir les malades.
C'est alors que le conseil d'administration de L'Institut Catholique fait à la Commission des Hospices l'offre suivante: Il s'engage à verser une somme de 140 000 francs destinée à compléter l'équipement de deux des quatre pavillons, soit 120, puis 200 lits, à la condition que les médecins, chirurgiens, pharmaciens et étudiants en médecine de l'Université catholique assurent le fonctionnement des services de médecine et de chirurgie de deux pavillons.
La proposition est discutée par la commission des hospices et les bases de la convention sont arrêtées le 25 septembre 1875. Le maire de Lille accepte les termes de la convention.
Selon les termes de l'accord, les services cliniques doivent donc être prêts à fonctionner dès le 1er octobre 1876 au plus tard.......
Le premier corps professoral
C’est encore Camille Feron-Vrau qui s'attèle à la tâche difficile de recruter les enseignants. A plusieurs reprises, il fait le tour des facultés françaises de Paris à Montpellier et à Nancy. Lille même, nous l’avons dit, offre assez peu de ressources. Seul, le docteur Louis Wintrebert, licencié ès sciences physiques, accepte de quitter l’école secondaire de médecine, où il était professeur adjoint, pour la nouvelle faculté.
Un jeune médecin, François Guermonprez, ancien chef de clinique à la même école secondaire de médecine Lille, est recruté avec le titre de répétiteur en pathologie.
L’une de ces notes, parmi une dizaine de noms, propose celui d’Henri Desplats. Celui-ci, ancien interne des Hôpitaux de Paris, se préparant au concours de médecin des Hôpitaux et admissible à l’agrégation, manifeste de grandes qualités de clinicien. Il accepte d’emblée les propositions de C. Feron-Vrau.
Le Pr Desplats désigne le docteur Jean-Baptiste Bouchaud, ex-interne des hôpitaux de Paris, récemment installé à La Souterraine, qui vient à Lille dès février 1876 ; il est nommé médecin de l’asile de Lommelet situé dans la commune de Marquette, il assurera initialement l’enseignement de la pathologie externe. De Paris également, sont issus le Pr Gonzague Augier chargé de l’enseignement de l’anatomie pathologique et de la clinique médicale infantile, le docteur Adrien César, chef des travaux anatomiques, et les docteurs Challe et Bricart, respectivement chefs de clinique médicale et chirurgicale.
À Nancy est recruté pour l’enseignement de la chimie minérale et la pharmacologie M. Schmit, pharmacien et docteur ès sciences.
A plusieurs reprises, C. Feron-Vrau se rend à Montpellier, la plus illustre des facultés de médecine de province où, non sans difficultés, il s’attache une recrue de premier plan : Antoine Béchamp, docteur ès sciences et en médecine. Ses travaux, menés depuis vingt ans à Strasbourg, puis à Montpellier, lui donnent un renom scientifique indiscuté dans le domaine de la chimie et de la biologie : il enseignera donc la chimie organique et biologique. Son adhésion à la cause de la Faculté catholique de médecine semble acquise dès octobre 1875, mais il se fait quelque peu prier et il met deux conditions qui sont acceptées: occuper le poste de doyen de la Faculté et emmener avec lui son fils Joseph, chimiste et docteur en médecine
Avant de quitter Montpellier, Béchamp recommande un de ses élèves, le docteur Ernest Baltus. M. Baltus sera, dès l’origine, pour occuper le poste de professeur titulaire de physiologie. De Montpellier, arrivent encore d’autres candidatures : en août, le docteur Gonzague Eustache, professeur agrégé (de médecine légale) à la Faculté depuis quatre ans, s’offre à remplir les fonctions de professeur d’anatomie jusqu’à l’ouverture de la clinique chirurgicale dont il postule la chaire. Également recommandé par A. Béchamp, le docteur Dominique Domec, après un séjour à la faculté de médecine de Quito (Équateur), arrivera à Lille en octobre 1877, pour enseigner l’anatomie.
Dans le corps de médecine militaire, on recrute le docteur Eugène Papillon, médecin militaire et, en dernier lieu, médecin-chef de l’hôpital militaire de Saint-Omer, qui, le 25 octobre 1876, se propose pour l’enseignement de la pathologie interne ou de pathologie et thérapeutique médicales avec un service de maladies des enfants ou de maladies des yeux ; Julien Jeannel, docteur en médecine, pharmacien inspecteur général du Service de santé, se chargera de la chaire de matière médicale et des fonctions de direction des services de pharmacie ; Jean-Marie Rédier, également médecin militaire, candidat à l’agrégation du Val-de-Grâce, arrivera à Lille en septembre 1877 pour assurer l’enseignement de la pathologie externe et, ce qui est un élément nouveau en France, de la stomatologie .
Le docteur Adolphe Faucon, ancien chirurgien militaire, qui exerce à Amiens, entrera en fonction dès les premiers mois de 1877. Dans la Marine enfin, est recruté le Dr Alfred Jousset, médecin de 1re classe, qui sera en juillet 1877 professeur de médecine opératoire.
La plupart des professeurs ainsi recrutés seront titulaires.
Renforcé encore par les professeurs de la Faculté des Sciences, MM. Chautard, Witz, Schmitt, Boulay, Cairol, le corps professoral est, en cette fin de l’année 1876, suffisant pour ouvrir au moins les deux premières années de médecine et de pharmacie et assurer le fonctionnement de l’hôpital Sainte-Eugénie.
Les premiers locaux d'enseignement de la Faculté libre de médecine
En attendant la construction d’une nouvelle faculté, il faut trouver des locaux provisoires, mais adaptés et répondant aux exigences de la loi : six laboratoires distincts (physique, chimie, pharmacie et toxicologie, histoire naturelle, physiologie, histologie) deux salles de cours dont un grand amphithéâtre, une salle d’anatomie, ainsi qu’un jardin botanique.
La meilleure solution serait de les installer à proximité des services cliniques qui vont s’ouvrir à l’hôpital Sainte Eugénie, mais le préfet Lizot, qui a succédé à M. Leguay, refuse d’approuver la nouvelle convention.
Les administrateurs en sont avertis le 17 juillet : d’urgence il faut rechercher d’autres solutions. Bientôt, une opportunité intéressante s’offre à eux quand ils apprennent que les Pères jésuites quittent leur collège Saint-Joseph, sis au 78 rue de la Barre, anciennement maison Saint-Maur et plus connu maintenant sous le nom d'Hospice Stappaert.
Dès la signature de l’acte, on entreprend les travaux d’aménagement nécessaires pour l’accueil des deux facultés de Médecine et de Sciences. Le jardin Botanique sera planté dans une des cours extérieures.
Les dispensaires
Dans l'esprit de C. Feron-Vrau, les dispensaires présentent une double facette, universitaire et charitable, tout à fait dans la ligne des objectifs de l'Université catholique.
Fin mai 1877, deux maisons ont été louées en pleine ville, l'une au 32 de la rue des Fossés, l'autre au 72 de la rue de Paris, face à l'église Saint-Maurice.
Le dispensaire de la rue de Paris est confié aux Sœurs de la Charité (St Vincent de Paul), celui de la rue des Fossés aux Pères Camilliens dont la vocation est le service des malades. Camille feron-Vrau les a découverts et a développé avec eux une étroite collaboration jusqu'à leur expulsion en 1902.
Il faut choisir un nom pour ces deux dispensaires. C'est Saint-Raphaël qui est choisi pour le dispensaire de la rue de Paris qui ouvre ses portes le 15 octobre 1877. Pour le dispensaire de la rue des Fossés inaugurée le 15 août 1877 (réservé aux hommes) le nom de Saint-Camille est évidemment retenu.
On attribue ainsi sur leur demande les consultations des maladies des enfants au Dr Wintrebert, celles des maladies des yeux au Dr Dujardin, celles des maladies de la bouche et des dents au Pr Redier, celle des maladies de la peau et syphilitiques au Pr Vanverts, accoucheur, celles des maladies nerveuses et mentales au Pr Bouchaud, celles des maladies des femmes au Pr Eustache. La consultation de médecine est confiée au Pr Baltus, celle de chirurgie au Pr Jousset. Le Pr Julien-François Jeannel, nommé directeur des dispensaires, assure le contrôle de la pharmacie.
Le dispensaire de Saint-Camille emménagera dans ses nouveaux locaux,rue de la Bassé, en mai 1880. En 1886, le dispensaire Saint-Raphaël sera transféré de la rue de Paris à la rue du Port, au n° 86, où un grand bâtiment de style néogothique a été érigé. Trois ans plus tard, la Maternité Sainte-Anne l’y rejoindra, lorsque l’aile droite en sera construite.

















































