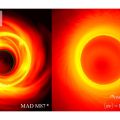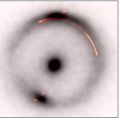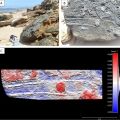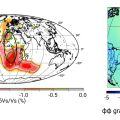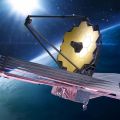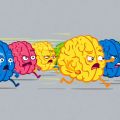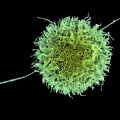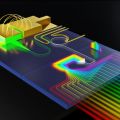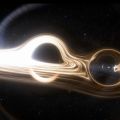Dépression (psychiatrie) - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
La dépression chez l'adulte
Du point de vue de la psychiatrie, la dépression est un trouble de l'humeur pouvant résulter de l'interaction d'un ensemble de facteurs :
- biologiques (déséquilibre dans la chimie des neurotransmetteurs du cerveau),
- psychologiques (intrapsychiques)
- sociaux (ex : divorce, chômage, etc.)
Dans cette perspective, il s'agit d'un trouble psychiatrique, comportant souvent des risques, pouvant parfois mener au suicide. Du point de vue épidémiologique, les chercheurs estiment que cette maladie est sous-diagnostiquée, sous-estimée et sous-traitée. Elle se manifeste la plupart du temps par une conjonction et/ou une addition de symptômes comme :
- troubles du sommeil ;
- manque d'énergie, de motivation ;
- l'humeur triste ;
- irritabilité ;
- mal de vivre,
- etc.
Chez l'enfant et l'adolescent, les dépressions se manifestent de manière moins typique avec des symptômes variables qui cachent la tristesse ou le désespoir.
Épidémiologie de la dépression
En France, la dépression frappe chaque année 3 millions de personnes âgés de 15 à 75 ans (deux fois plus de femmes que d'hommes). Sachant qu'un cas sur deux n'est pas soigné, ce chiffre progresse avec la précarité, le vieillissement et la solitude. Des études montrent que :
- 15 à 22 % des patients de médecine générale montrent des troubles dépressifs (5 à 9 % ont une dépression majeure, 2 à 4 % une dysthymie, 8 à 9 % une dépression mineure) ;
- 30 à 50 % des dépressions ne sont pas diagnostiquées ;
- 40 à 70 % des personnes qui se suicident ont consulté un médecin dans le mois qui précède.
Cette très grande fréquence des symptomes, indique la difficulté à classifier dans un épisode existentiel de remise en cause, de souffrance, de perte, ou bien dans une maladie organique ; La question du normal et du pathologique a été travaillée par Georges Canguilhem.
On voit donc que le diagnostic n'est pas évident, d'une part parce que les personnes ne sont en général pas conscientes elle-même de leur dépression, et se présentent pour des troubles somatiques trompeurs, en général des douleurs. Selon Jay Pomerantz,le fait de poser systématiquement les deux questions suivantes à chaque consultations permettrait d'améliorer le diagnostic de dépression (ce test aurait une spécificité de 67 % et une sensibilité de 97 %) :
- Avez-vous durant le mois écoulé ressenti des sentiments d'épuisement, de dépression ou de désespoir ?
- Avez-vous, au cours du même laps de temps, éprouvé une perte d'intérêt ou de plaisir dans vos activités ?
En termes d'incapacité de travail chez l'adulte, la dépression occupe la quatrième place (en nombre d'années d'incapacité) au niveau mondial et pourrait se placer à la seconde place dans les années 2020, juste après les maladies cardio-vasculaires.
L'Association américaine de psychiatrie recommande que trois consultations au minimum soient programmées au cours des trois mois qui suivent le diagnostic d'une dépression, même mineure. En effet, les traitements anti-dépresseurs étant de longue durée, il y a un risque accru que le patient arrête lui-même son traitement.
Cas particuliers
Dépression du bébé
Des tableaux de dépression graves, pouvant mettre en jeu le pronostic vital, ont été décrits depuis les années 1950 chez les bébés, notamment après de brutales pertes parentales. René Spitz a ainsi défini l'hospitalisme, état survenant lors d'une séparation brutale avec les parents, passant par une phase de pleurnichements, puis une phase de protestation, glapissement, perte rapide de poids, arrêt du développement ; puis une troisième phase de désinvestissement du monde qui l'entoure et de retrait conduisant à ce que Spitz a nommé la dépression anaclitique. Ce tableau clinique peut régresser si des mesures adéquates sont prises rapidement. S'il se prolonge, il peut être à l'origine de troubles intellectuels, des apprentissages, de difficultés psychologiques, avec une plus grande vulnérabilité aux séparations, réalisant des tableaux carentiels dont le risque évolutif est lourd.
Dépression de l'enfant
Lorsqu'on évoque la dépression chez l'enfant on est frappé par le contraste entre sa fréquente référence au niveau théorique - notamment psychanalytique - et sa la rareté des présentations des tableaux cliniques qui ne soit pas adultomorphe.. C'est la psychanalyste Mélanie Klein qui une des premières parlera de la dépression de l'enfant dans sa théorie de la position dépressive devant intervenir au sevrage, autour du sixième mois. La théorie de Mélanie Klein doit être bien connue pour être opérationnelle en pédopsychiatrie, de même que plus tard chez l'adolescent et l'adulte, les signes dépressifs peuvent être la résultante d'une défense contre la position dépressive, elles ne sont donc pas assimilables. Des auteurs nombreux, le pédiatre Donald Winnicott (qui parlait lui d'inquiétude ou de "compassion", 1954) a critiqué la précocité de cette "position" ainsi que Margaret Mahler qui la situait entre le seizième et le vingt-quatrième mois. C'est ensuite Bowlby avec ses travaux sur l'attachement qui en a étudié les effets comme conséquence des séparations (qu'il ne faut cependant pas confondre avec "dépression") qui rejoignent en partie les observations de René Spitz citées plus haut. Lorsqu'elle se manifeste de manière qui peut s'apparenter à celle de l'adulte, la dépression de l'enfant se traduit par des pleurs, de la tristesse, de l'ennui, de l'indifférence et de la fatigue. La dévalorisation de soi s'exprime par des constats répétés: "j'peux pas", "j'y arrive pas" qui se manifestent aussi dans les jeux et au plan scolaire. L'enfant se sent mal aimé et incompris. Les symptômes physiques sont fréquents, insomnies, anorexie (atypique) maux de ventre et maux de tête. Le clinicien, dans son investigation par l'entretien clinique, le dialogue avec l'entourage : parents, enseignants et éventuellement fratrie doit détecter à partir de manifestations indirectes les signes d'un éventuelle dépression. On peut avoir recours à l'examen psychologique avec tests projectifs Rorschach, CAT ou autres. Les questionnaires randomisés ne sont pas souvent pas indiqués parce qu'il marquent une importance exagérée au verbal dans son sens primaire ce qui n'est pas adapté aux enfants.
Par ailleurs et contrairement à l'adulte, l'enfant déprimé ne se plaint pas de tristesse ni de désespoir, et sa symptomatologie est peu bruyante. Une conférence de consensus française de 1995 a permis d'en clarifier la symptomatologie et les principes d'interventions thérapeutiques.
Les traitements de premier recours sont la psychothérapie, notamment psychanalytique ou familiale. L'un et l'autre sont souvent utilisés de manière conjointe, que ça soit dans l'approche systémique ou psychanalytique. Le rôle du pédiatre est là déterminant, c'est lui qui le premier pourra entendre la souffrance de son jeune patient et qui pourra orienter les parents chez le spécialiste à temps. Le traitement médicamenteux doit être indiqué par le spécialiste et utilisé le plus possible de manière transitoire en attendant que l'enfant s'investisse dans sa psychothérapie et s'il y parvient. Pour les petits enfants, jusqu'à six ans, la psychothérapie "parent-enfant" ou le plus souvent "mère-enfant est d'une grande aide. Un recours à un centre spécialisé (centre de jour) ou toute autre intervention sur l'environnement peuvent se montrer parfois très efficace.
Dépression de l'adolescent
La dépression à l'adolescence se manifeste, à l'instar de celle de l'enfant, très différemment de celle des l'adulte. La puberté a apporté son lot de changement physique que l'adolescence intégrera ou pas, ou plus ou moins sur le plan psychologique. Il faut toujours être attentif aux risques de passages à l'acte suicidaire. Plus que jamais, le clinicien doit éviter de se fier aux apparences, une attitude arrogante peut par exemple cacher un profond mépris de soi et de ses capacités, notamment au niveau scolaire. Des conduites addictives de toutes sortes, des troubles des conduites alimentaires, des fugues, de la violence verbale et/ou physique, etc. peuvent être des tentatives défensives pour lutter contre la dépression ou la mélancolie.
Au niveau comportemental on énumère ainsi ainsi les troubles, conformément aux classifications DSM et CIM : un trouble de l'humeur avec sentiment d'ennui, irritabilité (concernant tout l'entourage), voire hostilité et opposition, impulsivité, agressivité. On parle parfois de dépression hostile. Le dialogue devient vite impossible, remplacé par les pleurs. On observe également une tendance à l'inhibition, une anhédonie, avec désinvestissement des loisirs et des relations qui étaient investis jusque-là; des troubles somatiques : céphalées, insomnie, hypersomnie ou clinophilie, anorexie ou au contraire augmentation de l'appétit, parfois avec des crises de boulimie ; des troubles anxieux fréquemment associés : phobie sociale, attaque de panique, trouble obsessionnel compulsif, des troubles intellectuels : incapacité à penser (l'individu voit les choses mais ne ressent aucun élément positif ou négatif, n'a aucun avis...).
Une thérapie familiale et systémique ou psychanalytique est parfois indiquée, elle permet notamment à l'adolescent de ne pas se sentir "seul en cause";.
Il est parfois difficile de faire la différence entre une dépression et un simple moment évolutif de l'adolescence, et le recours à des spécialistes est préconisé. C'est d'autant plus difficile que l'adolescent tend à banaliser sa situation, soit par honte soit par sentiment de désespoir (personne ne le comprendra), soit parce qu'il ne perçoit pas ou mal son sentiment et son vécu intérieurs.C'est la clinique menée par le psychopathologue qui permet de différencier une dépression de l'autre et de mesurer sa gravité. Les tenants des TCC préfèrent utiliser des test randomisés comme le Beck où l'on recherche alors ce qui est désigné comme une triade. Au questions suivantes, le sujet répond généralement ainsi : * « Que veux-tu faire ? » , « Rien, je ne suis bon à rien ! »; « Tu regardes un peu les informations à la télévision ? », « Non c’est nul ! »; « Tu sais ce que tu veux faire plus tard ? », « Non… ! »; « Qu'en penses-tu ? » , « Rien, je ne sais pas ». Ces trois réponses souligneraient que pour cet adolescent, tout est nul, sans valeur : lui, le monde, et surtout l'avenir.
Seul un dialogue attentif et mené avec tact par le clinicien peut permettre à l'adolescent de comprendre ce qui lui arrive et de le surmonter. Ceci peut se faire dans le cadre du cabinet de son médecin (mais il ne faut pas oublier que cet âge est difficile pour le pédiatre qui a de la peine à ne pas voir en l'adolescent qu'il a en face de lui, l'enfant qu'il connaissait mais qui a changé.) C'est donc aussi une période où il peut-être utile pour l'adolescent de changer de médecin, ceci en dehors du fait qu'une démarche psychothérapeutique soit entreprise ou non. Dans la mesure où adolescent peut y adhérer suffisamment on peut aussi indiquer une psychothérapie, psychanalytique ou pas. Parfois, dans des cas graves, une hospitalisation psychiatrique peut être nécessaire et salutaire. Malheureusement, les services adaptés aux adolescents deviennent de plus en plus rares à cause des restrictions de tous ordres ce qui prive trop souvent l'adolescent d'un traitement adéquat. Il ne faut pas non plus oublier qu'une crise d'adolescence sous tendue par une dépression peut aussi inaugurer des changements positifs et une réorganisation psychique plus intégrée. La clinique de l'adolescent oscille toujours entre le risque de dramatiser et celui de banaliser, c'est sa difficulté et sont intérêt.
Dépression de la personne âgée
Elle est fréquente, sous plusieurs formes ;
Les dépressions pseudo-démentielles, formes bien particulières, se caractérisent par des troubles graves :
-
- de la mémoire ;
- de l'orientation ;
- de la vigilance ;
- du jugement ;
- de régression affective ;
- des performances intellectuelles. On les rencontre généralement chez les sujets âgés, rarement chez des sujets jeunes.
- de la culpabilité
Dépression et maladie d'Alzheimer
La prévalence de la dépression est très élevée (20 à 25% des cas) chez les patients Alzheimer.
Une étude récente (2008) montre que pour la maladie d'Alzheimer, l'exposition à la lumière naturelle diminue les symptômes de dépression (de -19% dans l'étude), et que par ailleurs la prise de mélatonine facilite l'endormissement (8 min plus tôt) et allonge le sommeil de 27 mn en moyenne). L'association Lumière + mélatonine a aussi diminué les comportements agressifs (- 9%), les phases d'agitation et de réveils nocturnes. " Le Dr Albert Lachman (spécialiste des troubles du sommeil) estime qu'en améliorant le sommeil du malade on améliore aussi les fonctions cognitives et l'humeur. Il conseille "de bien éclairer les pièces en journée, de laisser les rideaux ouverts et, à l'inverse, de diminuer les sources de lumière en soirée pour que l'organisme reçoive le signal que la nuit est là". "Malheureusement, dans certaines maisons de repos, pour des questions d'organisation, on fait plutôt l'inverse" ajoute-t-il.
La dépression périnatale
La dépression pré et postnatale sont fréquentes et encore sous-diagnostiquées. La première passe souvent inaperçue, la mère a honte de son état et le cache souvent à son entourage - obstétricien inclus - qui a tendance à mettre les éventuels signes dépressifs sous le sceau de la fatigue de grossesse. L'autre est à différencier du simple baby blues qui survient le plus souvent après un intervalle libre de à 2 mois et réalise un tableau de dépression typique ou masquée ; c'est la plus fréquente des complications du postpartum, dans environ 15 % des accouchements.