Alfred Russel Wallace - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Théorie de l'évolution
Premières réflexions
À la différence de Darwin, Wallace débuta sa carrière de naturaliste explorateur en étant déjà convaincu par la transmutation des espèces. Le concept avait, entre autres, été défendu par Jean-Baptiste Lamarck, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, Erasmus Darwin, et Robert Grant. Il fut largement débattu, mais généralement désapprouvé par les naturalistes les plus influents, et l’on considérait qu'il avait des connotations radicales, voire révolutionnaires. Des anatomistes et géologues distingués tels que Georges Cuvier, Richard Owen, Adam Sedgwick et Charles Lyell l'attaquèrent violemment. On a suggéré l'idée que Wallace adhéra à l'idée de transmutation des espèces en partie car il était toujours enclin à favoriser les idées radicales en politique, en religion et en science et parce qu'il était exceptionnellement ouvert à ce qui était marginal, voire très marginal dans la science.
Il fut aussi profondément influencé par les travaux de Robert Chambers dans Vestiges of the Natural History of Creation, un ouvrage de vulgarisation très controversé publié anonymement en 1844 dans lequel il défendait l'idée d'une origine évolutionniste pour le système solaire, la terre et les êtres vivants. En 1845, Wallace écrivit à Henry Bates :
« J'ai une meilleure opinion des Vestiges que vous ne semblez en avoir. Je ne les considère pas comme une généralisation hâtive, mais plutôt comme une hypothèse ingénieuse fortement soutenue par quelques faits et analogies saisissants, mais qui reste à prouver par plus de faits et la lumière additionnelle que de plus amples recherches peuvent jeter sur le problème. Il fournit un sujet auquel chaque étudiant de la nature peut se consacrer ; chaque fait qu'il observe sera validé ou pas, et cela sert ainsi à la fois d'incitation à la collection des faits, et d'objet auquel ils peuvent être appliqués une fois collectés. »
Wallace planifia délibérément certains de ses travaux sur le terrain pour tester l'hypothèse que selon un scénario évolutionniste des espèces étroitement liées devaient habiter des territoires voisins. Pendant qu'il travaillait dans le bassin amazonien, il se rendit compte que les barrières géographiques – telles que l'Amazone et ses principaux affluents – séparaient souvent des variétés d'espèces très proches les unes des autres, et inclut ces observations dans son article « On the Monkeys of the Amazon » en 1853. Vers la fin de l'article, il pose la question suivante : « Les espèces étroitement liées ont-elles jamais été séparées par un large intervalle de terre ? »
En février 1855, alors qu'il travaillait dans le Sarawak sur l'île de Bornéo, Wallace écrivit « Sur la loi qui a régulé l'introduction des espèces », un article qui fut publié dans Annals and Magazine of Natural History en septembre de la même année. Il y rassemble et énumère des observations générales sur la distribution géographique et géologique des espèces (biogéographie). Sa conclusion que « chaque espèce est apparue tant dans l'espace que dans le temps avec une espèce apparentée proche » allait être connue sous le nom de « loi Sarawak ». Wallace répondait ainsi à la question qu'il posait dans son article sur les singes du bassin fluvial de l’Amazone. Bien que cette publication ne fasse pas mention de possibles mécanismes d'évolution, elle préfigurait l'important article qu'il écrirait trois ans plus tard.
L'article bouleversa les croyances de Charles Lyell que les espèces étaient immuables. Bien que son ami Charles Darwin lui ait écrit en 1842 en exprimant son soutien à la théorie de la transmutation, Lyell avait continué à s'opposer fermement à cette idée. Début 1856, il parla de l'article de Wallace à Darwin, comme le fit Edward Blyth. Darwin assimila la conclusion de Wallace à du créationnisme progressif et écrivit que ce n’était « pas très nouveau... il emploie ma comparaison d'arbre [mais] cela ne semble être que de la création pour lui ». Lyell fut plus impressionné ; dans un carnet traitant des espèces, il s'attaqua aux conséquences, particulièrement pour l'ascendance humaine. Darwin exposa alors pour la première fois les détails complets de la sélection naturelle à Lyell, et bien que celui-ci ne put être d'accord, il pressa Darwin de publier sa théorie pour établir la priorité. Darwin s'y opposa dans un premier temps, puis entama l'écriture d'une ébauche sur son travail sur les espèces en mai 1856.
Sélection naturelle et Darwin
Wallace avait été convaincu, dès février 1858, par ses recherches biogéographiques dans l'archipel Malais de la réalité de l’évolution. Il écrira plus tard dans son autobiographie :
« Le problème était alors non seulement de savoir comment et pourquoi les espèces changeaient, mais comment et pourquoi elles évoluaient vers de nouvelles espèces bien définies, différenciées les unes des autres de tant de façons ; pourquoi et comment elles devenaient si précisément adaptées à des modes de vie distincts ; et pourquoi tous les niveaux intermédiaires disparaissaient (comme la géologie le montre) et laissaient seulement des espèces, genres et autres groupes d'animaux clairement définis et manifestes? »
Si l'on en croit son autobiographie, c'est lorsqu'il était alité et fiévreux que Wallace réfléchit à l'idée de Thomas Malthus de contrôle positif de la croissance démographique humaine et en vint à émettre l'idée de sélection naturelle. Il dit s'être trouvé sur l'île de Ternate à l'époque, mais les historiens émettent quelques doutes : ils déclarent en effet que si l'on se base sur l'enregistrement de ses collections qu'il avait alors annoté, il devait plus probablement se trouver sur l'île de Gilolo. Wallace le décrit comme suit :
« Il m'est ensuite venu à l'esprit que ces causes ou leurs équivalents jouent aussi continuellement dans le cas des animaux ; et comme les animaux se reproduisent beaucoup plus vite que les humains, la destruction chaque année de la part de ces causes doit être énorme pour conserver un nombre restreint d'espèces, puisqu’à l'évidence elles n'augmentent pas régulièrement année après année, car autrement il y a longtemps que le monde aurait été peuplé par ceux qui se reproduisent le plus vite. Réfléchissant vaguement à l'énorme et constante destruction que cela impliquait, j'en suis venu à me demander pourquoi certains meurent et d'autres vivent ? Et la réponse était clairement, dans l'ensemble les mieux adaptés vivent... et considérant le nombre de variations individuelles dont mon expérience de collectionneur m'avait montré l'existence, il s'en suivait donc que tous les changements nécessaires à l'adaptation d'une espèce aux conditions changeantes seraient provoqués... De cette manière chaque partie d'une organisation animale pouvait être modifiée exactement comme exigé, et dans le processus même de cette modification le non-modifié s'éteindrait, et ainsi les caractères définis et le net isolement de chaque nouvelle espèce seraient expliqués. »
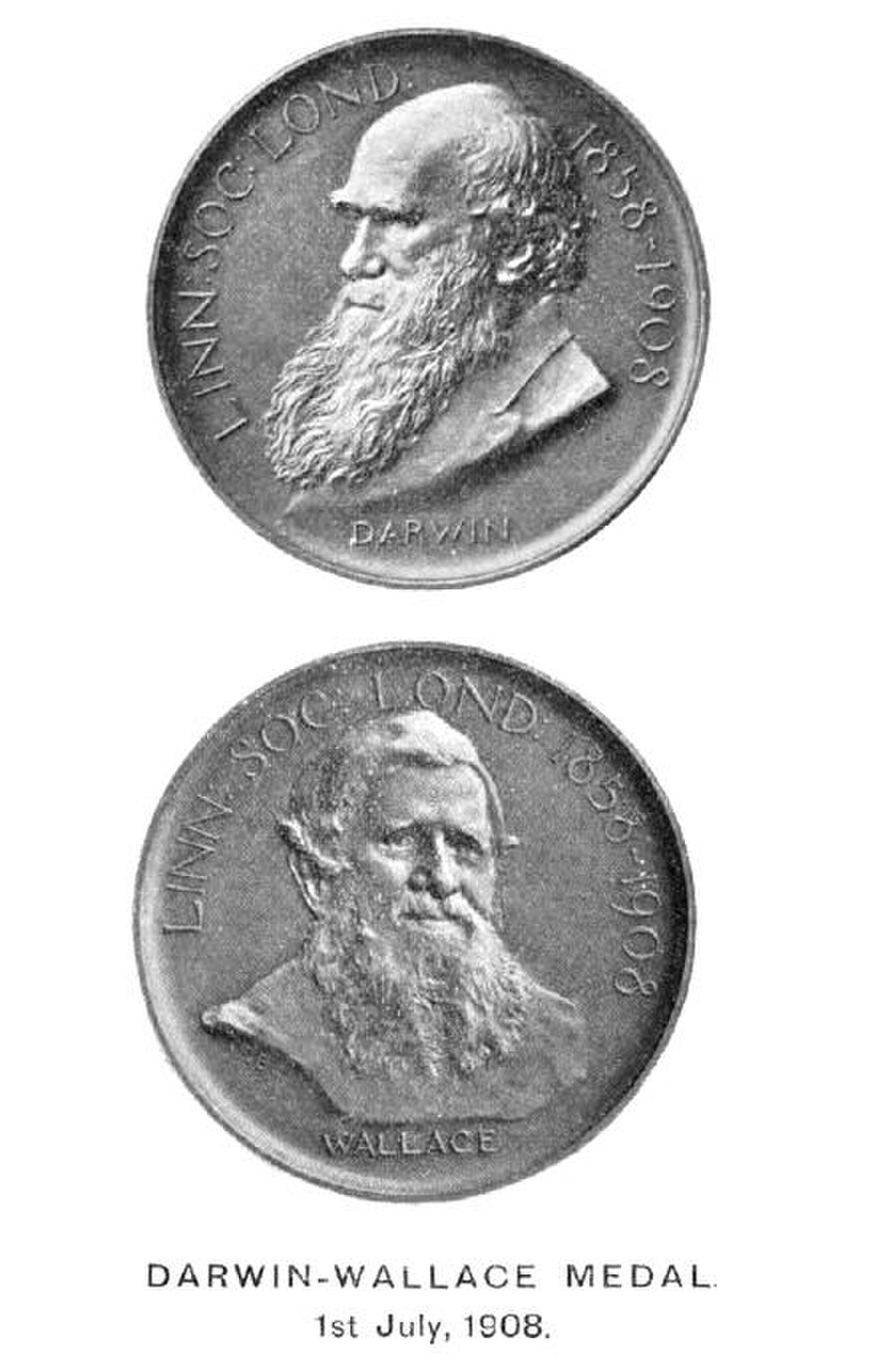
Wallace, qui avait déjà brièvement rencontré Darwin, était l'un des correspondants dont il utilisait les observations pour construire sa propre théorie. Bien que les premières lettres échangées entre les deux hommes aient été perdues, Wallace conserva celles qu'il reçut. Dans la première, datée du 1er mai 1857, Darwin nota que la lettre de Wallace du 10 octobre qu'il venait de recevoir ainsi que son article de 1855 « On the Law that has regulated the Introduction of New Species » montraient qu'ils pensaient tous deux de la même façon et arrivaient dans une certaine mesure à des conclusions similaires, ajoutant qu'il se préparait à publier ses travaux d'ici environ deux ans. Dans la seconde lettre, datée du 22 décembre 1857, il se montre heureux que Wallace théorise sur la distribution, ajoutant que « sans spéculation il n’y a pas d'observation bonne et originale » tout en commentant « je crois que je vais beaucoup plus loin que vous ». Wallace fit confiance à Darwin sur ce point et lui fit parvenir son essai de février 1858 « On the Tendency of Species to form Varieties » en lui demandant de le lire et de le transmettre à Lyell s'il pensait que cela avait de la valeur. Darwin reçut le manuscrit le 18 juin 1858. Quoique l'essai de Wallace n'employât pas l'expression de Darwin « sélection naturelle », il décrivait les mécanismes d'une divergence évolutionniste d'espèces par rapport à d'autres semblables suite à des pressions environnementales. Dans ce sens, c'était très similaire à la théorie sur laquelle Darwin travaillait depuis vingt ans mais qu'il lui restait encore à publier. Darwin envoya le manuscrit à Lyell accompagné d’une lettre dans laquelle il disait « il n'aurait pas pu faire de meilleur résumé ! (...) il ne dit pas qu'il souhaiterait que je le publie, mais je vais, bien sûr, de ce pas écrire et l'envoyer à n'importe quel journal. » Désemparé par la maladie de son fils, il se déchargea du problème sur Charles Lyell et Joseph Hooker qui décidèrent de publier l'essai dans une présentation commune incluant des écrits inédits de Darwin qui mettaient en avant sa priorité. L'essai de Wallace fut présenté à la Société linnéenne de Londres le 1er juillet 1858, en même temps que des extraits d'un essai que Darwin avait montré en privé à Hooker en 1847 et une lettre qu'il avait écrite à Asa Gray en 1857.
Wallace accepta ces dispositions après les faits, reconnaissant d'avoir été inclus à cette présentation malgré tout. Le statut social et scientifique de Darwin était à l'époque bien plus important que celui de Wallace, et sans cette association il est fort probable que les idées de Wallace sur l'évolution n'auraient pas été prises aussi au sérieux. L'arrangement de Lyell et de Hooker reléguèrent Wallace à la position de co-découvreur. Cependant, la lecture en commun de leurs articles sur la sélection naturelle lia le nom de Wallace à celui de l'éminent Darwin. Ceci, combiné au plaidoyer de Darwin en sa faveur (ainsi que de celle de Hooker et Lyell) permit à Wallace d'accéder plus facilement qu'auparavant aux plus hauts niveaux de la science britannique. La réaction à la lecture fut modérée, le président de la Société linnéenne disant en mai 1859 que cette année-ci n'avait pas été marquée par d'impressionnantes découvertes, mais grâce à la publication de L'Origine des espèces de Darwin plus tard en 1859, son importance devint évidente. Quand Wallace retourna en Angleterre, il rencontra Darwin et les deux hommes restèrent amis par la suite.
Wallace devint l'un des plus ardents défenseurs de L'Origine des espèces. Lors d'un incident en 1863 qui fit particulièrement plaisir à Darwin, Wallace publia un court article intitulé « remarques sur l'article du Rév. S. Haughton sur les cellules d'abeilles, et sur L'Origine des espèces » afin de complètement anéantir l'article d'un professeur de géologie à l'université de Dublin qui avait sévèrement critiqué les commentaires de Darwin dans L'Origine sur la manière dont les abeilles à miel pouvaient avoir évolué grâce à la sélection naturelle. Autre notable défense de L’Origine : « La création par la loi », publié en 1867 dans le Quaterly Journal of Science, où Wallace critique The Reign of Law, un livre écrit par le duc d'Argyle dans lequel il réfutait la théorie de la sélection naturelle. Après une réunion de la British Association en 1870, Wallace écrivit à Darwin se plaignant qu'il n'y avait « plus aucun adversaire qui sache quoi que ce soit sur l'histoire naturelle, de sorte qu'il n'y a aucune bonne discussion comme nous avions l'habitude d'en avoir. »
Différences entre les idées de Darwin et de Wallace
Les historiens de la science ont noté que bien que Darwin considérât que les idées que contenait l'article de Wallace étaient essentiellement les mêmes que les siennes, il y avait pourtant des différences. Darwin insistait sur la compétition entre individus de la même espèce pour survivre et se reproduire, là où Wallace mettait l'accent sur la pression écologique contraignant les variétés et les espèces à s'adapter à leur environnement ou à s'éteindre. On a suggéré que l'insistance de Wallace sur l'importance de l'adaptation à l'environnement pour la survie et l'insistance de Darwin sur la compétition entre individus de la même espèce était à l’origine de leur désaccord sur l'importance de la sélection sexuelle.
D'autres ont remarqué une autre différence : Wallace semble avoir considéré la sélection naturelle comme une sorte de mécanisme de rétroaction maintenant les espèces et variétés adaptées à leur environnement. Ils indiquent un passage en grande partie oublié du célèbre article de Wallace :
« L'action de ce principe est exactement comme celle du régulateur centrifuge d'un moteur à vapeur, qui vérifie et corrige toutes les irrégularités presque avant qu'elles ne soient visibles ; et de manière semblable aucune insuffisance déséquilibrée dans le règne animal ne peut jamais atteindre d'ampleur manifeste, car elle se ferait sentir à la toute première étape, en rendant l'existence difficile et l'extinction à venir presque sûre. »
Le cybernéticien et anthropologue Gregory Bateson observa dans les années 1970 que même en considérant ceci comme une métaphore, Wallace avait « probablement dit la chose la plus puissante du XIXe siècle. » Bateson, en 1979, a réétudié le sujet dans son livre La nature et la pensée, et d'autres spécialistes ont continué à explorer le lien entre la sélection naturelle et la théorie des systèmes.
Coloration d'avertissement et sélection sexuelle
En 1867, Darwin écrivit à Wallace à propos d’un problème qu'il avait pour comprendre comment certaines chenilles pouvaient avoir développé des combinaisons de couleurs ostensibles. Il en était venu à penser que la sélection sexuelle, une idée à laquelle Wallace n'accordait pas la même importance que Darwin, expliquait ces combinaisons de couleurs. Il réalisa cependant que cela ne pouvait s'appliquer aux chenilles. Wallace répondit que lui et Bates avaient observé que les papillons les plus spectaculaires avaient une odeur et un goût particuliers, et que John Jenner Weir lui avait dit que les oiseaux ne mangeraient pas un certain type de mite blanche commune car ils les trouvaient immangeables. Wallace répondit à Darwin que « comme la mite blanche est aussi remarquable au crépuscule qu'un papillon en plein jour » il semblait probable que la combinaison de couleurs voyantes servait d'avertissement pour les prédateurs et pouvait ainsi s'être développée à travers la sélection naturelle. Darwin fut impressionné par cette idée. Lors d'une réunion à la Société entomologique, Wallace demanda si quelqu'un avait la moindre preuve à apporter sur le sujet. En 1869, Weir publia des données, tirées d'expériences et d'observations impliquant des chenilles aux couleurs vives, qui allaient dans le sens de la théorie de Wallace. La coloration d'avertissement fut l'une des contributions de Wallace dans le domaine de l'évolution de la coloration animale en général et dans celui de la coloration protectrice en particulier. C'était aussi un élément du désaccord de longue date qui opposait Wallace et Darwin sur l'importance de la sélection sexuelle. Dans son livre publié en 1878, Tropical Nature and Other Essays, il développe le thème de la coloration chez les animaux et les plantes et propose des explications alternatives à un nombre de cas que Darwin attribuait à la sélection sexuelle. Il développera à nouveau longuement le thème en 1889 dans son livre Darwinism.
Effet Wallace
Dans Darwinism, livre expliquant et défendant l'idée de sélection naturelle, il émit l'hypothèse que la sélection naturelle pouvait entraîner l'isolement reproducteur de deux variétés en encourageant le développement de barrières contre l'hybridation, contribuant ainsi au développement de nouvelles espèces. Il suggéra le scénario suivant : quand deux populations d'une même espèce avaient divergé au-delà d'un certain point, chacune adaptée à des conditions particulières, la progéniture hybride serait moins bien adaptée que l'une ou l'autre forme parentale, et à ce point la sélection naturelle tendrait à éliminer les hybrides. En outre, dans de telles conditions, la sélection naturelle favoriserait le développement de barrières à l'hybridation, comme des individus qui ont évité des accouplements hybrides tendraient à avoir une progéniture plus adaptée, contribuant de ce fait à l'isolation reproductrice de deux espèces naissantes. Cette théorie est connue sous le nom d'effet Wallace. Wallace, dans une lettre, avait suggéré à Darwin dès 1868 que la sélection naturelle pouvait avoir un rôle dans la prévention à l'hybridation mais sans plus de précisions. Cela continue aujourd’hui d'être un sujet d'études de la biologie évolutionniste tant grâce à la simulation sur ordinateur qu'à l'aide de résultats empiriques pour en prouver le bien-fondé.
Application de la théorie à l'homme et rôle de la téléologie dans l'évolution
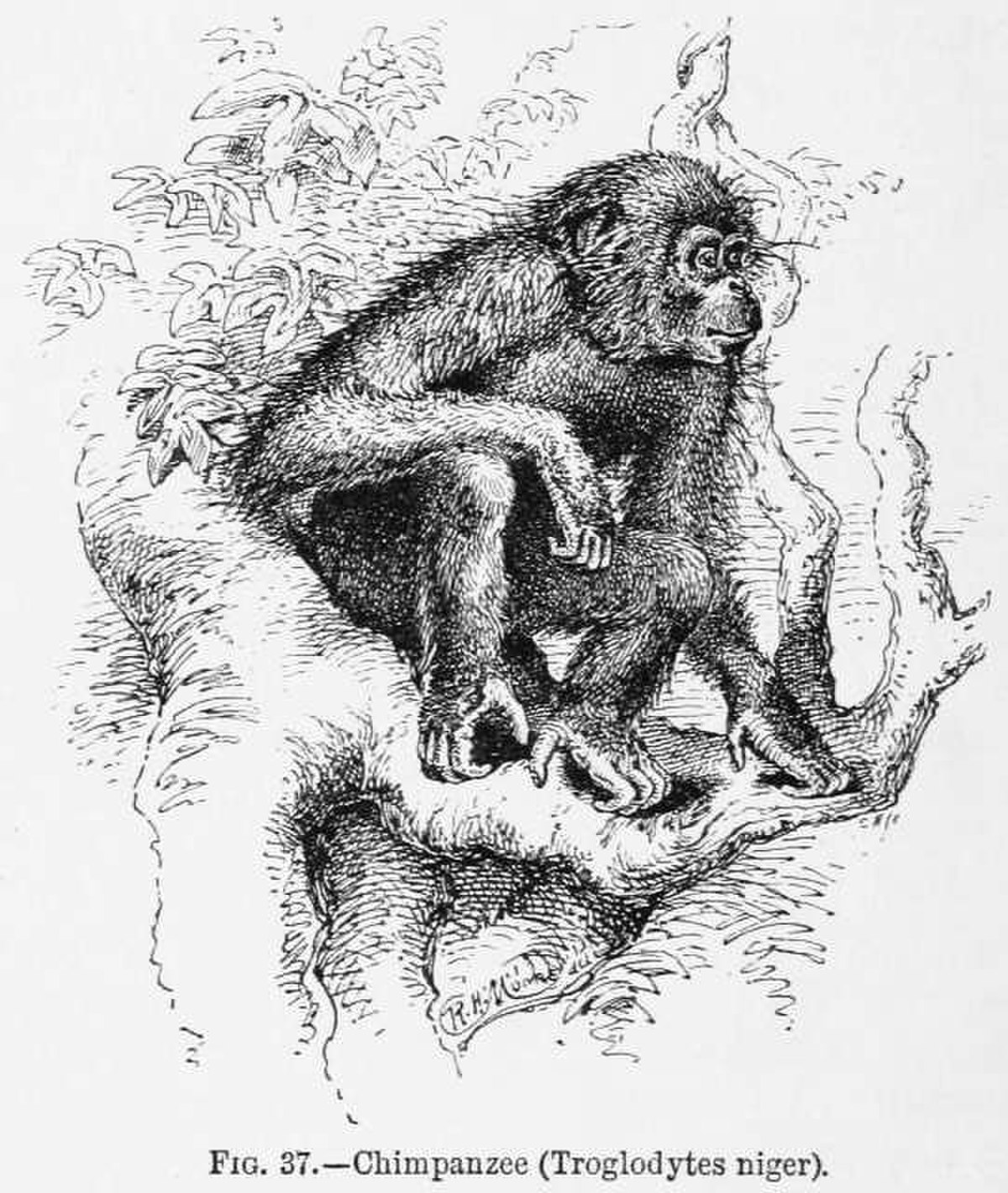
Wallace publia en 1864 un article intitulé « The Origin of Human Races and the Antiquity of Man Deduced from the Theory of Natural Selection » dans lequel il appliquait la théorie au genre humain. Darwin n'avait pas encore publiquement abordé le sujet, alors que Thomas Huxley l'avait déjà fait dans De la place de l'Homme dans la nature.
Peu de temps après, Wallace s'intéressa au spiritisme. Vers la même époque, il commença aussi à affirmer que la sélection naturelle ne pouvait expliquer le génie mathématique, artistique ou musical, ni les méditations métaphysiques, l'esprit ou l'humour. Il a par la suite dit que quelque chose dans « l'univers invisible de l'Esprit » était intervenu au moins trois fois dans l'Histoire : la création de la vie à partir de matière inorganique, l'introduction de la conscience chez les animaux les plus évolués et la génération de facultés mentales supérieures chez l'être humain. Il croyait également que la raison d'être de l'univers était le développement de l'esprit humain. Ces idées perturbèrent beaucoup Darwin : il riposta que les attraits spirituels n'étaient pas nécessaires et que la sélection sexuelle pouvait facilement expliquer des phénomènes mentaux en apparence non-adaptatifs. Tandis que certains historiens ont conclu que la croyance de Wallace que la sélection naturelle était insuffisante à expliquer le développement de la conscience et de l'esprit humain était la cause directe de son adoption du spiritisme, d'autres spécialistes de Wallace désapprouvèrent cette interprétation, certains maintenant que Wallace n'a jamais cru que la sélection naturelle s'appliquait à ces domaines. Les réactions aux idées de Wallace sur le sujet parmi les principaux naturalistes furent multiples. Charles Lyell adopta les idées de Wallace sur l'évolution humaine plutôt que celles de Darwin mais beaucoup, dont Huxley, Hooker et Darwin lui-même, se montrèrent critiques vis-à-vis de Wallace. Comme un historien des sciences l'a fait remarquer, les idées de Wallace dans ce domaine étaient en désaccord avec deux principes majeurs de la philosophie darwinienne émergente selon lesquels l'évolution n'est ni téléologique ni anthropocentrique.
Rôle de Wallace dans l'histoire de la théorie évolutionniste
Wallace est seulement mentionné dans beaucoup de comptes rendus sur l'histoire de l'évolution comme celui qui a simplement été le « stimulus » à la publication de la théorie de Darwin. En réalité, Wallace a développé ses propres théories évolutionnistes, lesquelles différaient de celles de Darwin, et il était considéré par beaucoup à l'époque (particulièrement Darwin) comme étant un penseur important sur l'évolution dont les idées ne pouvaient être ignorées. Un historien des sciences a indiqué que tant à travers leur correspondance privée que leurs publications, Darwin et Wallace ont échangé des connaissances et ont pendant très longtemps stimulé les idées et théories de chacun. Wallace est le naturaliste le plus cité dans le livre de Darwin, La filiation de l'homme, et souvent de manière critique. Il resta cependant un ardent défenseur de la sélection naturelle tout au long de sa vie. Dans les années 1880, l'évolution était une idée largement acceptée dans les cercles scientifiques, mais Wallace et August Weismann étaient quasiment les seuls parmi les biologistes d'importance à croire que la sélection naturelle en était l'élément moteur majeur. En 1889, Wallace publia Darwinism dans lequel il répondit aux critiques scientifiques sur la sélection naturelle. De tous ses livres, c'est celui qui est le plus souvent mentionné dans les publications spécialisées.

















































