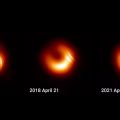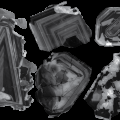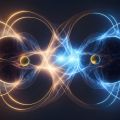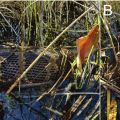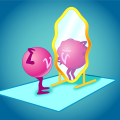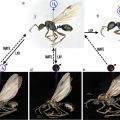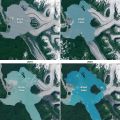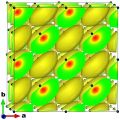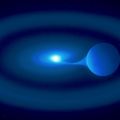Histoire de l'électricité au Québec - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Les années 1960 et 1970
Projet Manic-Outardes
Ce tournant marque également celui du développement tous azimuts de l'entreprise publique, qui fait face à une forte augmentation de la demande, de l'ordre de 7 % par année. Les nouvelles centrales sur la Bersimis et la construction de la troisième phase de Beauharnois ne suffiront pas à maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande. Hydro-Québec se voit donc obligée de multiplier les projets de construction durant les années 1960.
À l'été 1960, le nouveau gouvernement de Jean Lesage alloue à Hydro-Québec toutes les concessions hydrauliques non concédées dans l'ensemble du Québec. L'entreprise annonce du même coup son projet Manic-Outardes, le plus ambitieux projet hydroélectrique de l'histoire au Canada, avec une puissance estimée de 4 500 MW. La construction de la route reliant Baie-Comeau et le site du barrage de Manic-5 précède l'annonce officielle et deux chantiers sont actifs à la fin de 1961 ; ceux de Manic-2, près de Baie-Comeau, et à Manic-5.
Transport à haute tension
En 1958-1959, en plein cœur de la planification du complexe hydroélectrique de la Manicouagan, un ingénieur d'Hydro-Québec, Jean-Jacques Archambault, démontre qu'il est théoriquement possible de transporter l'électricité du complexe Manicouagan jusqu'à Montréal par des lignes à une tension beaucoup plus élevée.
Il convainc ses collègues et la direction de la société qu'il est possible de réduire le nombre de lignes à haute tension nécessaires pour acheminer des milliers de mégawatts de ces nouvelles centrales en construisant un réseau de lignes à 735 kV. Ce projet inédit, qui a monopolisé les efforts d'Hydro-Québec et de quelques-uns des plus grands fournisseurs de matériel à haute tension (ASEA, GE et Cégélec), a été mis en opération le 29 novembre 1965 à 13 h 43, lorsque le premier ministre Jean Lesage actionne une manette au poste de Lévis.
Cette percée technologique donnera les moyens à Hydro-Québec d'acheminer l'électricité qu'elle produira dans le Nord québécois vers ses centres de consommation principaux, dans la vallée du Saint-Laurent. Pendant ce temps, des milliers d'ouvriers sont à l'œuvre afin de construire les sept premières centrales du complexe Manic-Outardes, dont le colossal barrage Daniel-Johnson est l'emblème. Large de 1 314 mètres, l'ouvrage en voûte et contreforts est le plus imposant du genre au monde. La construction du barrage a nécessité environ 3 millions m3 de béton. La construction du complexe se terminera en 1978 avec la mise en service de la centrale Outardes-2.
Le projet Churchill Falls
Parallèlement à ce développement, Hydro-Québec négocie la construction d'une centrale hydroélectrique aux chutes Churchill, au Labrador, avec la British Newfoundland Corporation Limited (Brinco), un consortium de banques et d'industriels. Hydro-Québec a acquis une participation minoritaire dans ce projet lors de la nationalisation de la Shawinigan Water & Power et de ses filiales.
Des négociations débutent dès 1963 entre la Brinco et la société publique québécoise afin d'établir un contrat d'approvisionnement à long terme pour l'électricité qui sera produite par la future centrale. Le distributeur Consolidated Edison à New York et un groupe de compagnies de la Nouvelle-Angleterre sont impliqués dans les discussions. Les Américains se retirent en 1966, estimant qu'il serait moins coûteux de construire des centrales nucléaires dont le coût de production s'établirait à 4,43 mills le kilowatt-heure.
Le premier ministre du Québec, Daniel Johnson, accepte la signature d'une entente de principe, le 6 octobre 1966. Une entente définitive pour l'achat de la quasi-totalité de la production est entérinée le 12 mai 1969. Le contrat accorde à Hydro-Québec une participation de 34,2 % dans l'entreprise propriétaire de l'ouvrage, la Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited (CFLCo.).
La centrale de Churchill Falls, d'une puissance installée de 5 428 MW, effectue ses premières livraisons à Hydro-Québec le 6 décembre 1971 et la mise en service sera complétée en septembre 1974.
Smallwood est remplacé en 1972 par le gouvernement conservateur de Frank Moores qui s'emploie à reprendre le contrôle du développement hydroélectrique du Labrador. Au lendemain du premier choc pétrolier, en juin 1974, le gouvernement de Terre-Neuve menace d'exproprier Brinco et rachète tous les titres du consortium britannique dans le projet des chutes Churchill pour 160 millions de dollars.
Les représentants de Newfoundland and Labrador Hydro insistent auprès de Roland Giroux pour renégocier le contrat de vente d'électricité. Les négociations ne donnent aucun résultat et le gouvernement terre-neuvien abroge la concession de droits hydrauliques par une loi, le Upper Churchill Water Rights Reversion Act. S'amorce alors une bataille judiciaire qui se terminera à deux reprises devant la Cour suprême du Canada. La cour tranche en faveur d'Hydro-Québec les deux fois, en 1984 et en 1988.
L'option nucléaire

Hydro-Québec a aussi brièvement considéré la filière nucléaire afin de répondre aux besoins énergétiques du Québec. La société a été impliquée dans la construction de deux centrales nucléaires, Gentilly-1 et Gentilly-2, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, en face de Trois-Rivières. La première, un réacteur CANDU-BLW construit par Énergie atomique du Canada Limitée (EACL) et d'une puissance nette de 266 MW, a été mise en service en novembre 1970. Sauf pour deux brèves périodes en 1972, la centrale n'a produit de l'électricité que pendant 183 jours. Elle a été mise en état de conservation par EACL en 1980, qui en demeure propriétaire.
La seconde, une centrale de type CANDU-PHW de 675 MW, a été mise en service commercial en 1983, après une période de construction échelonnée sur 10 ans.
Après plusieurs années d'études, le gouvernement du Québec a annoncé, le 19 août 2008, la réfection de la centrale de Gentilly-2 en 2011 et 2012 au coût de 1,9 milliard CAD, ce qui prolongera sa vie utile jusqu'en 2035. Hydro-Québec mise sur l'expérience acquise pendant la réfection d'une centrale presque identique, propriété d'Énergie Nouveau-Brunswick à Point Lepreau. La réfection de cette centrale devrait être complétée à l'automne 2009.
Le projet du siècle
Un an après son élection en 1970, le nouveau premier ministre Robert Bourassa lance le projet qui lui permettra d'atteindre son objectif de création de 100 000 nouveaux emplois. Le 30 avril 1971, il annonce, devant les membres du Parti libéral du Québec, qu'il demandera à Hydro-Québec de construire un complexe hydroélectrique dans la Jamésie, région de la Baie James.
Sans aucune forme d'évaluation environnementale, un concept inconnu à cette époque, les travaux de construction d'une route de 600 km, la route de la Baie James, s'amorcent dès 1971. Les travaux coûteront 400 millions CAD et nécessiteront trois ans de travail.
Pendant ce temps, les équipes d'Hydro-Québec préparent trois options pour le premier ministre : un projet pour les rivières Nottaway, Broadback et Rupert (projet NBR), un projet pour La Grande Rivière (projet de la Baie-James) et un projet pour la Grande rivière de la Baleine (projet de la Grande-Baleine). Après évaluation des options disponibles, le projet de la Baie-James est choisi et la construction de trois centrales sur la Grande Rivière, LG-2, LG-3 et LG-4, est fixée dès l'année suivante.
En plus des difficultés techniques et logistiques que posent un tel projet dans une région sauvage et éloignée, le président de la Société d'énergie de la Baie James, Robert A. Boyd, doit faire face à l'opposition des 5 000 résidents cris du territoire qui craignent les conséquences qu'auront le projet sur leur mode de vie traditionnel. Ils obtiennent l'appui du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, Jean Chrétien, qui finance leur recours devant les tribunaux. En novembre 1973, ils obtiennent une injonction du juge Albert Malouf, de la Cour supérieure du Québec, qui arrête les travaux. L'injonction sera levée par la Cour suprême du Canada, mais le gouvernement Bourassa n'aura pas le choix. Il devra négocier avec les autochtones.
Après plus d'un an de négociations, les gouvernements du Québec et du Canada, la Société d'énergie de la Baie-James et le Grand Conseil des Cris signent la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, le 11 novembre 1975. L'entente en 11 points accorde une compensation financière aux communautés cries touchées, leur concède la gestion des services de santé et d'éducation en échange de la poursuite des travaux.
Entretemps, le climat de travail sur le chantier de construction se dégrade et la tension entre les recruteurs syndicaux de la Fédération des travailleurs du Québec et de la Confédération des syndicats nationaux dégénère. Le 21 mars 1974, des travailleurs saccagent le campement de la centrale LG-2, causant des dommages estimés à 31 millions CAD. Les ouvriers sont évacués vers le sud et le gouvernement nomme une commission d'enquête, formée du juge Robert Cliche, de Brian Mulroney et de Guy Chevrette, sur la liberté syndicale dans l'industrie de la construction.
Deux mois après le « saccage de la Baie-James », les travaux reprennent sur le chantier. À la pointe des travaux, plus de 18 000 travailleurs œuvrent sur les chantiers de la Baie-James. La centrale sera inaugurée par le premier ministre René Lévesque en 27 octobre 1979. Avec 16 groupes-turbines d'une capacité totale de 5 616 MW, LG-2, qui sera complétée en 1981, deviendra la plus puissante centrale souterraine au monde. La centrale, le barrage et le réservoir LG-2 seront renommés en l'honneur de Robert Bourassa, après l'adoption unanime d'une motion en ce sens à l'Assemblée nationale du Québec, le 15 octobre 1996, deux semaines après le décès de l'ancien premier ministre.
La construction de la première phase du projet est complétée par la mise en service de LG-3 en juin 1982 et de LG-4 au début de 1984. Une seconde phase du projet, comprenant l'aménagement de quatre centrales supplémentaires, sera construite entre 1987 et 1996.
La conquête du marché américain
Les deux phases de la nationalisation de l'électricité — en 1944 et en 1962-1963 — ont accéléré le développement hydroélectrique de la Côte-Nord afin de desservir la croissance de la demande intérieure. La Loi Taschereau est remplacée en 1964 par une nouvelle législation, la Loi sur l'exportation de l'électricité (L.R.Q., chapitre E-23) qui comme la précédente, prévoyait que tout contrat de concession de force hydraulique appartenant au Québec devait prévoir une clause interdisait les exportations d'électricité, réservant toutefois le droit au gouvernement de permettre certaines exceptions, une disposition semblable à ce qu'avait adopté le gouvernement fédéral en mettant sur pied l'Office national de l'énergie.
Le développement d'un commerce international de l'électricité entre le Québec et les États-Unis ne démarrera vraiment qu'après la suite du choc pétrolier de 1973. Mis à part l'interconnexion avec Alcoa, le réseau électrique d'Hydro-Québec était mal préparé pour transporter l'électricité vers les marchés extérieurs. Mais avec le développement du Projet de la Baie-James et l'intention déclarée du premier ministre Bourassa de financer la construction du complexe La Grande grâce aux exportations, la construction d'infrastructures de transport se révélaient être une nécessité absolue. La première ligne de transport destinée à l'exportation, une ligne à 765 kV entre Châteauguay et Marcy, près d'Utica, permet à l'entreprise publique québécoise de transiger directement avec son voisin du sud, en synchronisant une partie de la centrale de Beauharnois au réseau de la Power Authority of the State of New York (NYPA).
La ligne sera mise en service en 1978, malgré les protestations de l'Ontario et de Terre-Neuve et les livraisons de 800 mégawatts, dans le cadre du contrat de 20 ans pourront commencer. Le prix de vente est fixé à 0,8218 cent le kilowatt-heure. L'année suivante, le ministère de l'Énergie du Québec publie un livre blanc dans lequel le gouvernement plaide qu'« un réseau hydraulique de la dimension de celui d'Hydro-Québec (24 217 mégawatts à l'époque) génère inévitablement de l'énergie excédentaire ». La mise en service des puissantes centrales de la phase 1 du complexe La Grande dans les cinq ans qui suivent le début des livraisons à l'État de New York arrive au moment où le taux croissance de la demande en électricité commence à s'infléchir en raison de la récession consécutive au deuxième choc pétrolier du début des années 1980.