Sigmund Freud - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Les conceptions de Freud
La question de l'homosexualité
Freud renonce progressivement à faire de l'homosexualité une disposition biologique ou culturelle, mais en fait plutôt un choix psychique inconscient. En 1905, dans Trois essais sur la théorie sexuelle, il parle d'« inversion », mais en 1910 avec Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, il renonce à ce terme pour choisir celui d'« homosexualité ». Dans une célèbre lettre datant de 1919, Freud est encore plus explicite : « l'homosexualité n'est ni une maladie, ni une déviance, ni une perversion » explique-t-il. Cependant des contradictions existent dans l'ensemble de l'œuvre freudienne et l'homosexualité adulte y est présentée tantôt comme immature par blocage de la libido au stade anal, tantôt comme repli narcissique ou encore comme identification à la mère. Freud a pu également affirmer que l'homosexualité résulte d'un « arrêt du développement sexuel ». Elle ne nécessite cependant ni cure, ni traitement pour les homosexuels conscients de leur spécificité. Elle est toutefois intriquée avec la névrose du sujet. Les homosexuels qui, au contraire, culpabilisent peuvent être guéris de la souffrance qu'ils ressentent en général, au même titre que les hétérosexuels. Enfin, dans une note de 1915 aux Trois essais sur la théorie sexuelle il explique également que « la recherche psychanalytique s’oppose avec la plus grande détermination à la tentative de séparer les homosexuels des autres êtres humains en tant que groupe particularisé. […] elle apprend que tous les êtres humains sont capables d’un choix d’objet homosexuel et qu’ils ont effectivement fait ce choix dans l’inconscient ». « Ni Sigmund Freud, ni ses disciples, ni ses héritiers ne firent de l'homosexualité un concept ou une notion propre à la psychanalyse ». La question de l'homosexualité a divisé les psychanalystes.Elle a même pu devenir tabou au sein de certaines institutions psychanalytiques. Selon le critique Didier Eribon, la raison est que les psychanalystes partagent un « inconscient homophobe » ; pour Daniel Borrillo, Freud et certains psychanalystes feraient œuvre d'homophobie en classant l'homosexualité parmi les "inversions"; ils oublient que Freud avait utilisé l'expression de "variante de l'organisation génitale de la libido" pour la caractériser.
Culture et nature
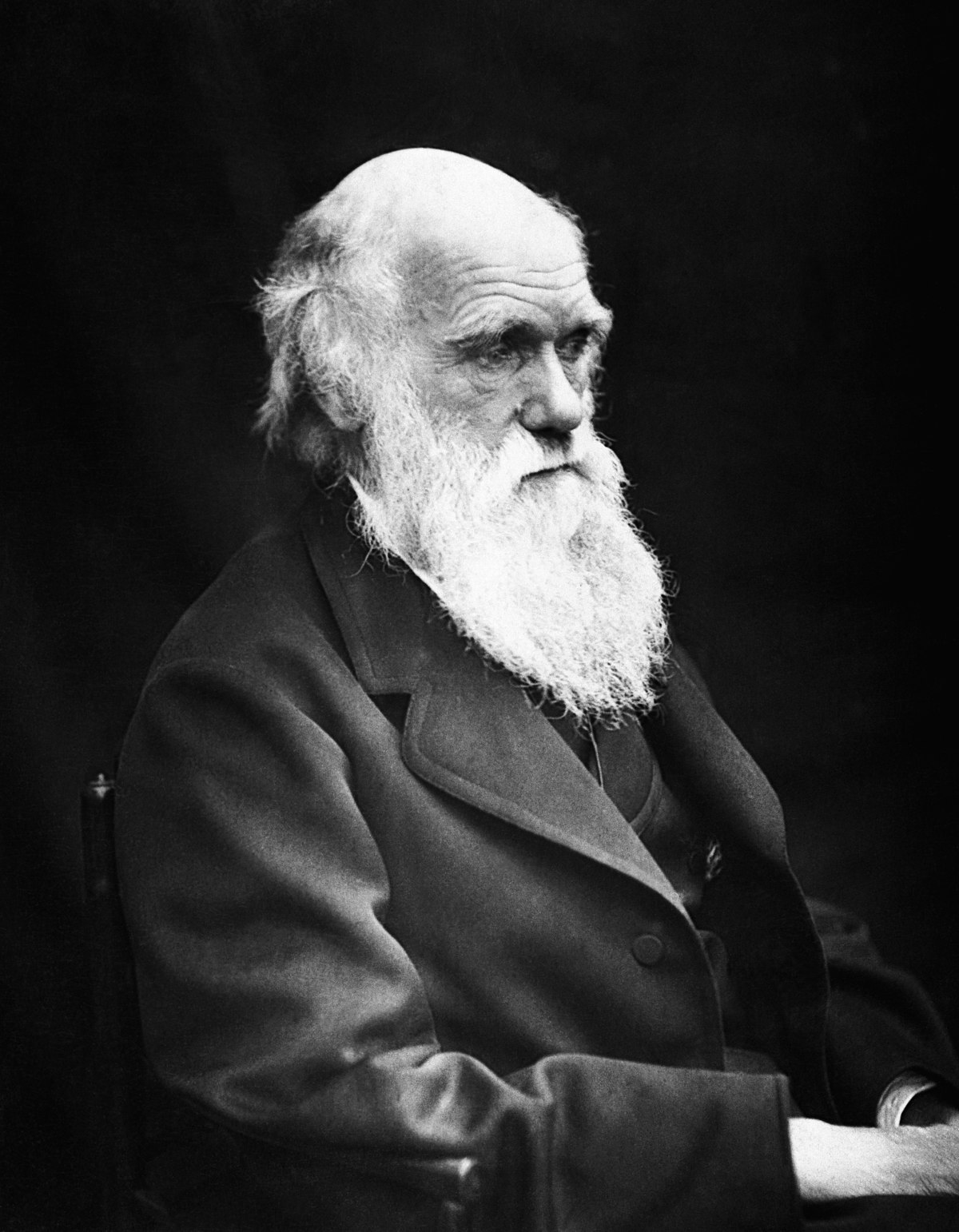
Pour Freud, la culture désigne l'ensemble des institutions qui éloignent l'individu de l'état animal. Elle désigne les pensées, la raison, le langage, les sciences, les religions, les arts, tout ce qui a été créé par l'être humain. La nature correspond aux émotions, aux instincts, pulsions et besoins. L’être humain lutte en permanence contre sa nature instinctuelle et ses pulsions, qu'il tente de réfréner afin de vivre en société, sans quoi l’égoïsme universel amènerait le chaos. Pourtant, Freud opère une confusion constante dans ses écrits entre la civilisation d'une part et la culture (Kultur) d'autre part. Son processus de développement s'assimile à celui de la psychogenèse. Ainsi, plus le niveau de la société est élevé, plus les sacrifices de ses individus sont importants. En imposant la frustration sexuelle surtout, la civilisation a une action directe sur la genèse des névroses individuelles. L'homme occidental en particulier n'est pas heureux et le texte de 1929, Malaise dans la civilisation, soutient la thèse que la culture est la cause principale de névrose et de dysfonctionnements psychiques. Par les règles claires qu’elle lui impose, la culture protège l'individu, même si elle exige des renoncements pulsionnels conséquents. Ces contraintes peut expliquer qu’il existe une rage et un rejet – souvent inconscients – vis-à-vis de la culture. En contrepartie, la culture offre des dédommagements aux contraintes et sacrifices qu'elle impose, à travers la consommation, le divertissement, le patriotisme ou la religion.
Dans l'essai « Une difficulté de la psychanalyse » publié en 1917, et dans ses conférences d'introduction à la psychanalyse, écrites pendant la Première Guerre mondiale, Freud explique que l'humanité, au cours de son histoire, a déjà subi « deux grandes vexations infligées par la science à son amour propre ». La première, explique-t-il, date du moment où Nicolas Copernic établit que « notre Terre n'est pas le centre de l'univers, mais une parcelle infime d'un système du monde à peine représentable dans son immensité ». La deuxième, selon lui, a lieu quand la biologie moderne – et Darwin au premier chef – « renvoya l'homme à sa descendance du règne animal et au caractère ineffaçable de sa nature bestiale ». Il ajoute : « La troisième vexation, et la plus cuisante, la mégalomanie humaine doit la subir de la part de la recherches psychologique d'aujourd'hui, qui veut prouver au Moi qu'il n'est même pas maître dans sa propre maison, mais qu'il en est réduit à des informations parcimonieuses sur ce qui se joue inconsciemment dans sa vie psychique ».
La religion et la parapsychologie
Se disant « incroyant », en dépit de sa culture juive, Freud est critique vis-à-vis de la religion et estime que l’être humain y perd plus qu’il n’y gagne par la fuite qu’elle propose. Selon lui, l’humanité doit accepter que la religion n’est qu’une illusion pour quitter son état d’infantilisme, et rapproche ce phénomène de l’enfant qui doit résoudre son complexe d’Œdipe : « ces idées [religieuses], qui professent d’être des dogmes, ne sont pas le résidu de l’expérience ou le résultat final de la réflexion : elles sont des illusions, la réalisation des désirs les plus anciens, les plus forts, les plus pressants de l’humanité ; le secret de leur force est la force de ces désirs. Nous le savons déjà : l’impression terrifiante de la détresse infantile avait éveillé le besoin d’être protégé – protégé en étant aimé – besoin auquel le père a satisfait ». S'appuyant sur les thèses de Charles Darwin, en 1912, dans Totem et Tabou, Freud explique que l'origine de l'humanité se fonde sur le fantasme d'une « scène primitive » dans laquelle a lieu le meurtre primitif du père comme acte fondateur de la société. Les hommes vivaient ainsi en hordes grégaires, sous la domination d'un mâle tout-puissant, qui s'appropriait les femmes du groupe et en excluait les autres mâles. Ces derniers commettent alors le meurtre du « Père primitif », meurtre qui explique ensuite le tabou de l'inceste comme élément constitutif des sociétés. Thomas Mann fait l'éloge de Totem et Tabou, il écrit : « [ce livre] nous incite plus qu'à une simple méditation sur l'effroyable origine psychique du phénomène religieux et sur la nature profondément conservatrice de toute réforme ». Dans Malaise dans la civilisation, Freud décompose ainsi l'évolution de l'humanité en trois phases : une phase animiste caractérisée par un narcissisme et un totémisme primaires, une phase religieuse marquée par la névrose collective et enfin une phase scientifique dans laquelle prédomine la sublimation.
L'occultisme et la parapsychologie n'ont guère intéressé Freud. Positiviste, il y voit une régression à l'état animiste. Dans Considérations actuelles sur la guerre et la mort (1915), Freud explique ainsi que la croyance dans les esprits est une réaction devant la mort. Cependant, plusieurs événements vont relativiser son opinion. Au début de sa rencontre avec Carl Gustav Jung, le 25 mars 1909, les deux hommes se retrouvent seuls pour évoquer l'intérêt des phénomènes para-psychologiques en psychanalyse. Freud refuse d'y voir des matériaux à exploiter, méprisant cet intérêt de Jung. Il y a alors des craquements soudains dans la bibliothèque de Jung, qui, peu surpris, annonce à Freud qu'il s'en produira de nouveau. En effet, peu de temps après, un nouveau craquement se fait entendre ; Jung note que Freud en est alors particulièrement effrayé, et depuis ce moment il nourrit une profonde méfiance envers le psychiatre suisse. L'étude de Christian Moreau revient sur des textes de Freud dans lesquels il témoigne d'une certaine perplexité pour les phénomènes limites et notamment pour la télépathie.
Freud et la question de l'antisémitisme
L'antisémitisme tient une place variable durant la vie de Freud, au gré des changements politiques que connaissent l'Autriche et ses voisins au début du XXe siècle,. L'antisémitisme joue un rôle déterminant à la fin de la vie du père de la psychanalyse, qui doit fuir l'Autriche devant la menace nazie. En effet, en 1933, les œuvres de Freud sont brûlées par les nazis qui y voient une « science juive » contraire à l'« esprit allemand ». Avec l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, de nombreux psychanalystes ont dû cesser leur pratique ou émigrer quand ils n'ont pas été tués ou envoyés dans des camps de concentration parce qu'ils étaient juifs. La ségrégation s'est d'abord développée en Hongrie, notamment sous le régime de Miklós Horthy. Puis, elle s'est propagée en Allemagne dès les années vingt et en Autriche, sans parler des pogroms dans la Russie tsariste. Dès lors, la plupart de ceux qui ont survécu ont émigré en Grande-Bretagne, en France, en Amérique du Sud et aux États-Unis. D'autres comme Max Eitingon sont partis pour la Palestine bien avant la création de l'État d'Israël.
Dans sa conférence sur l'antisémitisme de mai 1937, Thomas Mann écrit, à propos de Freud, qui s'identifie souvent au personnage biblique de Joseph : « [qu'il] est un artiste, et aussi un produit tardif, un petit-fils, un « cas » compliqué, un homme du stade où les traits de l'affinement et de la dégénérescence se confondent de façon troublante. », le dernier ouvrage de Freud, L'Homme Moïse et la religion monothéiste « invente une tradition juive du libéralisme et de l'esprit scientifique ». Médecin et historien autodidacte proche de Carl Gustav Jung, Henri Ellenberger a fait une étude consciencieuse sur la situation des Juifs dans l'ensemble de la région et a pu affirmer que Freud aurait exagéré l'impact de l'antisémitisme dans sa non-nomination à un poste universitaire de professeur extraordinaire. Il argumente sa thèse de manière documentée mais d'autres historiens — bien qu'Ellenberger n'ait jamais été soupçonné ou accusé d'antisémitisme (à la différence de Jung) — considèrent qu'il a minimisé le phénomène à Vienne. Régulièrement, en effet, la psychanalyse a été accusée d'être une science juive. Ainsi, le professeur Martin Staemmler de Chemnitz écrit, dans un texte de 1933 : « La psychanalyse freudienne constitue un exemple typique de la dysharmonie interne de la vie de l'âme entre Juifs et Allemands. [...] Et lorsqu'on va encore plus loin et que l'on fait entrer dans la sphère sexuelle chaque mouvement de l'esprit et chaque inconduite de l'enfant [...], lorsque [...] l'être humain n'est plus rien d'autre qu'un organe sexuel autour duquel le corps végète, alors nous devons avoir le courage de refuser ces interprétations de l'âme allemande et de dire à ces Messieurs de l'entourage de Freud qu'ils n'ont qu'à faire leurs expérimentations psychologiques sur un matériel humain qui appartienne à leur race ». Pour Lydia Flem, Freud et Theodor Herzl, chacun à leur manière, répondent à la crise identitaire juive, le premier en imaginant une topique psychique, le second en rêvant d'un pays géographique pour le peuple juif.
Freud et la cocaïne
La découverte de l'alcaloïde de la plante de coca est contemporaine des recherches de Freud, quant aux applications thérapeutiques possibles. En 1884, les laboratoires Merck confient à Freud la charge de mener des expérimentations sur la substance. Avant de créer la psychanalyse, Freud a étudié ce produit et a pensé pouvoir lui prêter toutes sortes d'indications médicales — notamment dans le traitement de la neurasthénie — avant que la cocaïne ne se révèle être la dangereuse drogue dont on connaît les ravages aujourd'hui. Freud travaille sur les propriétés anesthésiantes de la cocaïne avec deux collègues, Carl Köller et Leopold Königstein dès 1884. Cependant, alors qu'il pressent pourtant son intérêt pour la médecine, il n'a pas le temps de tester son pouvoir narcotique et doit s'absenter de Vienne. Ses collègues poursuivent les expérimentations, notamment dans le cadre de la chirurgie oculaire. Ils finissent par présenter leur découverte devant la Société médical de médecine de Vienne. Freud revient sur cet épisode plusieurs fois dans ses ouvrages, notamment dans L'Interprétation des rêves.
Freud a par ailleurs consommé épisodiquement de la cocaïne. Il en a usée entre 1884 et 1887 et il rédige un texte Über Coca. Il se détourne ensuite totalement de son étude après avoir suggéré à son ami Ernest von Fleischl-Marxrow de l'utiliser pour guérir de sa morphinomanie. Ce dernier avait utilisé l'opiacé pour soulager ses souffrances dues à une amputation du pouce, Freud pensant bien faire lui propose de remplacer la morphine par de la cocaïne en ignorant totalement les effets toxiques de cette dernière. Une toxicomanie en remplace ainsi une autre et, finalement après une agonie et des souffrances sans fin, von Fleischl se suicide.
Les toxicomanies à la cocaïne se déclarent dans d'autres pays, en Europe d'abord, notamment en Allemagne où le Dr Wallé, en vante sans prudence les mérites. Dans un article datant de 1886, le Dr Albrecht Erlenmeyer met enfin en garde la communauté médicale en termes précis, qualifiant même la cocaïne de « troisième fléau de l'humanité ». Face aux critiques de plus en plus nombreuses, le Dr Johann Schnitzler défend Freud. Freud défend l'usage de la cocaïne jusqu'en 1887 et affirme que c'est le sujet qui est prédisposé et pas la drogue qui entraîne la toxicomanie et continue d'en consommer épisodiquement et d'en prescrire en application nasale jusqu'en 1895, lorsqu'il entame l’auto-analyse.


















































