Médecine dans la civilisation islamique - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Anatomie et Physiologie
En Anatomie et Physiologie, le premier médecin à réfuter la théorie des humeurs de Galien est Muhammad ibn Zakarīya Rāzi (Rhazes) dans ses doutes sur Galien au Xe siècle. Il a critiqué la théorie de Galien selon lesquelles il existait dans l'organisme quatre "humeurs" (des substances liquides), dont l'équilibre était la clé de la santé et de la température naturelle du corps. Razi a été le premier à prouver que cette théorie était fausse en utilisant une Méthode expérimentale. Il a effectué une expérience qui perturbait ce système par l'introduction dans l'organisme d'un liquide à une température différente de celle du corps, entraînant une augmentation ou une diminution de la température corporelle qui se rapprochait de la température de ce fluide. Razi a noté en particulier qu’une boisson chaude réchauffait le corps à un niveau beaucoup plus élevé que la température naturelle, donc que la boisson déclenchait une réponse de l'organisme, supérieure à ce qui relevait du seul transfert de la chaleur ou du froid vers le corps. Cette critique a été la première réfutation expérimentale de la théorie des humeurs de Galien et de la théorie des Quatre éléments d’Aristote sur laquelle elle était fondée. Les expériences Alchimiques de Razi lui-même ont suggéré l’existence d'autres qualités de la matière, telles que " son caractère Huileux" et " sulfureux", ou son Inflammabilité et sa Salinité qui ne s'expliquent pas facilement par la traditionnelle division en quatre éléments comme le feu, l'eau, la terre et l’air.
Anatomie et physiologie Expérimentale
Les contributions d’Avicenne à la Physiologie comprennent l'introduction systématique de l’expérimentation et de la quantification pour l'étude de la physiologie dans le Canon de la médecine. La contribution d’ Ibn al-Haytham (Alhacen) à l’Anatomie et à la physiologie est principalement l’explication correcte du processus de la vision et de la perception visuelle pour la première fois dans son Traité d’optique, publié en 1021. Les autres innovations introduites par les médecins musulmans dans le domaine de la physiologie à ce moment-là sont également l'utilisation de l’Expérimentation animale et de la dissection du corps humain.
Avenzoar (Avenzoar) (1091-1161) a été un des premiers médecins connu pour avoir effectué des Dissections et des examens post-mortem Autopsies chez l'homme. Il a prouvé qu’une maladie de peau, la Gale était causée par un parasite, une découverte qui allait bouleverser la théorie des humeurs prônée par Hippocrate et Galien. L'élimination du parasite du corps du patient n'impliquait pas de Purge, de saignée ou tout autre traitement traditionnellement associé à la théorie des quatre humeurs.
Au XIIe siècle, les médecins de Saladin al-Shayzari et Ibn Jumay ont été également parmi les premiers à entreprendre la dissection du corps humain et ils ont appelé explicitement d'autres médecins à en faire autant. Au cours d'une famine en Égypte en 1200, Abd-el-Latif a observé et examiné un grand nombre de Squelettes et il a découvert que Galien avait formulé des conclusions erronées sur l’anatomie de l 'Os du maxillaire inférieur et du Sacrum.
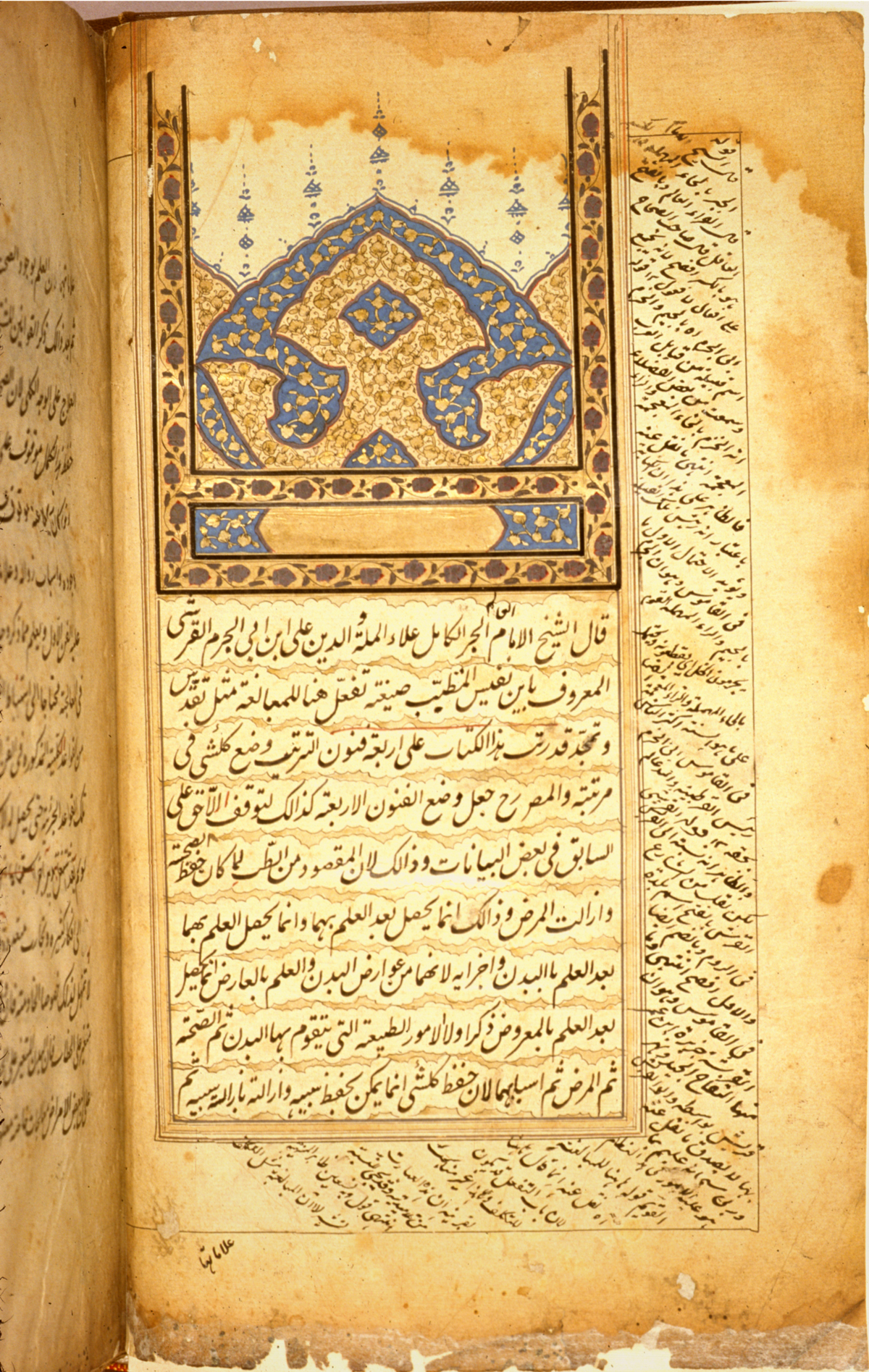
Anatomie et Physiologie Cardiovasculaire
Ibn al-Nafis, le père de la Physiologie circulatoire, fait partie des autres précurseurs de la dissection humaine. En 1242, il a été le premier à décrire la circulation pulmonaire, les Artères coronaires et la Circulation capillaire qui forment la base du système circulatoire, découvertes pour lesquelles il est considéré comme l'un des plus grands physiologistes de l'histoire. Les premières descriptions Européennes de la circulation pulmonaire n’ont été faites que plusieurs siècles plus tard, avec Michel Servet en 1553 et William Harvey en 1628. Ibn al-Nafis a également décrit le premier concept du Métabolisme et développé de nouveaux systèmes Nafisiens d’anatomie, de physiologie et de Psychologie pour remplacer les doctrines d’Avicenniennes et Galéniques, après avoir discrédité un grand nombre de leurs théories erronées sur les quatre humeurs, le Rythme cardiaque, les os, les Muscles, les Intestins, le Système sensoriel, les canaux biliaires, l’Œsophage, l’Estomac et l’Anatomie de presque toutes les autres parties du Corps humain.
Le médecin arabe Ibn al-Lubudi (1210-1267), originaire également de Damas qui a écrit le Recueil des discussions à propos de cinquante questions d’ordre psychologique et médical , dans lequel il rejette la théorie de quatre humeurs défendue par Galien et Hippocrate, a découvert que la préservation du corps dépend exclusivement du sang et rejeté l'idée de Galien selon laquelle les femmes peuvent produire la semence et a également découvert que la pulsation des Artères n’est pas tributaire des battements du cœur, que le cœur est le premier organe à se former dans l’organisme du fœtus (et non le cerveau comme le pensait Hippocrate) et que les os formant le crâne peuvent former des tumeurs. Dans les cas de fièvre élevée, il conseille également à un patient de ne pas sortir de l'hôpital.
Au XVe siècle, le Tashrih al-Badan (Anatomie du corps) écrit par Mansour ibn Ilyas contenait des schémas représentants la structure globale du corps, le système nerveux et le système circulatoire.
Pouls et Tension artérielle
Les médecins musulmans ont été pionniers dans l’étude du Rythme cardiaque. Dans les temps anciens, Galien ainsi que les praticiens de la médecine traditionnelle chinoise ont cru à tort qu'il y avait un type unique de rythme cardiaque pour chaque organe du corps et pour chaque maladie. Galien pensait également à tort que "chaque partie d'une artère bat en même temps" et que la perception d’une impulsion était due à des mouvements naturels (les artères se dilatant et se contractant naturellement), par opposition aux pulsations forcées (le cœur provoquant la dilatation et la contraction des artères ). La première explication correcte des pulsations a été donnée par les médecins musulmans.
Avicenne a été un pionnier de l’étude du pouls après avoir affiné la théorie de l'impulsion de Galien et découvert ce qui suit dans le Canon de la médecine:
« Chaque battement du pouls est composé de deux mouvements et de deux pauses. Les différentes phases se suivent ainsi : expansion, pause, contraction, pause. [...] Le pouls est un mouvement dans le cœur et les artères ... qui prend la forme d’une alternance de dilatation et de contraction. »
— Avicenne,
Avicenne est aussi un pionnier de la conception moderne de la prise du pouls grâce à la palpation du poignet qui est encore pratiquée à l’époque moderne. Ses raisons de choisir le poignet comme endroit idéal est dû au fait qu'il soit facilement accessible et que le patient n'ait pas besoin d’exposer son corps ce qui peut être une difficulté pour lui ou pour elle. La traduction latine de son Canon a aussi jeté les bases nécessaires à l’invention plus tardive du sphygmographe (tensiomètre).
Ibn al-Nafis, dans son commentaire sur l'anatomie décrite dans le ,Canon d'Avicenne, a complètement rejeté la théorie galénique de la pulsation après sa découverte de la circulation pulmonaire. Il a développé une théorie Nafisienne de la pulsation, après avoir découvert que la pulsation est le résultat naturel de deux mouvements, qu’il s’agit d’un mouvement forcé et que le "mouvement forcé correspond à la contraction des Artères provoquée par la dilatation du cœur et le mouvement naturel est celui de la dilatation des artères." Il note que les "artères et le cœur ne se dilatent et se contractent pas en même temps, mais plutôt que l'un se contracte, pendant que l'autre se dilate" et vice versa. Il a également reconnu que l'objectif de l'impulsion est de favoriser l’irrigation du reste du corps par le sang provenant du cœur. Ibn al-Nafis résume brièvement sa nouvelle théorie de la pulsation:
« Le but principal de la dilatation et de la contraction du cœur est d'absorber l'air frais et d'expulser les déchets de l'esprit et l'air chaud, lorsque le ventricule du cœur est dilaté. Cependant, quand il se dilate il ne lui est pas possible d'absorber l'air jusqu'à ce qu'il soit plein, car cela ruinerait le tempérament de l'esprit, dans sa substance et sa texture, ainsi que le tempérament du cœur. Ainsi, le cœur est nécessairement forcé de se remplir complètement par absorption de l'esprit. »
— Ibn Nafis,

















































