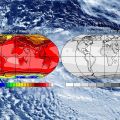René Berger - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Vie et principaux livres
René Berger, de nationalité suisse, obtient sa licence ès lettres à l'Université de Lausanne en 1941, puis le titre de docteur de l'Université de Paris que lui vaut sa thèse d'esthétique soutenue en 1957 à la Sorbonne. Dès son premier enseignement à l'École supérieure de commerce de Lausanne, il introduit dans les programmes un nouveau cours intitulé « Connaissance de l'art », fondé, moins sur la recherche historique que sur la mise au point d'une méthode d'approche esthétique dont il tire en 1958 Découverte de la peinture, premier essai de méthode de lecture esthétique, ouvrage qui sera repris en livres de poche et qui connaîtra de nombreuses traductions. Dans la suite des douze volumes publiés en 1963 sous le titre de Connaissance de la peinture (reprise bientôt en 6 volumes) se confirme sa préoccupation d'approfondir son approche critique en la reliant de plus près à l'évolution de nos moyens de communication. Cette conception, qui rompt avec l'histoire traditionnelle de l'art, décide la télévision à réaliser une série de 13 émissions multilingues diffusées dans de nombreux pays, et qui sont dans certains l'occasion de diffusion en vidéocassettes.
À la faculté des Lettres de l'Université de Lausanne, où il est successivement lecteur de littérature française, chargé de cours, puis professeur associé, il s'efforce d'éclairer les changements culturels dus à l'évolution accélérée des moyens techniques. Dès 1971, il prend l'initiative de créer dans le cadre de l'Université un cours expérimental : Esthétique et mass media, dont le postulat (d'abord mal accepté par la faculté), consiste à étendre la dimension esthétique au-delà des arts traditionnels.
Découverte de la peinture
Premier essai de méthode de lecture esthétique, ouvrage qui sera repris en livres de poche et qui connaîtra de nombreuses traductions.
Connaissance de la peinture
En 12 volumes (150 illustrations hors texte couleurs, 1 500 en noir), réédité en 6 volumes ; adaptation à la télévision, série de 13 émissions, produites par la SSR, traduites et diffusées dans plus de 25 pays.
Art et communication
En 1972 paraît Art et communication, ouvrage dans lequel l'auteur s'emploie à démontrer qu'un objet de connaissance n'est jamais « donné », mais qu'il est toujours conditionné par les moyens de communication en cours et en devenir.
La Mutation des signes
La Mutation des signes, publié la même année, en développe les conséquences, à savoir que nous sommes entrés dans une ère multimédias, qui préfigure l'avènement d'une multiréalité. La notion de mass media doit désormais s'étendre aux moyens de transport de masse que sont devenus l'automobile, le train, l'avion, ainsi qu'aux activités de masse tels le tourisme, les loisirs, la mode. D'où la mise en garde à propos des « sémiurgiens » qui, fabriquant simultanément les produits et les signes, façonnent notre existence quotidienne à l'échelle de la planète. C'est dans ce dernier ouvrage qu'il inaugure le concept de « technoculture », aujourd'hui d'usage courant.
Il multiplie les voyages pour approfondir à la fois son information et sa réflexion. C'est ainsi qu'il participe à de très nombreux colloques, séminaires, conférences, tables rondes dans le monde entier. La théorie de l'information, la cybernétique, le développement des sciences, en particulier de la physique et de la biologie, élargissent son cadre de référence et le conduisent à s'intéresser toujours de plus près au phénomène de la télévision et de l'informatique naissante.
La Télé-fission, Alerte à la Télévision
La Télé-fission, Alerte à la Télévision, paru en 1976, étudie comment la télévision est en train de provoquer un éclatement culturel qui ne cède en rien à celui provoqué en physique par la fission de l'atome. À la lumière de la psychanalyse, l'auteur découvre que les « missions » qu'on s'accorde à reconnaître traditionnellement à la télévision, relèvent moins de l'esprit rationnel dans lequel on les inscrit que d'une fantasmatique collective dont on sait encore peu de chose. Ce qui incite l'auteur à préciser que l'Originel, fondement du mythe, se déplace progressivement vers l'Actuel, l'événement prenant le pas sur le symbole.
Son propos n'est ni technique, ni historique, encore moins encyclopédique ; il vise à éclairer le changement de notre civilisation dans une perspective, osons le terme, « techno-anthropologique ».
L'Effet des changements technologiques
L'Effet des changements technologiques, paru en 1983, poursuit l'enquête en s'interrogeant sur quelques-unes des grandes mutations de notre temps : la ville, aujourd'hui machine-à-vivre-en-masse ; la vitesse, qui engendre la nouvelle race des « télanthropes »… Dans la Maïa technologique qui nous enveloppe, les artistes ont-ils encore le pouvoir de nous aider quand la clairvoyance fait de plus en plus défaut tant aux experts qu'aux hommes politiques, et sans doute à la plupart d'entre nous ?
Poursuivant ses travaux, René Berger s'attache à analyser, à la suite de la récente révolution audiovisuelle, celle que provoque l'arrivée massive de la micro-informatique. Ce faisant, il en vient à conjecturer que nous en venons de plus en plus à abandonner les modèles séculaires de Platon et d'Aristote, fondés l'un et l'autre sur la notion centrale de Réalité, pour prendre la route d'Abdère où Démocrite, « pré-informaticien », agence images et paroles, couleurs et sons en agrégats d'atomes (ou d'électrons ?).
Jusqu'où ira votre ordinateur ? L'imaginaire programmé !
C'est pour l'auteur l'occasion de s'interroger sur la nature et la portée des nouvelles technologies. Jusqu'où ira votre ordinateur ? L'imaginaire programmé ! (1987). Rapport difficile. Comment traiter avec un « maître » exigeant, pointilleux, qui ne laisse rien passer, et qui ne se trompe pas ? Comment s'accommoder d'une logique, purement rationnelle, alors que nous sommes faits d'abord d'incertitudes, d'émotions, de mouvements du cœur ? Impossible de nous laisser, comme nous y invite jusqu'ici le développement de l'informatique, à un positivisme sans faille, donc inhumain ! L'ordinateur est-il capable de briser la clôture qui nous menace ? Certains indices semblent porteurs d'espoir. Après la période triomphante de la « force brute », affaire des seules performances, voici que s'annonce peut-être une deuxième informatique, soucieuse de conscience. En dépit de la méfiance, on voit déjà nombre d'artistes qui se mettent à explorer cette voie, comme s'il leur appartenait d'orienter une société techniquement toujours plus puissante pour la soustraire à la condamnation d'un imaginaire toujours plus programmé.
Téléovision, le nouveau Golem
Téléovision, le nouveau Golem (1991) avance l'hypothèse que l'homme et la machine entrent dans un rapport sans cesse plus étroit. De même que le terme de téléonomie suppose un projet à l'organisation du vivant, de même téléovision suppose une organisation inhérente au développement technique et qui simultanément le dépasse. Trois configurations, à titre métaphorique, peuvent servir de repère : la première, zoomorphique, associe animaux et dieux, comme ce fut le cas en Égypte antique ; la deuxième, anthropomorphique, exalte l'image humaine jusqu'à la confondre avec le divin, ainsi que l'atteste la civilisation grecque ; la troisième est celle qu'a préfigurée Norbert Wiener il y a plus de 30 ans déjà. Le nouveau Golem naît de la co-évolution de l'homme et de la machine qui s'accomplira dans une âme partagée, comme ils s'apprêtent l'un et l'autre à faire du cyberespace leur nouvelle patrie.
L'origine du futur
Dans son dernier ouvrage, L'origine du futur, paru en mars 1996, René Berger part du fait que la mutation de notre monde a atteint un seuil critique. Pour la première fois, les médias qui coexistaient jusqu'ici - Presse écrite, radio, photographie, cinéma, téléphone, télévision, informatique - se mettent à fusionner en une télématique universelle. Déjà les « autoroutes de l'information » sont en proie aux méga-fusions des entreprises à l'affût d'un marché lui aussi planétaire.
Double révolution à l'instigation de l'ordinateur, à la fois moteur et co-acteur d'hybridations aussi singulières que « l'intelligence artificielle », la « réalité virtuelle », ou encore la « vie artificielle ».
Non seulement les paradigmes classiques cèdent à de nouveaux paradigmes, nos « topiques » fondamentales sont ébranlées. Nos conceptions et nos comportements s'orientent vers une transdisciplinarité et une trans-pragmatique dynamiques globales, qu'il importe de réguler, mais d'abord de connaître.
C'est ce qu'éclairent, entre autres phénomènes révélateurs, les « arts technologiques », l'art vidéo, le computer art, l'art télématique, l'holographie, l'art des réseaux informatiques qui nous ouvrent des dimensions sans précédent. La technique ne « s'ajoute » pas à l'homme ; elle lui devient constitutive : ainsi du « cyberespace » dont l'ampleur ne fait que croître.
Notre imaginaire anthropologique est-il en train de changer l'interface que nous avions établie entre les humains et la mort au moyen de symboles, image, parole, représentation, rite ? Liée durant des millénaires au « monument » qui la stabilisait en lui donnant forme dans la tradition, la mémoire s'incarne de plus en plus dans les réseaux, tel Internet, dont les interactions permanentes « inventent » l'avenir en temps réel. Paradoxe de notre entrée dans le XXIe siècle : l'origine du futur interpelle chacun de nous au présent.
Les cybercarnets, les cybergraines et les cyberlivres
Éclairer le sens de la mutation en cours, dans l'ensemble de ses manifestations, en se fondant sur l'apport prioritaire des artistes, telle semble bien être l'orientation de René Berger. « Vecteur », il s'efforce d'ouvrir la voie et de l'explorer. Aussi bien la théorie et la pratique, l'information, la réflexion et l'action sont-elles pour lui indissociables.
(Cf. Ici téléchargement de quelques livres en .pdf et ses dernières réflexions, les Cybercarnets, cybergraines et cyberlivres, 1994-2005, depuis son site.)