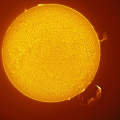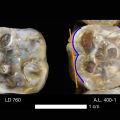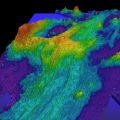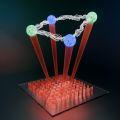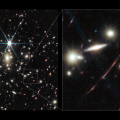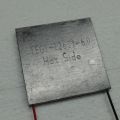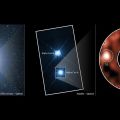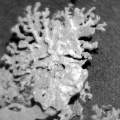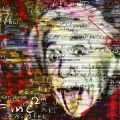Mortalité animale due aux véhicules - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Espèces impliquées
La quasi-totalité des espèces animales sont concernées par la mortalité routière. Les espèces impliquées dans les accidents routiers varient évidemment selon les régions. Les espèces les plus vulnérables sont cependant les animaux :
- lents ou peu capables d’éviter les véhicules
- protégés (ou se croyant protégés) par :
mais également :
- les grands herbivores, qui doivent pâturer sur de vastes étendues et qui, pour certaines espèces de zone tempérée, migraient autrefois du nord vers le sud chaque hiver (ex : rennes, élans) ; plus près des pôles, ces migrations saisonnières restent vitales pour ces espèces ;
- les grands et moyens carnivores (loups, ours, lynx, gloutons, pumas, ocelots, chats sauvages, etc.) ont généralement de vastes territoires de chasse à parcourir, et ils doivent parfois migrer avec leurs proies,
- les petits carnivores (renards, loutres, fouines, belettes, putois, etc.) qui prospectent de vastes territoires,
- les animaux à vaste territoire dont l’habitat régresse fortement. Exemple :
- la population relique d’ours des Pyrénées en France, confinée sur moins de 0,1 % de son ancien territoire ; ainsi Franska achetée en Slovénie a été tuée sur la RN21, alors qu'elle pesait 120 kilogrammes, le jeudi 9 août 2007, un an après son introduction dans les Pyrénées. Cet accident a eu lieu avec un véhicule militaire, après que l'ourse a été percutée par un premier véhicule. Le véhicule militaire, une Renault Kangoo, ayant tué Franska était conduit par un sous-officier du 1er régiment de hussards parachutistes, entre 6 heures et 6 heures 30, à 5 km au sud de Lourdes sur la commune de Viger. Cet accident a eu lieu en pleine polémique entre les habitants de la région et les défenseurs de la réintroduction d'ours en France, quant au comportement particulier de l'ourse qui tendait à descendre dans les plaines et à s'attaquer à des moutons d'élevage.. En Slovénie vingt ours sont percutés chaque année sur des routes comme en France les sangliers et les cervidés. Les personnes ayant organisé et participé aux battues illégales ayant précédé l'accident n'ont pas été inquiétées, alors qu'Emmanuel Berthier, préfet des Hautes-Pyrénées, leur avait expliqué l'illégalité de leurs actes.
-
- le grizzly confiné sur moins de 2 % de son territoire aux États-Unis (au sud du Canada),
- le loup, le lynx
- et tous les animaux qui doivent traverser beaucoup de routes, en particulier ceux qui longent les cours d'eau.
Des animaux semi-domestiques sont également régulièrement écrasés ou blessés (dont chats et chiens).
Remarque : On ne parle pas de mortalité routière pour la flore, puisque l’on considère que ce phénomène implique une collision. La fragmentation écopaysagère par des infrastructures de transport n'est cependant pas sans conséquence sur la biodiversité végétale et sur la circulation des gènes de plantes.
Collision avec les insectes
Il n’existe que très peu d’informations sur la mortalité des insectes due aux chocs avec les automobiles ou les blessures que les turbulences des véhicules rapides peuvent induire sur ces espèces.
Les insectes morts ou agonisants les plus facilement retrouvés sur les bords de route sont les papillons et dans les zones humides les libellules car ils sont de plus grande taille, colorés et facilement visibles. Ils sont aussi plus « lourds » (ce qui les fait retomber sur la chaussée ou le bas-côté), mais un nombre bien plus grand de petits insectes restent collés aux véhicules ou sont emportés par le vent et les turbulences sur les bas-côtés.

En France, une évaluation réalisée à partir de comptages faits dans la région de Fontainebleau en 1990 a donné les résultats suivants : 60 billions (60 × 1012) d'insectes meurent dans un choc contre un véhicule chaque année en France (66,420 milliards pour la seule région de Fontainebleau), et il y aurait plus de 100 tonnes de cadavres d'insectes (plus gros que ceux qui restent collés sur les véhicules) le long de nos routes.
On ne sait pas quelle est la part de ces insectes par rapport à la masse totale d'insectes qui circulent sur et au-dessus des routes (soit sur 1,2 % du territoire environ), ni quel est l'impact sur l'écologie des populations de ces insectes et de celles qui dépendent de ceux-ci pour leur survie…
JP Chambon, auteur de cette étude, a aussi montré qu'en été, la période de la journée au cours de laquelle les insectes sont les plus vulnérables se situe dans la tranche horaire 13-18 h. et la mortalité est plus élevée en zone boisée qu’en zone cultivée et urbaine.
Cette étude n’a pas été mise à jour (depuis 1990. Or le nombre de routes et le flux de véhicules ont fortement augmenté depuis cette date. Beaucoup de populations d’insectes, papillons diurnes notamment, ont fortement régressé). En théorie, les études d’impacts devraient mieux étudier ces questions, y compris pour des trains de type TGV ; pour produire des mesures compensatoires et pour mieux tenir compte de la diversité des situations (environnement biogéographique, nature et couleur des routes, nature des accotements et leur gestion, nombre, vitesse et type de véhicules, etc.), mais ce problème a été peu traité.
Néanmoins, les données de 1990/1991 ont permis les évaluations suivantes : compte tenu de l’évolution du réseau routier et du parc automobile :
-
- plus de 66 000 milliards d’insectes peuvent être tués chaque année par collision directe avec les voitures en France,
- à ce chiffre il faut ajouter environ 40 tonnes/an d’insectes tués et projetés sur les bas côtés,
- ce chiffre, compte tenu de la disparition et du renouvellement des cadavres, peut être multiplié par 4 ou 5 pour l’année ce qui représente 120 à 200 t/an de matière animale déposée.
JP Chambon rappelle qu’on ne sait pas ce que ces chiffres représentent par rapport au nombre et à la masse des insectes vivants et, que la surface des routes où s’opère cette destruction (6 500 km²) ne représente qu’environ 1,2 % de l’ensemble du territoire français (550 000 km²), inscrits dans 8 % du territoire artificialisé ou urbanisé.
Néanmoins, étant donné que les champs cultivés sont devenus, en raison des pesticides, inhabitables pour de nombreuses espèces d'insectes, et sachant que les bas côtés jouent un rôle important de « corridor biologique de substitution », on peut penser que cette mortalité est un facteur à considérer en termes de fragmentation écologique du territoire, d'autant que les routes sont aussi des barrières écologiques pour d'autres raisons, étudiées par ailleurs (Voir l'article sur les corridors écologiques).
Des simulations et modèles mathématiques simples montrent que si les déplacements d'insectes étaient aléatoires, les flux de véhicules existant suffisent pour détruire de très importantes populations.
Le cas des TGV mériterait aussi d'être étudié, car son effet de souffle et les turbulences induites sont importants (300 km/h).
La mortalité varie donc selon le trafic, l'heure du jour ou de la nuit, la densité des populations d’insectes (et donc le contexte agro-écologique, l'altitude, les microclimats, etc.), le niveau d’activité des insectes (variant selon la saison, le climat, le lieu, la pollution lumineuse, la lune), et l’état physiologique des insectes. On a même montré dans certaines zones un nombre fortement accru de libellules et papillons tués le dimanche, en raison d’un afflux supplémentaire de visiteurs sur les routes traversant ou bordant les milieux naturels.
De nombreuses autres espèces, dont amphibiens, oiseaux et petits et grands mammifères sont également victimes de la mortalité routière.
Collision avec les amphibiens
Lors des migrations annuelles vers le lieu de reproduction, les crapauds, grenouilles et tritons subissent de véritables hécatombes, avec parfois des milliers de cadavres sur quelques centaines de mètres de routes. On a expérimentalement montré par ailleurs que la plupart des amphibiens sont par ailleurs attirés par les lampadaires (souvent en bord de routes).
Après la sortie de l’eau (parfois forcée par la sécheresse), les mortalités sont plus discrètes. Les jeunes amphibiens sont alors très vulnérables (90 % vont rapidement mourir). Ceux-ci meurent déshydratés en quelques minutes sur le bitume ou sur le béton sec.
Collision avec les oiseaux
Toutes les espèces d’oiseaux sont concernées, mais en particulier les espèces migratrices et celles dont le terrain de chasse se trouve à proximité des routes, ou de terrains d'aviation.
Les oiseaux qui sont nés près d’une route semblent mieux en « apprendre » les dangers et les oiseaux chanteurs tendent à s'éloigner des routes bruyantes.
Ce sont les rapaces nocturnes, qui lorsqu'ils sont éblouis par les phares ou luminaires alors qu'ils chassent de nuit, semblent le moins bien éviter les véhicules. Ainsi observe-t-on une forte surmortalité des (chouettes, hiboux) le long des routes à proximité de leurs habitats. Ils sont bien plus nombreux à mourir de collisions que les rapaces diurnes, alors que les véhicules sont bien plus rares sur les routes la nuit.
Ce phénomène s'ajoute aux collisions d'oiseaux sur les vitres et superstructures, de jour, mais surtout de nuit, en raison de phénomènes généralement regroupés sous l'expression « pollution lumineuse ».
Les rapaces diurnes sont également parfois victimes de collisions, après avoir été attirés par des rongeurs blessés ou mort sur ou près de la route dont les bas côtés sont souvent des espaces dégagés qu'ils apprécient pour chasser de petits mammifères.
Collision avec les mammifères


On manque de données chiffrées pour les petits mammifères (hormis quelques études très ponctuelles et/ou portant sur les hérissons, les loutres ou les écureuils), mais de nombreuses données existent concernant les espèces dites « grands gibiers » ou quelques espèces suivies par colliers émetteurs (ours, loutres, lynx). Elles sont à l’origine de la création des premiers passages à faune (écoducs).
Dans les pays où les plans et quotas de chasse, et l'agrainage ont permis aux populations de sangliers et ongulés de fortement croître depuis les années 1970, et alors que le nombre de véhicule augmentait fortement, la croissance du nombre de collisions entre véhicules et ces animaux est très nette. C'est notamment le cas en France où selon l'ONCFS, le sanglier, puis le cerf et le chevreuil sont 99 % du total des grands animaux heurtés par des véhicules (les autres espèces ne concernant qu'environ 1 % des collisions).
- - le nombre des collisions estimées est passé de 3 700/an en 1997 à 23 500/an en 2007 (multiplié par 6,3 en 20 ans),
- - le coût de ces accidents (sans parler des « coûts humains ») a été évalué à 115 - 180 millions d'euros, soit 3 à 5 fois le total des indemnisations agricoles liées aux dégâts du gibier.
- - grâce aux panneaux de signalisation et aux progrès en matière de sécurité (ceinture obligatoire, pare-chocs plus performants, freins ABS, air-bags, etc.), des dégâts corporels ne sont en France provoqués que dans 2 % des collisions, et celles-ci sont une faible part des causes directes d'accident de la route, mais ils constituent 30 % du coût économique évalué des accidents. Les corridors écologiques canalisant mieux ces animaux vers des écoducs devraient réduire ces risques, mais ils sont encore peu nombreux.
Collision avec la grande faune
La collision, même à une vitesse raisonnable, avec un animal dont le poids peut dépasser 100 kg, ne peut qu’entraîner des dégâts matériels importants pour le véhicule et corporels graves pour ses occupants.
Les manœuvres d’évitement d’un animal qui traverse la route devant un véhicule peuvent également être à l’origine d’accidents. Mais en dehors des accidents graves, il existe un nombre important de collisions qui ne sont pas signalées pour diverses raisons dont la principale est la certitude de ne pas être dédommagé. On estime en effet que les collisions avec la grande faune ne sont signalées que dans 50 % des cas. Certains avancent même le chiffre de 25 %.
En France, la fréquence des accidents entre ces trois catégories se répartit comme suit :
- Chevreuils : 50 %
- Sangliers : 45 %
- Cerfs : 5 %
La gravité du choc dépend de la masse de l’animal, de la vitesse du véhicule, à laquelle il faut ajouter celle de l’animal s’il courait et arrivait de front. L'énergie cinétique croît en effet avec le carré de la vitesse (E=1/2M.V²).
La probabilité de rencontre dépend de plusieurs paramètres, et tout d'abord des populations de gibier. Or, depuis la réalisation de cette enquête (1985), l'augmentation des populations de gibier a été forte (multipliées par 4 environ).
Mais cette probabilité de rencontre dépend également de la circulation automobile. Celle-ci a été multipliée par deux environ entre 1985 et 2001 (pour le trafic national).
Ainsi la combinaison de ces deux facteurs conduit à une multiplication potentielle par huit du nombre des accidents.
En 1985, l’estimation du nombre des collisions était de 11 000. En 2001, on estime à 100 000 les collisions entre véhicules et grande faune, dont 45 000 pour les seuls sangliers. Ce chiffre intègre toutes les collisions avec ou sans dégâts corporels.
Grâce aux progrès techniques (véhicules équipés du système de freinage ABS, meilleure solidité, etc), la plupart des accidents ne se traduisent que par de faibles dégâts et ne provoquent pas de morts ou de blessés humains.
Cependant d’autres accidents sont simplement dus à une manœuvre d'évitement et ne sont pas toujours comptabilisés en collisions (il peut aussi s’agir d’oiseaux, de lièvres, lapins, chiens, chats, etc.). Cette estimation globale reste faible : 4 % environ des 2,3 millions d'accidents recensés par les compagnies d'assurance. Son impact est cependant perceptible dans l'opinion publique.
Collision avec les petits mammifères
Elles sont plus discrètes et peut-être plus rares avec les très petits mammifères qui semblent ne pas s'aventurer sur les routes. Certaines espèces (écureuil) y sont cependant vulnérables.
Impact sur des espèces menacées
À titre d'exemple, en Tasmanie où il n'y a que 5,25 hab./km², plus de 100 000 animaux par an sont écrasés sur les routes. Selon le Dr. Alistair Hobday, un chercheur australien travaillant sur le sujet, 1,5 à 2 % des diables de Tasmanie (espèce en forte régression) meurt ainsi tous les ans, ce qui est une cause importante d’affaiblissement de leurs populations.
Les collisions chez les mammifères semi-aquatiques tels que la Loutre d'Europe ou le Vison d'Europe peuvent menacer la survie des populations: les ponts ne sont en général pas adaptés au franchissement de ces espèces qui sont contraintes de traverser de nombreuses routes.